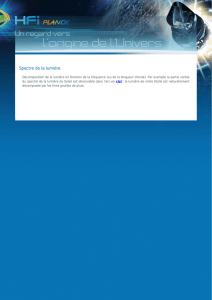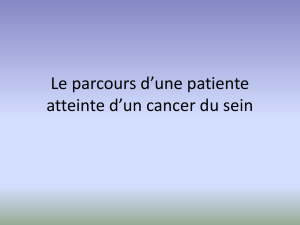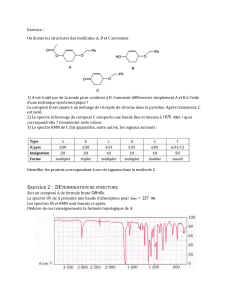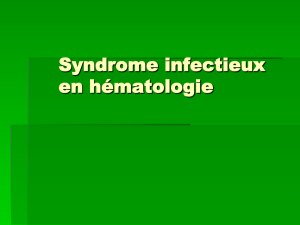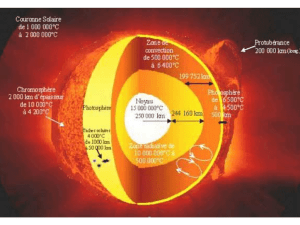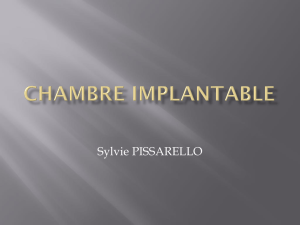INFECTIONS CHEZ LES PATIENTS NEUTROPENIQUES

INFECTION ET CANCER :
ANTIBIOTHERAPIE DES NEUTROPENIES FEBRILES
DU de Carcinologie Clinique
13 novembre 2015
Docteur Bertrand Gachot
Unité de Pathologie Infectieuse et Département de Soins Aigus
Gustave-Roussy, Villejuif

Une neutropénie est définie par un chiffre de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm3
ou inférieur à 1000/mm3 avec une baisse attendue à moins de 500/mm3. Les épisodes fébriles
(définis par une température > 38,3°C ou > 38°C pendant au moins 1 heure) sont très
fréquents en cas de neutropénie chimio-induite : ils concernent entre 10 et 50% des patients
traités pour une tumeur solide et plus de 80 % des patients pris en charge pour une
hémopathie (1,2). Si ces épisodes fébriles sont non documentés dans plus de la moitié des cas,
il est néanmoins connu depuis plusieurs décennies que l’existence d’une neutropénie est
associée à un risque accru de complications infectieuses bactériennes graves, avant tout
bactériennes et fongiques. De fait, la survenue d’une fièvre dans ce contexte doit conduire à
commencer, en urgence, un traitement antibiotique empirique, l’évolution rapide vers un choc
septique étant la règle en cas de bactériémie, avec un pronostic alors très sombre (3).
Parallèlement à cette urgence thérapeutique absolue, l’évolution de l’épidémiologie des
infections à bacilles à Gram négatif en France et en Europe, avec banalisation des
entérobactéries productrices de béta-lactamase à spectre élargi et émergence de souches
productrices de carbapénémases, impose une utilisation particulièrement raisonnée des
antibiotiques dans ce contexte (4,5).
EPIDEMIOLOGIE
Infection bactérienne
Cinquante à 70% des épisodes de neutropénie fébrile restent non documentés : il n’y a ni
point d’appel ou foyer clinique, ni documentation microbiologique (2). Ceci ne signifie pas
que ces fièvres ne soient pas d’origine infectieuse, puisque la flore intestinale est composée
essentiellement de firmicutes, bactéries anaérobies strictes à Gram positif, dont on ne sait
cultiver que quelques espèces (6).
2

L’infection est documentée cliniquement dans 20 à 30% des épisodes fébriles : pneumopathie,
infection cutanée et des tissus mous, foyer bucco-dentaire… Dix à 25% des patients sont
bactériémiques, les épisodes de bactériémies survenant avant tout lors de neutropénies
profondes (< 100/mm3) et prolongées (plus de 10 jours). L’épidémiologie de ces bactériémies
a évolué ces dernières décennies (1). Depuis les années 1980-90, les cocci à Gram positif
prédominent, notamment en raison de l’utilisation larga manu des cathéters veineux centraux,
de la toxicité muqueuse des chimiothérapies et de l’utilisation des quinolones en prophylaxie.
A l’Institut Gustave-Roussy, sur 218 épisodes bactériémiques ou fongémiques survenus en
hématologie entre janvier 2010 et juin 2011, un quart étaient dus à des staphylocoques à
coagulase négative (3 ; fig. 1). Les bactériémies à staphylocoque doré sont très rares chez les
patients neutropéniques. Les autres bactéries à Gram positif impliquées sont des entérocoques,
mais aussi des streptocoques non hémolytiques, particulièrement quand il existe une mucite
importante, ce qui est le cas après chimiothérapie par l’aracytine à forte dose (7). Dans notre
série, un quart des bactériémies étaient dues à des entérobactéries, au premier rang desquelles
figure Escherichia coli. Ces entérobactéries sont souvent productrices de béta-lactamases à
spectre élargi dans certains pays (8). Les entérobactéries productrices de carbapénémases,
endémiques dans plusieurs pays d’Europe du sud, sont encore isolées sporadiquement en
France (9). Les autres bacilles à Gram négatif en cause sont des Pseudomonas ou apparentés.
Les souches de P. aeruginosa sont fréquemment multirésistantes, représentant un tiers des cas
dans une étude italienne récente (10). L’interruption de la prophylaxie par les
fluoroquinolones dans certains centres, devant une prévalence croissante de la résistance à
cette classe d’antibiotiques, a entraîné une augmentation de la proportion des bactériémies à
bacilles à Gram négatif (11).
3

Infection fongique
Les champignons sont rarement en cause lors du 1er épisode fébrile au début de la
neutropénie. Les infections fongiques surviennent en général après la 1ère semaine, chez des
patients déjà sous antibiothérapie à large spectre (1,2). Les levures, avant tout du genre
Candida, peuvent être à l’origine d’une simple candidose oropharyngée, mais aussi de
fongémie à point de départ intestinal. Lors de l’évaluation effectuée récemment dans notre
institution, les fongémies représentaient, en hématologie, 3% des hémocultures positives (3 ;
fig. 1). Les candidoses hépato-spléniques sont très rares.
Les infections à champignons filamenteux sont surtout des aspergilloses invasives,
pulmonaires ou sinusiennes, et surviennent dans la majorité des cas après la 2e semaine de
neutropénie. La mucormycose est beaucoup plus rare (12). D’autres champignons filamenteux
peuvent être en cause, notamment chez les patients qui ne sont pas hospitalisés en secteur
protégé. Enfin, l’administration d’échinocandines en traitement empirique est susceptible de
sélectionner certaines espèces résistantes, telles Hormographiella aspergillata (13).
Infection virale
L’épidémiologie des infections virales chez les patients neutropéniques est mal connue. La
fréquence des viroses respiratoires est possiblement sous-estimée. La survenue d’un herpès
buccal n’est pas rare, et peut contribuer à la gravité de l’atteinte muqueuse déjà présente. Les
infections à CMV ou adénovirus concernent surtout les greffés de moelle, souvent après la
phase de neutropénie.
4

CONDUITE A TENIR DIAGNOSTIQUE
Un interrogatoire policier doit rechercher tout antécédent infectieux potentiellement
pertinent : herpès naso-labial ou génital, furonculose, pathologie ano-rectale, infection bucco-
dentaire.
Le passé hospitalier récent doit faire l’objet d’une analyse soigneuse : type de chimiothérapie
reçue, date d’apparition de la neutropénie, traitements antibiotiques, antériorité
microbiologique, notamment toute colonisation à bactéries multirésistantes.
L’examen physique doit être très attentif, certains sites justifiant une attention toute
particulière : la peau et les tissus mous, le périnée et le ou les sites d’insertion des cathéters.
Les réactions inflammatoires sont souvent limitées ou absentes du fait de la neutropénie : des
signes même limités doivent donc alerter. Enfin, l’existence de signes de gravité (instabilité
hémodynamique, polypnée, troubles de la vigilance ou syndrome confusionnel…) influence
nécessairement les choix thérapeutiques (v. infra).
Les examens complémentaires de routine doivent inclure la fonction rénale, les tests
hépatiques. L’intérêt des marqueurs de l’inflammation, protéine C réactive ou procalcitonine,
est discuté (14). Leur dosage n’est pas recommandé en première intention (2).
Les hémocultures sont systématiques. Il est recommandé de prélever au moins deux
hémocultures aéro-anaérobies :
- une en périphérie et une sur cathéter si un dispositif intraveineux est en place ;
- deux en périphérie, en deux sites différents, en l’absence de cathéter (2).
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%