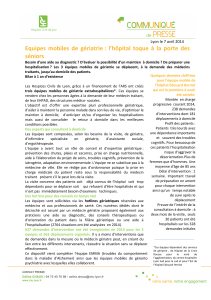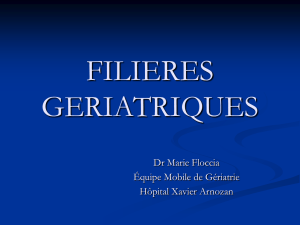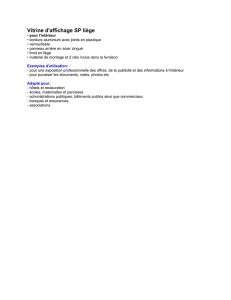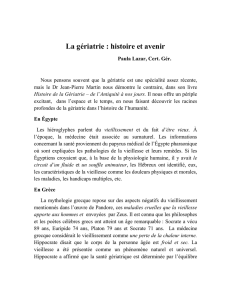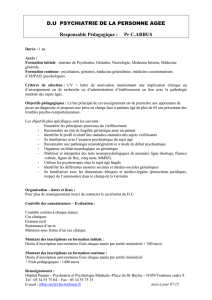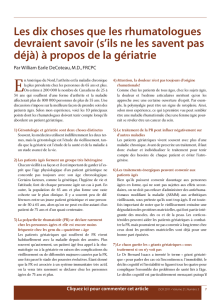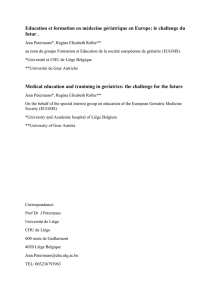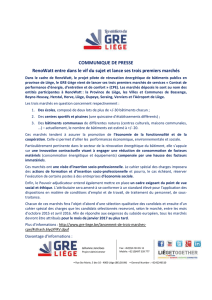Les XVII Journées d`automne de la Société belge de gérontologie et

Journal Identification = PNV Article Identification = 0495 Date: October 6, 2014 Time: 4:13 pm
Congrès
Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2014 ; 12 (suppl´
ement 3) : 1-26
Les XVIIes Journées d’automne de la Société
belge de gérontologie et de gériatrie
(SBGG-BVGG)
Jean Petermans1
Nicolas Berg2
1Past-Président de la SBGG-BVGG
2Secrétaire général de la SBGG-BVGG
Les XVIIes Journées d’automne se dérouleront au Palais des Congrès de
Liège (Belgique), les 17 et 18 octobre 2014.
Diverses sessions sont programmées, comme d’habitude dans un esprit
largement multidisciplinaire :
– Le programme A consacré cette année à diverses affections chroniques fré-
quentes avec l’avancée en âge, et le thème de la douleur sera largement abordé ;
elle intéressera plus spécialement les médecins, qu’ils soient généralistes ou
spécialistes.
– Le programme B intitulé «la gériatrie et ses collaborations....»s’adressera plus
particulièrement à tous les intervenants auprès des personnes âgées, infirmières,
kinés, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, psychologues, médecins...
– Le programme C est destiné aux psychologues, aux psycho-gériatres et aux
intervenants intéressés par les problèmes cognitifs et comportementaux des per-
sonnes âgées. Cette année il abordera les stéréotypes et l’image de la vieillesse.
– Le programme D, conc¸u à partir d’une réflexion initiale du réseau Braises, réseau
inter-universitaire francophone d’experts en vieillissement et du groupe de contact
‘vieillissement’ du FNRS, nourrira le questionnement des multiples acteurs de ter-
rain sensibles aux sciences humaines, comme celui des sociologues, économistes
et autres philosophes et traitera cette année du nouveau statut de protection pour
les personnes incapables.
– Le programme E, nouveauté de cette édition 2014, propose via 4 ateliers des
échanges autour de la prise en charge des patients en hôpital de jour gériatrique
(troubles cognitifs, chute et revalidation, incontinence et oncogériatrie).
Enfin une séance pleinière traitant de la coordination des soins devrait intéresser
l’ensemble des participants à ces journées.
Les différents folders peuvent être obtenus auprès du secrétariat scientifique des
Journées d’automne ([email protected]).
L’ensemble de ces programmes a fait l’objet de diverses demandes
d’accréditation pour les médecins et de reconnaissance de formation continue
pour les responsables de maisons de repos.
doi:10.1684/pnv.2014.0495
Pour citer cet article : Petermans J, Berg N. Les XVIIes Journées d’automne de la Société belge de gérontologie et de gériatrie (SBGG-BVGG). Geriatr
Psychol Neuropsychiatr Vieil 2014; 12(suppl ´
ement 3) :1-26 doi:10.1684/pnv.2014.0495 1

Journal Identification = PNV Article Identification = 0495 Date: October 6, 2014 Time: 4:13 pm
J. Petermans, N. Berg
Communications
Création d’un espace de bien-être : une
expérience menée dans un service de médecine
aiguë, au sein d’un hôpital universitaire
Lahaye A1, Toussaint E2, Colin I3, Berger E4, Guiot S5,
Professeur Schoevaerdts D6
Service de Médecine Gériatrique, CHU Dinant-Godinne,
Belgique
1. Psychologue, 2. Kinésithérapeute, 3. Infirmière,
4. Logopède, 5. Ergothérapeute, 6. Chef du service de
Médecine Gériatrique, CHU Dinant-Godinne, Belgique
Lieu
Service de médecine gériatrique aigu, travaillant en per-
manence en équipe interdisciplinaire et centré sur le projet
du patient après l’hospitalisation.
Objectif
Depuis décembre 2012, nous avons développé un
lieu de détente et d’apaisement afin d’accompagner le
patient et favoriser l’expression des angoisses suscitées par
l’hospitalisation, les maladies et les incertitudes de l’avenir,
de diminuer les comportements d’agitation et d’aider les
personnes en état de dépression.
Depuis 2011, 8 professionnels du service ont suivi des
formations au massage thérapeutique et à l’utilisation des
huiles essentielles. La nécessité de créer un lieu spéci-
fique s’est imposée, afin de pouvoir assurer un meilleur
environnement au patient. Cela permet de pouvoir retirer
la personne d’un environnement parfois très agité et de lui
prodiguer des soins de bien-être dans de meilleures condi-
tions. Ce lieu est destiné à tous les soignants qui pourraient
y assurer une approche plus douce. Les familles parfois
peuvent y trouver un lieu paisible avec leur proche.
Nous avons voulu également, pour les patients ne pou-
vant pas se déplacer, amener certains de ces objets dans la
chambre, dans une armoire à roulettes : des huiles essen-
tielles, de la musique adaptée, des jeux de lumière.
L’objectif global est d’assurer un apaisement, une
diminution des angoisses et donc une diminution des
comportements parfois très agités qu’on rencontre chez
ces patients (maladie d’Alzheimer ou apparentées, confu-
sions), dans un contexte d’hospitalisation courte, donc très
intensive et invasive parfois.
Il est important de souligner que l’ensemble des pro-
fessionnels du service est motivé et sensibilisé à cette
approche, plus douce, qui modifie le rapport au patient dans
tous les actes médicaux posés.
La possibilité de proposer au patient un moment
dans cet espace représente un plus pour l’équipe soi-
gnante qui dispose ainsi d’une solution supplémentaire, non
pharmacologique, pour les difficultés psychologiques des
patients.
Les observations menées à ce jour nous montrent
l’efficacité d’un tel lieu, à la fois pour les patients et pour
les professionnels.
Utilisation d’une console de jeu (Xbox Kinect®)
comme prise en charge kinésithérapeutique
en milieu hospitalier aigu gériatrique :
utile ou futile ?
Delfin Diaz M*, Hubert J**, Rousseau C**, Piron C***,
Dumont C****
Grand Hôpital de Charleroi, site Ste-Thérèse,
Montignies-sur-Sambre, Belgique
*Etudiante en kinésithérapie, **Kinésithérapeute,
*** Infirmière chef de service, **** Médecin Gériatre
Introduction
L’utilisation d’une console de jeux en kinésithérapie
pour réhabiliter un sujet âgé atteint d’un problème médi-
cal aigu pourrait apporter un aspect plus ludique à une prise
en charge parfois contraignante pour le malade en souf-
france. La console de jeux Xbox Kinect®se différencie des
autres consoles par l’absence de manette en permettant
de nombreux exercices sans fixer une concentration inutile
requérant, entre autre, des capacités de double tâche.
L’objectif primaire de cette étude est d’évaluer la faisabi-
lité d’utilisation de ce type de console en milieu hospitalier
aigu. Les objectifs secondaires sont de déterminer l’impact
de ce type de prise en charge sur l’équilibre, la marche, la
force et le bien-être chez les personnes âgées.
Méthode
Il s’agit d’une population de personnes âgées hospitali-
sées en secteur aigu du pôle gériatrique du Grand Hôpital de
Charleroi. A chaque malade hospitalisé capable d’exercice
physique, une prise en charge spécifique a été proposée.
Les sujets consentants ont été assignés de fac¸on aléa-
toire dans deux groupes : un groupe contrôle bénéficiant
de kinésithérapie classique et un groupe Xbox qui, en plus
de la kinésithérapie classique, prenait part aux sessions de
jeux de Bowling Xbox à raison de 3 fois une heure par
semaine. Plusieurs paramètres ont été mesurés avant la
2Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 12, suppl ´
ement 3, octobre 2014

Journal Identification = PNV Article Identification = 0495 Date: October 6, 2014 Time: 4:13 pm
Les XVIIes Journées d’automne de la SBGG-BVGG
prise en charge et en fin d’hospitalisation (Handgrip test,
Time up and go, Echelle de Berg, Barthel, Hospital anxiety
and depression scale (HAD)).
Résultats
Sur une période de 6 semaines, parmi les 153 patients
hospitalisés, 98 (64 %) malades incapables de pratiquer ce
type d’exercice ont été exclus (pathologies aiguës instables,
impotences fonctionnelles non réversibles, atteintes neu-
rologiques graves...). Sur les 55 patients restants, 36 ont
consenti à participer, soit un total de 65,5 % d’acceptation
dans la population «capable ». Le taux total de participation,
tous patients confondus, est de 23,5 % de la population
hospitalisée. L’âge moyen et l’indice de masse corporelle
étaient respectivement pour le groupe contrôle de 83,56 (±
4,76) ans et de 22,62 (±3,92) kg/m2et pour le groupe Xbox
de 85 (±3,47) ans et de 23,38 (±5,9) kg/m2. Une amélio-
ration significative du handgrip (p<0,050), du time up and
go (p= 0,001), de l’échelle de Berg (p=0,001) et de l’HAD
(p= 0,014) a été observée entre la première et la dernière
mesure dans les deux groupes. Il n’y a pas d’amélioration
significative de l’index de Barthel (p= 0,306). Aucune diffé-
rence significative n’a été mise en évidence entre les deux
groupes.
Conclusion
Cette première expérience est très encourageante. Elle
montre en effet, envers une nouvelle technologie plus
ludique, un taux d’acceptation important parmi la population
âgée. Toutefois, un nombre significatif de patients en situa-
tion aiguë reste encore incapable d’y participer. D’autres
études seront nécessaires pour établir, au niveau de la réha-
bilitation, une plus-value clinique de la console. La Xbox
est donc un moyen technique possible à une rééducation
kinésithérapeutique diversifiée et ouvre des perspectives
nouvelles créatives indispensables au monde des seniors...
Des interventions utilisant Internet
pourraient-elles être prometteuses dans le cadre
d’actions de prévention ou de promotion
de la santé chez des femmes ménopausées ?
Slomian J(1,2), Gaspard U(3), Streel S(1,2), Beaudart
C(1,2), Appleboom G(4), Buckinx F(1,2), Reginster
JY(1,2), Bruyère O(1,2)
(1) Département de Santé Publique, Épidémiologie et
Économie de la Santé, Université de Liège, Belgique ;
(2) Unité de Soutien Méthodologique en Épidémio-
logie et en Biostatistiques, Université de Liège,
Belgique ; (3) Service de Gynécologie-Obstétrique du
CHU, Liège, Belgique ; (4) Neurodigital Laboratory,
Columbia University, NY, USA
Situation du problème
Internet est devenu l’un des moyens les plus importants
de s’informer sur sa santé. De nombreuses innovations
dans la santé mobile révolutionnent les soins de santé
actuels. Ces outils constituent une aide pour les médecins
et permettent également de responsabiliser les patients par
rapport à leur santé. Le but de cette étude est d’évaluer
l’intérêt des femmes aux alentours de la ménopause ainsi
que leur degré d’utilisation d’Internet pour des questions
de santé. Il s’agit de résultats préliminaires à l’exploitation
d’un réseau social dédié à cette population dans le domaine
de la santé.
Matériel et méthode
Des questionnaires auto-administrés ont été distribués
afin de récolter les informations nécessaires : une partie
des patientes a été recrutée au centre de la ménopause de
la clinique Ste Rosalie (Liège) et l’autre partie, par courrier,
depuis la base de données de gynécologie de la polycli-
nique Lucien Brull (Liège) d’après leur date de naissance
(<1968).
Résultats
95 patientes ont répondu à ce sondage. La moyenne
d’âge des femmes interrogées est de 59,7 ±8,07 ans ;
47,4 % d’entre elles sont encore actives professionnelle-
ment. Parmi ces femmes, 88,4 % utilisent Internet dont
51,8 % tous les jours et 91 % au moins deux à trois fois
par semaine. Un peu plus de trois quarts des femmes pré-
sentent au moins un problème de santé. Dans la population,
88,9 % des femmes déclarent rechercher des informa-
tions supplémentaires à celles données par leur médecin
et 69,6 % d’entre elles affirment utiliser Internet pour
s’informer sur leur santé. Elles attribuent, en moyenne,
une note de 5,6 ±2,1/10 quant à la fiabilité des infor-
mations issues d’Internet. Le statut socio-économique,
notamment le niveau d’étude (p = 0,03) et le statut profes-
sionnel (p = 0,02), semble avoir une influence sur l’utilisation
d’internet. L’âge influence également son utilisation : ceux
qui utilisent internet sont plus jeunes (58,8 ±7,69 ans) que
ceux qui ne l’utilisent pas (65,7 ±8,39 ans) (p = 0,01). Le
nombre de problèmes de santé ne semble pas avoir un
impact sur l’utilisation d’internet quant à la santé.
Discussion et conclusion
Internet et les nouvelles technologies sont de plus en
plus répandus. Les femmes ménopausées semblent avoir
besoin d’être informées sur leur santé. Des interventions
adaptées, essentiellement à l’âge et au statut socio-
économique, et structurées utilisant Internet pourraient
Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 12, suppl ´
ement 3, octobre 2014 3

Journal Identification = PNV Article Identification = 0495 Date: October 6, 2014 Time: 4:13 pm
J. Petermans, N. Berg
être une bonne solution pour informer et conscientiser les
femmes quant à leur santé étant donné que, dans cette
population, quasiment 90 % des femmes utilisent Internet
et que 70 % d’entre elles le font déjà pour obtenir des
renseignements sur leur santé.
Détection de la sarcopénie en utilisant le BelRAI,
un outil d’évaluation gériatrique globale
Kayembe B1, De Dobbeleer L1,2, Desmaele S3,
Cakici N1, Ekinci H1, Bautmans I2,BeyerI
1,2
1Service de Gériatrie, UZ Brussel, Jette ;
2FRIA Research group ; 3Service de Pharmacologie
Clinique (Vrije Universiteit Brussel), Belgique
Introduction
La sarcopénie, perte de masse et de force musculaire,
fragilise la personne âgée et favorise la perte d’autonomie.
Sa détection est essentielle et un consensus Européen
de critères de diagnostic a été publié (Cruz-Jentoft ea,
2010). Néanmoins ces critères, qui ne détectent la sarco-
pénie qu’en cas de répercussion fonctionnelle, ne sont pas
encore implémentés et la sarcopénie reste généralement
non détectée en clinique courante. L’objectif de cette étude
pilote était d’évaluer la possibilité de détecter la sarcopé-
nie par l’évaluation gériatrique globale en utilisant la version
belge du Resident Assessment Instrument (BelRAI) dont
l’utilisation au travers des différents lieux de soins est anti-
cipée en Belgique.
Matériel et méthodes
Patients successifs provenant de différentes cohortes
prospectives : gériatrie aiguë et subaiguë, orthopédie, cabi-
net de généraliste. Inclusion : âge >60 ans, consentement
éclairé. Exclusion : pacemaker, incapacité à réaliser les
tests. Évaluation (indépendante des équipes soignantes)
par BelRAI (Pyxicare®, Pyxima nv), force de préhension
maximale (Martin Vigorimeter) et masse musculaire par bio-
impédance (Bodystat®QuadScan 4000). Statistiques non
paramétriques par SPSS 22.0 (IBM).
Résultats
61 patients (32 hommes, 39 femmes, âge moyen
80 ans) des services de gériatrie (n = 25), d’orthopédie (n
= 11) et de médecine générale (n = 25) ont été inclus.
Sur base de la masse musculaire (Janssen ea, 2000) 30
patients (49 %) étaient sarcopéniques. Les patients hospi-
talisés présentaient significantivement plus de sarcopénie
que les patients du domicile (p <0,001), de même que les
patients admis pour fracture de hanche (p = 0,021) et les
patients constipés (p <0,011).
42 patients (69 %) avaient une faiblesse musculaire (cri-
tères de Merkies ; Bautmans ea, 2009). toutefois sans dif-
férence significative entre patients sarcopéniques ou non.
La vitesse de marche a été mesurée et située entre 1
et 30 secondes chez 42 patients (69 %). 32 patients mar-
chaient moins vite que 0,8 m/s, dont 50 % présentaient
une sarcopénie. Aucun cas de sarcopénie n’a été décelé
chez les plus rapides. Aucun patient dépassait une vitesse
de 1 m/s. La vitesse de marche était signifcativement plus
lente en présence de sarcopénie (p = 0,007), mais non en
présence de faible force de préhension.
Conclusion
L’évaluation par BelRAI comprenant la vitesse de
marche sur4mdevrait permettre de détecter plus systéma-
tiquemnt les patients à risque de sarcopénie. La valeur seuil
de 0,8 m/s (Cruz-Jentoft) pour la vitesse de marche (Bel-
RAI item G3b) apparaît comme plus discrimante que 1 m/s
(Fielding ea, 2011) dans notre cohorte. La force de préhen-
sion était peu discriminative. Par ailleurs l’hospitalisation
(item A7), la fracture de hanche récente (item I1a) et la
constipation (item J3l) étaient associées à une présence
plus fréquente de sarcopénie. Une étude plus large pourrait
permettre d’établir un profil de risque afin de mieux cibler
les investigations complémentaires.
Étude du lien entre évaluation de la charge
de travail en soins requis et dotation
en personnel infirmier, soignant
et logistique en unités de gériatrie
Dehaye Ch1, Hans S2, Lesage V3
1Infirmière, Chef de service de Gériatrie, Centres
Hospitaliers Jolimont, Belgique ; 2Infirmière, Haute
Ecole de Louvain en Hainaut (HELHa), Belgique ;
3Gériatre, service de Gériatrie, Centres Hospitaliers
Jolimont, Belgique
Situation du problème
Cette étude a vu le jour au départ d’un questionnement
en qualité d’infirmière en chef : comment évaluer la charge
de travail afin de répartir au mieux les ressources dispo-
nibles tout en garantissant une qualité de soins optimale ?
De cette question est né un objectif principal : démon-
trer que la charge de travail en gériatrie est importante et
voir si la dotation en personnel infirmier et soignant actuelle
permet d’y faire face.
Matériel et méthode
Pour pouvoir répondre à cet objectif, nous devions abso-
lument trouver un outil de recherche permettant de mesurer
la charge de travail en termes de soins requis.
4Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 12, suppl ´
ement 3, octobre 2014

Journal Identification = PNV Article Identification = 0495 Date: October 6, 2014 Time: 4:13 pm
Les XVIIes Journées d’automne de la SBGG-BVGG
L’outil de mesure utilisé pour étudier la charge de travail
est l’outil validé PLAISIR®mesurant la demande en soins
requis.
Cette recherche va nous permettre de confirmer
l’hypothèse de recherche de départ qui est la suivante : une
évaluation de la charge de travail permet de fixer la dotation
journalière en personnel infirmier, soignant et logistique au
sein de deux unités de gériatrie d’une institution hospitalière
de la province du Hainaut.
Après avoir suivi une formation théorique et pratique
avec Mr Charles Tilquin, directeur de recherche et Mme
Bibiane Roussel, infirmière de l’Equipe de Recherche Opé-
rationnelle en Santé (Eros), nous avons analysé le profil
de 56 patients, séjournant pour moitié des deux unités de
gériatrie de l’institution.
Résultats
Cette analyse nous a permis de relever les principaux
résultats suivants :
– Le profil bio-psycho-social des patients est important à
étudier pour l’évaluation de la charge de travail, mais aussi
pour l’élaboration du plan de soins ;
– Les soins directs et indirects, à savoir les soins de base,
les soins relationnels et éducatifs et les soins techniques
constituent 73 % de la demande des soins requis ;
– D’autres tâches viennent s’ajouter telles que les tâches
administratives, l’entretien, les déplacements et autres
tâches de l’infirmière en chef, qui constituent 12,5 % de
la demande en soins requis ainsi que les communications
qui représentent 15,5%decettedemande.
Discussion
Ces résultats nous permettent de confirmer notre hypo-
thèse de départ.
En effet, les résultats viennent parfois conforter les faits
observés nous ayant amené à cette recherche en qualité
d’infirmière chef : le nombre de départs du personnel pour
d’autres unités de soins, la fatigue du personnel qui se sent
de moins en moins autonome, oppressé par le poids des
soins et le temps limité qui lui est imparti pour prodiguer
ces soins.
Conclusion
Cette étude met en exergue que la dotation en per-
sonnel actuelle est insuffisante, hypothéquant de facto la
qualité des soins : «la qualité n’est jamais un accident ; c’est
toujours le résultat d’un effort intelligent »(John Reskins,
poète et écrivain britannique du XIXesiècle).
Quelque chose d’intime entre nous
Goldoni C*, Debroux A*, Hermant P*, Pierret E*,
Deloison A*, Latteur V**, Betumvuko P**, C. Losseau
C**, Gomez P*, Bleeckx D***, Dumont C**
Grand Hôpital de Charleroi, Site Ste-Thérèse, Belgique
*Psychologue, **Médecin Gériatre, ***Directeur
Paramédical
Contexte et but
La pétition «Farfadoc »relative aux blouses d’hôpital
nous a interpellés. En effet, elle illustre l’idée que l’intimité
aurait tendance à se décliner voire se décimer dans le
milieu hospitalier. Le secteur gériatrique n’échappe pas à
ce constat et est confronté à la place accordée -ou pas-
à l’intimité de nos aînés. Dès lors, des psychologues de
gériatrie ont élaboré un jeu visant à sensibiliser les équipes
soignantes aux questions relevant de «l’intime ». Ce jeu est
inspiré de celui des «sept familles »ainsi que des résultats
des travaux de recherche de Pascal Janne qui décrivent dix
intimités conjugales.
Matériel et méthode
Une attention particulière veillait à sensibiliser les parti-
cipants aux différentes facettes et richesses de l’intimité
qui ne pouvait se réduire au sens commun d’une proxi-
mité voire promiscuité sexuelle. L’outil a donc été conc¸u
de fac¸on à ce que chaque famille corresponde à une facette
de l’intimité, le but du jeu étant d’en reconstituer le plus
grand nombre. Les quatre «membres »d’une famille sont
représentés par un terme, une œuvre et pour certains une
citation, facilitant ainsi la mémorisation et la verbalisation
des joueurs. Certaines cartes sont obtenues qu’après avoir
répondu correctement à une question relative à l’intimité.
Le jeu se déroule en équipes pluridisciplinaires. Enfin, afin
d’agir sur les comportements, des «cartes chances »qui
récompensent ou pénalisent des comportements de soi-
gnants ont été ajoutées.
Résultats et discussion
D’abord, il est observé que la multiplicité des facettes
de l’intimité est, dans la totalité des cas, bien perc¸ue par les
joueurs. Le jeu ouvre également la discussion et la réflexion
entre participants.
Ensuite, il est aussi noté que la pluridisciplinarité des
équipes de jeu est un atout sans en être indispensable.
L’évaluation des effets durables du jeu sur les comporte-
ments de soin semble toutefois être l’écueil le plus impor-
tant. Enfin, il nous semble essentiel, pour l’avenir, de pou-
voir asseoir cette réflexion sur des fondements théoriques,
Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 12, suppl ´
ement 3, octobre 2014 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%