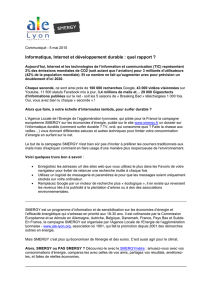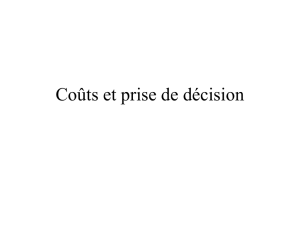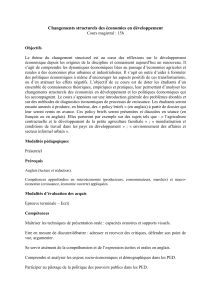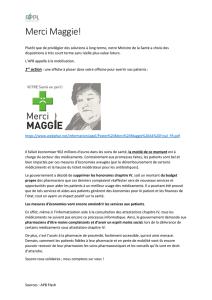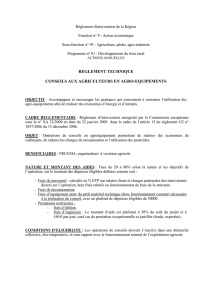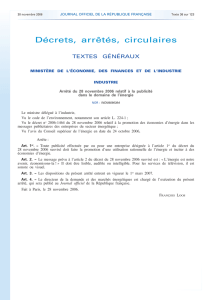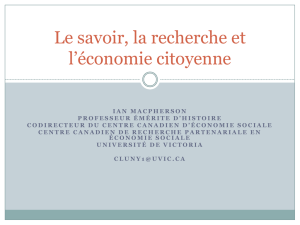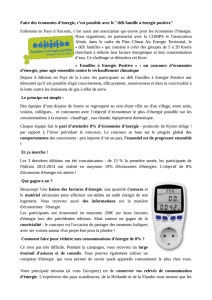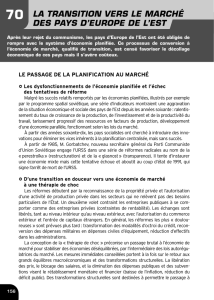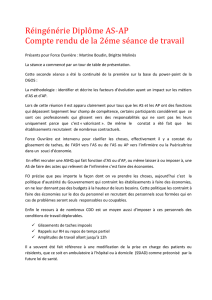Économies d`échelle et agglomération

CHAPITRE 4 Économies d’échelle
et agglomération
L’exemple le plus célèbre en économie est
peut être aussi le plus simple. À la pre-
mière page de son ouvrage « La richesse
des nations » publié en 1776, Adam Smith van-
taient les bénéfices de la division du travail dans
la fabrication d’épingles. Un seul ouvrier non
qualifié, sans l’utilisation de machines, pouvait
fabriquer probablement moins de 20 épingles
par jour. Mais dans une usine d’épingles que
Smith a visitée, 10 ouvriers qui se répartissaient
les 18 opérations de fabrication d’une épingle
produisaient 48 000 épingles par jour. Plutôt que
de lutter pour fabriquer péniblement seulement
quelques épingles par jour, chaque ouvrier en
produisait près de 5 000. Plus loin dans l’ouvrage
classique de Smith, on retrouve deux réserves
importantes : (1) les gains de la division du tra-
vail sont limités par la taille du marché et (2)
toutes les activités n’affichent pas des rendements
d’échelle croissants.
La possibilité de transporter des produits
élargit le marché, et les villes sont donc situées
à proximité des systèmes de transports les plus
naturels et les plus efficaces — les voies navi-
gables. Les lieux ayant la chance de disposer
de cette infrastructure naturelle s’en sortent
souvent bien, tandis que d’autres lieux doivent
attendre leur heure. Ainsi que l’écrivait Smith :
« Il n’existe en Afrique aucune grande mer
comme la Baltique ou l’Adriatique en Europe,
la Méditerranée ou l’Euxine en Europe et en
Asie, et les golfes d’Arabie, de Perse, d’Inde, du
Bengale et de Siam en Asie, pour transporter le
commerce maritime dans les parties situées à
l’intérieur de ce grand continent, et les grands
fleuves d’Afrique sont trop éloignés entre eux
pour permettre une navigation importante à
l’intérieur des terres ». 1
De plus, toutes les activités ne présentent
pas des économies d’échelle et certaines n’ont
pas besoin de grands marchés pour prospérer.
L’agriculture de subsistance est une de ces acti-
vités, menée de manière fructueuse dans les
villages. Toutefois, les activités comme la fabri-
cation de produits et le commerce ne peuvent
être menées que dans de plus grandes agglomé-
rations, car elles nécessitent l’accès à la fois aux
travailleurs et aux clients.
Malgré ces considérations, les bénéfices de la
production en grandes quantités dans une seule
usine ou en un seul lieu se sont accrus suite à la
baisse continue des coûts de transport au cours
des deux siècles qui ont suivi la visite de Smith
dans cette usine d’épingles. Ceux qui dou-
tent du potentiel considérable des économies
d’échelle et de la façon dont l’accès aux marchés
mondiaux permet de les exploiter devraient
visiter Dongguan, une ville située à mi-chemin
entre Guangzhou et Shenzen dans le sud-est de
la Chine. Jusque dans les années 80, elle n’était
qu’un ensemble de paisibles villages du delta de
la rivière des Perles. Depuis, elle s’est engagée
sur la voie des rendements d’échelle croissants
(voir l’encadré 4.1). Chaque année, des millions
de personnes, dans les pays en développement,
pénètrent dans ce nouveau domaine, et les
implications que cela représente, tant pour eux
que pour les décideurs, sont tout simplement
révolutionnaires.
Ce chapitre résume l’expérience des entre-
preneurs au cours des deux derniers siècles dans
l’exploitation des économies d’échelle dans les
activités de production. Il se concentre sur les
« économies d’agglomération », dont l’exploi-
tation nécessite une installation dans des zones
où la densité d’autres producteurs est élevée. Il
fournit aussi un bref résumé de deux décennies
de travaux par des économistes cherchant à
comprendre ces économies d’échelle, des tra-
vaux qui ont permis de réduire le fossé entre
la recherche et le monde réel et de générer des
vues valables en matière de politiques à suivre.
126

Économie d’échelle et agglomération 127
ENCADRÉ 4.1 Les économies d’échelle dans un monde presque irréel : l’histoire de Dongguan en Chine.
En 1978, ce qui est aujourd’hui la ville de Dong-
guan dans la province de Guangdong en Chine
n’était qu’un ensemble de villages et de petites
villes s’étendant sur 2 500 kilomètres carrés sur
la rivière des Perles, à mi-chemin entre Guang-
zhou au Nord et Shenzhen et Hong Kong
(Chine) au sud. Les 400 000 habitants de la
région vivaient de la pêche et de l’agriculture
et, sans être la région la plus pauvre de Chine,
ce n’était pas non plus la plus prospère.
Aujourd’hui, Dongguan comporte environ
7 millions d’habitants. Plus de 5 millions d’en-
tre eux sont des migrants qui travaillent dans
les milliers d’usines qui parsèment la ville,
produisant en série une grande variété de
produits, en quantités tellement importantes
que les comptes-rendus récents des médias
ont conféré à Dongguan l’étiquette d’« atelier
du monde. » L’économie de Dongguan s’est
développée à une cadence de plus de 20 %
par an depuis 1980, et en 2004 son produit
intérieur brut (PIB) était d’environ 14 milliards
de dollars — dépassant celui de l’Islande. Si
l’on compte uniquement les résidents urbains
(comme l’indiquent les statistiques ocielles),
le PIB de 9 000 dollars par habitant de Dong-
guan en 2004 fait d’elle la ville la plus riche de
Chine. Même si la population uctuante de
travailleurs migrants de la ville est incluse, son
PIB par habitant en 2004 reste supérieur à 2
000 dollars. Le développement de Dongguan
depuis les années 70, et en particulier durant
la dernière décennie, exemplie (peut-être
de manière exagérée) les forces économiques
qui sont en train de façonner les économies à
revenus intermédiaires de l’Asie de l’Est (voir le
tableau ci-dessous).
La situation géographique et des coûts
de facteurs favorables ont indubitablement
encouragé la croissance précoce de Dong-
guan. Pendant les 10 ans et demi qui ont suivi
le début des réformes en Chine, les petites et
moyennes entreprises de Hong Kong (Chine)
et de Taiwan (Chine) ont été attirées par Dong-
guan par l’ore abondante de terres et de
main-d’œuvre bon marché, et par sa proximité
avec Guangzhou et Hong Kong (Chine). Malgré
ces facteurs favorables, la croissance rapide de
Dongguan dans les années 90 peut être mieux
comprise par les économies d’échelle, tant au
niveau de la production de produits intermé-
diaires que de produits diérenciés, et par les
eets d’agglomération, tant dans le même
secteur de fabrication qu’à travers diérents
secteurs de l’industrie. Associé aux réductions
des coûts de transport et des améliorations
logistiques, le progrès technologique démon-
tre que ces eets ont émergé comme des
caractéristiques importantes de la production
mondiale.
Les économies d’échelle internes sont évi-
dentes. En 2005, une seule usine de Dongguan
a fabriqué plus de 30 % des têtes d’enregistre-
ment magnétiques utilisées pour les disques
durs à travers le monde. Une autre a produit
60 % des appareils électroniques d’appren-
tissage vendus sur le marché américain. Une
troisième a produit près de 30 millions de télé-
phones portables, c’est-à-dire assez pour équi-
per chaque homme, chaque femme et chaque
enfant du Pérou ou du Venezuela.
L’agglomération et les économies d’échelle
externes sont toutes deux visibles. Les retom-
bées de connaissances et les coûts réduits de
logistique résultant d’une installation près des
fournisseurs d’intrants et des exportateurs ont
produit des industries d’importance mondiale
pour les secteurs des laines tricotées, des
chaussures, des meubles et des jouets. Mais
le regroupement qui domine le paysage éco-
nomique de Dongguan depuis le milieu des
années 90 est celui des télécommunications,
de l’électronique et des composants informati-
ques. Sur les pièces et composants utilisés dans
la fabrication et le traitement des ordinateurs
personnels, 95 % proviennent de la ville de
Dongguan et, pour plusieurs produits, les usi-
nes de Dongguan représentent plus de 40 %
de leur production totale mondiale.
Contribution de Shubham Chaudhuri.
Source : Gill & Kharas, 2007.
Dongguan en chiffres
Croissance moyenne annuelle du PIB, 1980–2005 (%) 22,0 PIB (milliards de dollars EU) 14,2
Population : résidents enregistrés (millions) 1,6 Population : totale, estimée (millions) 7,0
PIB par résident enregistré (dollars EU) 8 999 PIB par habitant (dollars EU) 2 070
Exportations (milliards de dollars EU) 35,2 Importations (milliards de dollars EU) 29,3
Revenus publics (dollars EU) 1,0 Dépenses publiques (milliards de dollars EU) 1,2
Consommation d’électricité (milliards de kWh) 35,2 Consommation d’eau (milliards de pieds cubes) 1,5
Indicateurs d’impact sur l’environnement
Émission du dioxyde de soufre (milliers de tonnes) 199,4 Eaux industrielles usées (millions de tonnes) 225
Émissions de dioxyde de soufre conformes aux normes (%) 92,9 Évacuation d’eaux industrielles conformes aux normes (%) 90,1
Déchets industriels solides (milliers de tonnes) 28,6 Déchets solides industriels conformes aux normes (%) 86,5
Part du marché mondial en 2002 de composants informatiques et électroniques fabriqués à Dongguan (%)
Têtes magnétiques, boîtiers d’ordinateurs 40 Appareils de numérisation et mini-moteurs 20
Cartes en cuivre et lecteurs de disques 30 Claviers 16
Condensateurs de courant alternatif et transformateurs de
bascule de remise à zéro 25 Cartes-mères 15
Source : Gouvernement de Dongguan, 2005.

128 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LE MONDE 2009
effectuées au cours de la dernière génération
indiquent que différentes formes d’établisse-
ments de personnes facilitent les économies
d’agglomération pour différents types de
production. D’après une généralisation un
peu trop simplifiée (mais pas complètement
inexacte), les agglomérations avec des mar-
chés facilitent les économies d’échelle à tra-
vers la commercialisation et la distribution
des produits agricoles, les villes moyennes
procurent aux industries manufacturières
des économies de localisation, et les villes les
plus grandes fournissent différentes facilités
et encouragent l’innovation dans le com-
merce, les services publics et l’éducation.
• Les décideurs ont souvent mal évalué le
potentiel des forces du marché. De nom-
breux décideurs perçoivent les villes comme
des constructions de l’État — destinées à
être gérées et manipulées pour remplir de
quelconques objectifs sociaux. Les grandes
agglomérations et les villes, tout comme les
entreprises et les exploitations agricoles, sont
des créations du marché. De même que les
entreprises et exploitations agricoles four-
nissent des biens et des services finaux et
intermédiaires, les villes et agglomérations
procurent des économies d’agglomération
aux producteurs et aux travailleurs. Il va
Et enfin, il tente d’établir si les décideurs poli-
tiques du monde en développement ont tiré un
enseignement de cette expérience et de cette
analyse.
Les principales constatations sont les
suivantes :
• Les économies en développement sont entrent
dans une nouvelle dimension de l’agglomé-
ration. Un siècle d’expérience montre qu’à
mesure que les pays se développent, passant
d’une production d’abord orientée vers l’agri-
culture à l’industrie, puis aux services, les
entrepreneurs et les travailleurs laissent der-
rière eux non seulement leurs villages et leurs
activités agraires mais aussi un monde dans
lequel l’échelle n’a pas beaucoup d’impor-
tance. Un nombre toujours plus important
d’entre eux intègre non seulement des éta-
blissements plus grands et plus denses, mais
aussi un monde où l’échelle compte — des
endroits où la production et la distribution
bénéficient d’économies d’échelle, en parti-
culier celles associées à des lieux donnés. La
proximité est importante non seulement pour
l’accès aux marchés des biens et services mais
également pour l’accès aux idées.
• Une variété d’endroits est nécessaire pour
la croissance économique. Les recherches
Tableau 4.1 Une douzaine d’économies d’échelle
Type d’économie d’échelle Exemple
Interne
1. Pécuniaire Pouvoir acheter des intrants intermédiaires avec des réductions en fonction des
quantités.
Technologique 2. De technologie statique Baisse des coûts moyens grâce aux frais fixes d’exploitation d’une usine.
3. De technologie dynamique Apprendre à exploiter une usine plus efficacement au fil du temps.
Externe ou
d’agglomération
De localisation
Statique
4. « Achats » Les acheteurs sont attirés vers des lieux qui rassemblent plusieurs vendeurs.
5. Spécialisation
« Adam Smith » La sous-traitance permet aux fournisseurs d’intrants en amont et aux entreprises en aval
de bénéficier des gains de productivité grâce à la spécialisation.
6. Mise en commun de la
main-d’œuvre « Marshall » Les travailleurs aux compétences spécifiques d’une industrie sont attirés vers les lieux où
la concentration est plus importante.a
Dynamique 7. Apprendre par la pratique.
« Marshall-Arrow-Romer » La réduction des coûts résultant d’une activité de production répétée et continue dans le
temps dont les bénéfices retombent dans le même endroit.
D’urbanisation
Statique
8. Innovation « Jane Jacobs » Le plus des choses diversifiées sont faites localement, plus grande est l’opportunité
d’observer et d’adapter des idées des autres.
9. Mise en commun de la
main-d’œuvre « Marshall »
Les travailleurs d’une industrie apportent des innovations aux entreprises d’autres
industries ; semblable au no.6 mais le bénéfice résulte de la diversité des industries sur
un même lieu.
10. Division du travail « Adam
Smith » Semblable au no.5 ci-dessus, la principale différence étant que la division du travail est
rendue possible par la présence de plusieurs industries acheteuses au même endroit.
Dynamique 11. « Romer » croissance
endogène
Plus le marché est grand, plus le profit est élevé, plus la localisation attire, plus les
emplois sont nombreux, plus les pools de main-d’œuvre sont nombreux, plus le marché
est grand – et ainsi de suite.
12. D’agglomération « pure » Répartition des frais fixes d’infrastructure à un plus grand nombre de contribuables, les
déséconomies résultent de la congestion et de la pollution.
Source : Adaptation à partir de Kilkenny 2006.
a. Pour une formalisation, voir Krugman (1991a), chapitre 2 et annexe C.

Économie d’échelle et agglomération 129
donc de l’intérêt des administrateurs des
villes de mieux s’informer sur ce que fait
leur ville et de l’aider à bien le faire plutôt
que d’essayer de modifier brusquement sa
destinée. Les planificateurs et les décideurs
politiques doivent considérer leur rôle de res-
ponsables prudents d’une variété d’endroits,
afin de tirer le maximum des économies
d’agglomération.
Ce chapitre traite d’une manière générale
des implications des expériences et des analyses
de réorganisation des stratégies d’urbanisation
dans le monde en développement. Le chapitre 7
poursuit cette tâche de recadrage du débat sur
les stratégies urbaines.
Guide d’introduction aux économies
d’agglomération
Les bénéfices de l’augmentation de l’échelle
peuvent être internes ou externes à une entre-
prise ou exploitation agricole individuelle. Les
économies externes sont synonymes d’« écono-
mies d’agglomération », qui comprennent les
bénéfices de la localisation (se trouver à proxi-
mité des autres producteurs du même produit
ou service) et de l’urbanisation (se trouver à
proximité d’autres producteurs d’une large
gamme de biens et de services). Les externalités
de consommation aussi sont associées à l’agglo-
mération mais elles n’ont pas encore fait l’objet
de suffisamment d’études. 2 Ainsi donc, ce cha-
pitre traite donc des économies d’échelle liées à
la production (voir le tableau 4.1). 3
• Les économies internes résultent de la grande
taille des usines, qui leur permet de mieux
exploiter les coûts fixes (voir 1 à 3 dans le
tableau 4.1). Une grande aciérie peut obte-
nir de ses fournisseurs des réductions sur
les volumes achetés — ce qui implique des
coûts fixes de transport et d’échange — et
engranger les bénéfices de la division du tra-
vail dans l’entreprise.
• Les économies de localisation proviennent
de la présence d’un plus grand nombre d’en-
treprises de la même industrie au même
endroit (voir 4 à 7 dans le tableau 4.1). La
proximité spatiale aide, car l’accès immédiat
aux concurrents du même secteur permet
aux entreprises de se tenir au courant des
informations du marché dans les négocia-
tions avec les clients et les fournisseurs. 4 Les
entreprises qui se regroupent peuvent aussi
se partager un pool de main-d’œuvre spécia-
lisée plus important et fiable.
• Les économies d’urbanisation résultent de la
présence d’un grand nombre d’entreprises de
ENCADRÉ 4.2 Partage, adéquation et apprentissage
Trois raisons expliquent pourquoi les
entreprises d’une industrie particulière se
situent souvent les unes près des autres.
Partage• —L’élargissement du mar-
ché des fournisseurs d’intrants leur
permet d’exploiter les économies
d’échelle internes en production (les
coûts moyens baissent à mesure que
le niveau de production augmente).
Ce partage des intrants permet égale-
ment aux fournisseurs d’orir des biens
et services adaptés aux besoins des
acheteurs. Il en résulte des prots plus
élevés pour tous, accompagnés d’un
accès plus facile à une variété d’intrants
plus grande.
Appariement• —L’extension de la
disponibilité de la variété de compé-
tences requises par les employeurs
pour faciliter un meilleur appariement
avec les diérents besoins. En même
temps, il devient moins risqué pour
les travailleurs de se trouver dans des
endroits qui rassemblent de nombreux
employeurs potentiels.
Apprentissage• —L’accélération des
retombées de connaissance et la
possibilité pour les travailleurs et les
entrepreneurs d’apprendre les uns
des autres. La capacité d’aller au-delà
du partage, de l’appariement et de
l’apprentissage spéciques à une
industrie (économies de localisation)
vers des processus à l’échelle de la ville
(économies d’urbanisation) nécessite
des mécanismes supplémentaires.
Ces mécanismes comprennent les
eets de causalité cumulative et l’in-
terpénétration de la production et des
échanges entre les industries. Sont
aussi compris les gains provenant des
échanges d’idées. La concentration des
travailleurs et des fournisseurs conduit
à une concentration de la demande des
consommateurs.
Si les économies d’échelle sont grandes
et non épuisées et si les entreprises peu-
vent se concurrencer non seulement sur
le prix mais aussi par la diérentiation des
produits, des forces centripètes puissantes
entrent en jeu. De plus, en introduisant
formellement la distance (le coût d’ex-
pédition des intrants et des sortants), le
cadre utilisé dans ce Rapport procure des
idées utiles des forces centrifuges qui
expliquent la dispersion spatiale dans un
pays. Généralement parlant, la dominance
(primauté) de l’une ou de quelques zones
métropolitaines d’un pays, s’accroit si
les bénéces des économies d’échelle
sont importants par rapport aux coûts de
transport.
Sources : Gill et Kharas (2007), basé sur Duran-
ton et Puga (2004).
secteurs différents dans un même lieu (voir
le tableau 4.1 de 8 à 11). Par exemple, une
société de conseil en gestion peut bénéficier
de sa situation à proximité d’écoles de com-
merce, de prestataires de services financiers
et de fabricants.
Les économies d’agglomération ne dépen-
dent pas que de la taille (une grande ville ou
industrie), mais aussi des interactions urbaines.
Elles sont traditionnellement classées comme
économies de localisation issues d’interactions
économiques intra-branches et comme éco-
nomies d’urbanisation, issues d’interactions
entre industries. 5 Les raisons pour lesquelles
les producteurs bénéficient de leur proximité
aux autres producteurs dépendent du partage
des intrants en équipements, de l’information
et de la main-d’œuvre. Elles dépendent aussi
de l’amélioration de l’adéquation entre les exi-
gences de production et les types de terres, de
main-d’œuvre et d’intrants intermédiaires — et
de l’apprentissage de nouvelles techniques et de
nouveaux produits (voir l’encadré 4.2).

130 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LE MONDE 2009
produits chimiques, l’appareillage, l’ingénierie
et le papier et l’impression. Dans la catégorie de
produits à 3 chiffres, les rendements d’échelle
les plus importants sont obtenus avec les livres,
la briqueterie, les colorants et les avions. 6 À
l’opposé, les économies d’échelle internes sont
négligeables dans le caoutchouc et les plastiques,
le cuir et les produits du cuir, les vêtements et
chaussures et le textile. 7
Sur la base des estimations des coûts et de la
valeur ajoutée, différentes sources indiquent des
conclusions similaires. En Norvège, un échan-
tillon de 5 000 entreprises manufacturières
fournit des indications d’économies d’échelle
au niveau de l’industrie individuelle. 8 Pour
les industries canadiennes à quatre chiffres, les
rendements d’échelle atteignent en moyenne
10 % pour 107 secteurs manufacturiers, avec
l’habillement, les produits tricotés, le cuir et les
textiles tout en bas du spectre. 9 L’augmentation
de la production réduit les coûts dans le secteur
manufacturier des États-Unis, dans les indus-
tries des pays à revenus intermédiaires (Chili) et
dans les industries européennes de l’automobile,
des véhicules lourds et des biens de consomma-
tion durables. 10, 11
Sur la base des données relatives aux échan-
ges, un tiers des industries de production de
biens affichent des rendements d’échelle crois-
sants. 12, 13 Les industries manufacturières avec
des économies supérieures (au niveau des usines
mêmes) et des externalités au niveau de l’indus-
trie sont les produits pétroliers et les produits
charbonniers, le raffinage de produits pétroliers,
les produits pharmaceutiques, l’équipement, le
fer et l’acier. Les industries avec des rendements
constants comprennent la chaussure, le cuir, le
textile, l’habillement et le mobilier.
Les marges constituent une autre source
d’information. La croissance des rendements
d’échelle conférant aux entreprises le pouvoir
sur le marché, les majorations de prix au-delà
des coûts marginaux peuvent constituer un
indicateur des économies d’échelle au niveau de
l’unité de production. Les études indiquent une
fourchette de marge pour les manufactures aux
États-Unis allant de 15 % dans l’habillement à
plus de 200 % dans les services d’électricité, de
gaz et sanitaires. Pour 36 secteurs manufactu-
riers à travers 19 pays membres de l’Organisa-
tion pour la coopération et le développement
économiques (OCDE), les plus fortes marges
sont celles sur le tabac, les médicaments, et les
équipements de bureau et d’informatique —, les
plus faibles étant celles sur les chaussures, l’ha-
billement et les produits en bois. 14
Si les données sur le secteur manufacturier
font l’objet de la considération la plus forte,
Les économies d’échelle internes sont plus
élevées dans les industries lourdes
On observe des rendements d’échelle internes
croissants dans la fabrication, basés sur différen-
tes sources de données. Les économies d’échelle
internes vont d’un niveau négligeable ou faible
dans les industries légères à un niveau élevé
dans les industries lourdes et de haute techno-
logie (voir le tableau 4.2). Sur base d’estimations
du domaine du génie civil, un résumé d’études
spécifiques à des secteurs précis qui examine
l’échelle de production et d’économie de coûts
d’efficience minimum conclut à des rendements
croissants significatifs pour les véhicules à
moteur, les autres équipements de transport, les
Tableau 4.2 Les économies d’échelle internes sont faibles dans les industries légères et élevées
dans les industries lourdes
Constatations Source des données
Rendements d’échelle constants : vêtements, cuir,
chaussures, textile, produits en bois
Rendements d’échelle à forte croissance : machines,
produits pharmaceutiques, instruments, fer et acier,
pétrole et produits charbonniers
Basé sur les données d’échanges (Antweiler &
Trefler, 2002).
Rendements d’échelle constants ou rendements
d’échelle à croissance faible : produits en cuir,
chaussures et habillement, bois et textiles
Rendements d’échelles à forte croissance : véhicules à
moteur, autres moyens de transport, produits chimiques,
ingénierie, imprimerie et publications
Basé sur des estimations d’ingénierie destinées
à examiner les gradients et changements des
coûts à l’échelle d’efficience minimum (Junius,
1997, citant Prateen, 1988, et Emerson et al.,
1988)
Rendements d’échelle à faible croissance : chaussure,
vêtements, produits alimentaires, cuir
Rendements d’échelle à forte croissance : tabac,
produits pharmaceutiques, équipement de bureau et
informatique, équipement ferroviaire
Basé sur les marges d’industries
manufacturières dans 14 pays de l’OCDE
(Junius, 1997, citant Oliveira et al., 1996).
Rendements d’échelle à faible croissance : vêtements,
cuir, produits en cuir, textile
Rendements d’échelle à forte croissance : services
d’électricité, de gaz et sanitaires, véhicules à moteur et
équipements, produits chimiques, tabac
Basé sur les marges des prix sur les coûts
marginaux des secteurs à 2 chiffres, couvrant
1953–84 (24 secteurs) aux États-Unis (Roeger,
1995).
Rendements d’échelle à faible croissance : textile,
produits laitiers, scieries, huile de poisson et nourriture
à base de poisson
Rendements d’échelle à forte croissance : métaux de
base, équipement de transport, produits de cimenterie,
produits accessoires, boissons
Basé sur des estimations des fonctions
de production pour le Recensement des
établissements manufacturiers de 1963 en
Norvège (27 industries) (Griliches & Ringstad,
1971).
Rendements d’échelle à faible croissance : habillement,
tricot, cuir, textile
Rendements d’échelle à forte croissance pétrole,
métaux de base et transformés, équipement de
transport
Basé sur des données de coûts et profits dans
167 industries manufacturières à quatre chiffres
CTI, pour 1970 au Canada (Baldwin & Gorecki,
1986) et des estimations de la productivité de
la main-d’œuvre et de la production pour 90
industries à quatre chiffres entre 1965 et 1970 au
Canada (Gupta, 1983).
Rendements d’échelle à faible croissance : vêtement,
produits en bois
Rendements d’échelle à forte croissance autres produits
chimiques, produits alimentaires, imprimerie et édition
Estimations des fonctions de production au
niveau de l’entreprise sur 6 665 usines au Chili
entre 1979 et 1986 (Levinsohn et Petrin,1999).
Source : Équipe du Rapport sur le développement dans le monde 2009.
Note : OCDE = Organisation pour la coopération et le développement économiques ; CTI = Classification type des
industries.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%