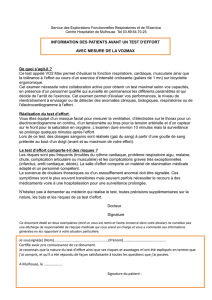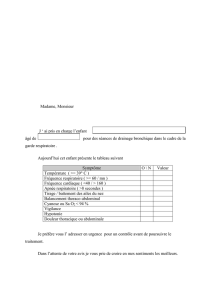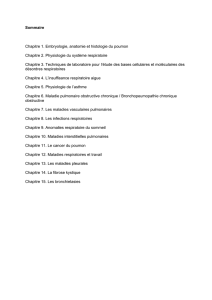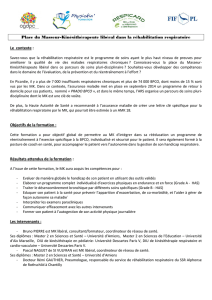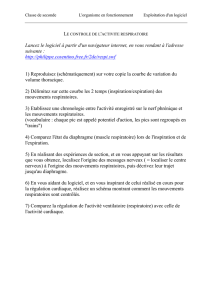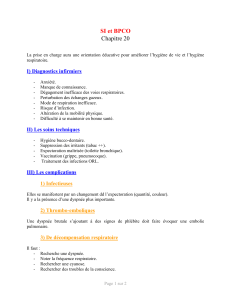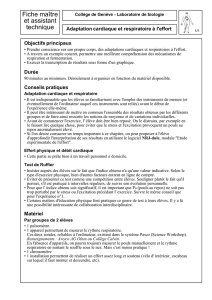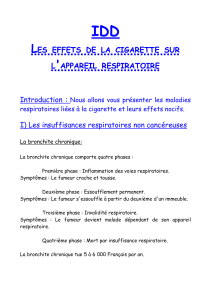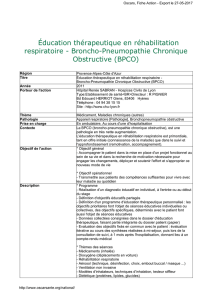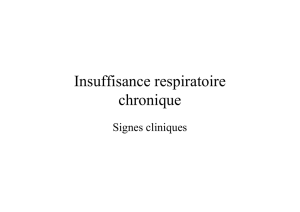Handicap respiratoire

éditorial
Inspirer
Mieux vivre
le handicap respiratoire
La lettre de l’assistance respiratoire à domicile
L
'ORIGINALITÉ du handicap
respiratoire repose sur
deux éléments qui le distin-
guent fortement des autres
handicaps :
Il s'accompagne d'un facteur
d'adaptation considérable de la
part de l'intéressé, confinant par-
fois au déni;
Il est peu fréquemment perçu
par une tierce personne car il s'ac-
compagne assez rarement d'altéra-
tion physique immédiatement
visible.
De ce fait, le patient accepte plus
difficilement, plus tardivement la
notion de handicap. Ceci est d'au-
Le patient atteint d’une insuffisance
respiratoire grave accepte difficilement le statut
de handicapé. Par ce refus, il se prive du
bénéfice des mesures sociales existantes en
faveur des handicapés, alors qu’elles pourraient
améliorer sa qualité de vie.
Suite page 2
Sommaire
Mieux, vivre le handicap
respiratoire
1
Dossier
Évaluation
du handicap respiratoire 3
Appareillage à domicile
et réhabilitation 5
Soins à domicile : quel impact
sur le quotidien des familles? 5
La vie des S.A.R.D.
La réhabilitation respiratoire 6
Fiche pratique
Les aides à domicile 7
Échos 8
Inspirer est publié par les Services d’Assistance Respiratoire à Domicile (SARD) de la Fédération ANTADIR 66, boulevard Saint-Michel 75006 Paris. Tél. 0144 4149 00. Fax 01 44 41 49 07.
Directeur de la publication : Pr Bernard Paramelle. Comité de rédaction : André Ludot, Dr Pierre Menaut, Pr Jean-François Muir, Dr Olivier Roque d’Orbcastel
Coordination : Béatrice Thiriet. Réalisation : ADL Communication. Illustration : Jacques-Thierry Vidal. Tirage : 6000 exemplaires
Inspirer
Janvier 2001 N° 6
d'Assurance Maladie, il faudra
assurer un bilan lésionnel précis,
seul capable de situer le patient
dans ce cadre dès le départ ou au
fil de la surveillance (place pré-
pondérante des données fonction-
nelles et gazométriques). A noter
que même titulaire d’une invalidi-
té, le patient ne reçoit pas automa-
tiquement une carte d’invalide. Il
lui faut la solliciter auprès de la
Mairie du domicile ou du secréta-
riat de l'Agence locale de la
COTOREP. Les avantages sont
notables : demie part supplémentaire
du quotient familial en matière
d'impôt direct, abattement, réduction
d'impôt en cas d'emploi d'aide à
domicile, exonération.éventuelle.de
redevance de la télévision, tarifs
privilégiés SNCF, etc. damentale,
voire l'allocation compensatrice
ou l'allocation supplémentaire du
Front National de Solidarité.
L'insuffisance respiratoire chronique grave
fait partie de la liste des 30 affections
autorisant une prise en charge complète par
la Caisse Nationale d'Assurance Maladie
tant plus regrettable que les
efforts sociaux sont réels en
faveur des handicapés de toute
origine. Leur connaissance amé-
liore nettement la qualité de vie
quotidienne.
Les conditions matérielles
La prise en charge des frais théra-
peutiques : exonération du ticket
modérateur, tiers payant, entente
préalable, aide médicale gratuite,
restent des domaines mal connus
du patient. Puisque l'insuffisance
respiratoire chronique grave fait
partie de la liste des 30 affections
autorisant une prise en charge
complète par la Caisse Nationale
Pr François Bonnaud
Pr Boris Mélloni
Limoges
L
EHANDICAP
respiratoire se
caractérise par
la perte d’auto-
nomie progressive qu’il
engendre, la dépendance
à un appareillage et des
temps de traitement
quotidiens conséquents
ainsi que par la nécessité
d’un suivi médical
régulier.
En outre, chronicité,
aggravations inéluctables
et hospitalisations
itératives sont généra-
trices d’angoisse.
Par ailleurs, la popula-
tion concernée est âgée
et de plus en plus âgée
(4 % des OLD de 80 ans
et plus en 1987, près
de 30 % actuellement
selon les données de
l’Observatoire).
Savoir s’occuper de son
traitement ;
Pouvoir s’occuper de
son traitement;
Pouvoir réaliser
les actes de la vie
quotidienne sont les défis
des patients que les
SARD doivent aider à
relever.
Dr
Olivier Roque
d’Orbcastel
INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 3

Les associations
membres de
la Fédération
ANTADIR
•ANGERS
A.I.R. - 0241731237
•ANGOULÊME
A.V.D. - 0545959851
•BORDEAUX
A.V.A.D. - 05569958 60
•CAEN
A.I.R. - 0231155500
•DIJON
ALIZE DE BOURGOGNE
0380 66 7400
•FOUQUIERES LES LENS
A.D.A.I.R. - 0321426781
•GRENOBLE
A.G.I.R - 047651 03 04
•GUADELOUPE
A.D.I.R.A.G. - 059021 0184
•Le HAVRE
G.H.A.H.R. - 0235557217
•LILLE
SANTELYS RESPIRATION
0320 96 6888
•LIMOGES
A.L.A.I.R. - 0555507200
•MARSEILLE
A.R.A.R.D. - 04 91 188418
•MONTPELLIER
A.P.A.R.D. - 0467102200
•MULHOUSE
A.I.R. - 0389 6478 65
•NANCY
A.R.A.I.R.LOR. - 0383511063
•NANTES
A.R.I.R.P.LO. - 02406399 99
•NOUVELLE CALÉDONIE
C.C.T.T.M.R. - 00687 26 46 47
•PARIS
C.A.R.D.I.F. - 01 496071 00
•REIMS
A.R.A.I.R.C.H.A.R.- 0326022175
•LA RÉUNION
A.R.A.R. & HAD - 0262297401
•ROCHEFORT
A.A.D.A.I.R.C. - 0546999797
•ROUEN
A.D.I.R. - 0235 59 2970
•STRASBOURG
A.D.I.R.A.L. - 0388180830
•TAHITI
A.P.A.I.R. - 00689 42 76 93
•TOULOUSE
A.D.A.M.U. - 0561 772093
S.A.D.I.R. - 05345016 70
•TOURS
A.R.A.I.R. CENTRE
0247254500
Janvier 2001 -2-Inspirer N° 6
La connaissance de l’affection
Qu'il s'agisse d'une atteinte paren-
chymateuse, bronchique, pariétale,
osseuse ou musculaire, une infor-
mation de bon niveau doit être
remise à tout patient quant à la
nature actuelle du désordre, ses
origines, ses principes de sur-
veillance, les attitudes préventives
qu'elle sous entend. Cet ensemble
ne peut être assumé dans des
conditions optimales que dans le
cadre d'une structure éducative
spécialisée. Certes le conseil médical
est correctement effectué dans la
grande majorité des cas, mais
les informations fondamentales
physiologiques, pathologiques,
thérapeutiques, matérielles :
techniques d'utilisation de l'appa-
reillage, administratives ont atteint
un tel degré de complexité qu'elles
demeurent difficilement compa-
tibles avec le temps moyen dévolu à
une consultation même volontaire-
ment longue et spécialisée.
C'est donc la place que peuvent et
doivent occuper des structures
ni exclusivement médicales ni
exclusivement techniques, mais
essentiellement éducatives, telles
que celles que développent depuis
3 ans le Comité National contre les
Maladies Respiratoires (CNMR) en
collaboration avec l'ANTADIR à
savoir : les Centres Éducatifs
Respiratoires (CER) où tous ces
aspects divers de prise en charge
sont assurés par un personnel
soignant (non médecin) ayant fait
l'objet d'une formation de haut
niveau, régulièrement accessible et
mobile.
Dans ce cadre, la part associative
-si possible par réunion de réflexion
de patients et de médecins- est
déterminante. (Place des Comités
Départementaux contre les
Maladies Respiratoires, des
Associations Régionales d’Aide aux
Insuffisants Respiratoires, des
associations de patients).
Bien étudiées par le système asso-
ciatif français d'aide aux insuffi-
sants respiratoires, elles nécessitent
une parfaite connaissance des possi-
bilités respiratoires de l'intéressé
mais aussi une adaptation totale au
logement, à l'activité professionnelle,
au transport, à la vie familiale,
voire aux périodes de vacances.
La réorganisation de l'habitat est
souvent souhaitable. Selon les
conditions, une aide financière est
possible. Elle est à solliciter auprès
de la Direction Départementale de
l'Équipement ou peut être accordée
par la Caisse d'Allocation Familiale.
Il est souhaitable que la zone de vie
soit de plain pied avec des fonction-
nalités optimales entre la chambre
à coucher et la salle de bain.
Un apprentissage minimal de diété-
tique est nécessaire compte tenu de
l'impact de la dénutrition constaté
chez l'insuffisant respiratoire
chronique grave.
Le maintien d'une activité physique
périodiquement contrôlée en
milieu spécialisé est un autre
facteur d'entretien du capital
musculaire.
Les transports sont souvent source
de difficultés pour les insuffisants
respiratoires graves.
L'automobile personnelle reste le
meilleur moyen de déplacement
puisque l'utilisation de l'oxygène
y est autorisée (Il faut en informer
l’assureur). Plus complexe est le
recours aux moyens de transport en
commun : tramways et surtout
autobus. Le métro est à déconseiller
totalement du fait de l’inadaptation
fréquente des stations, et du très
haut niveau d'empoussiérage
particulaire aérien.
Suite de la page 1
Mieux vivre le handicap respiratoire
LOGEMENT
TRANSPORTS
CONNAÎTRE
ACTIVITÉ PHYSIQUE
DIÉTÉTIQUE
INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 4

JANVIER 2001 -3 -Inspirer N° 6
Évaluation
du handicap respiratoire
de BORG, divisée en dix niveaux,
décrit la sensation de dyspnée.
L’échelle visuelle analogique
(EVA) est représentée par un seg-
ment de droite (en général de
10 cm de long). Le patient indique
son score de dyspnée entre les deux
extrêmes (aucune dyspnée-dyspnée
maximale).
En raison de la facilité de son “sco-
rage”, elle est utilisée lors des
épreuves d’exercice pour fixer le
seuil de dyspnée. Elle est fortement
corrélée au degré de sévérité de la
maladie et au score de l’échelle
proposée par les experts de la
communauté européenne. Cette
échelle appelée échelle de
SADOUL est divisée en cinq stades.
Elle permet un bon suivi de la
dyspnée du patient.
Les examens fonctionnels respi-
ratoires (courbe débit-volume,
pléthysmographie) sont utiles pour
évaluer l’incapacité fonctionnelle.
Le VEMS est une donnée perti-
nente pour apprécier le niveau
d’obstruction bronchique :
modérée : VEMS compris
entre 50 % et 80 % de la valeur
théorique
Dossier
L
ETERME de handicap respi-
ratoire est quelque peu
ambigu. En effet, il com-
prend les différentes
dimensions des conséquences des
maladies respiratoires chro-
niques : déficience, incapacité et
désavantage (OMS. Ph Wood 1970).
La définition suivante paraît accep-
table : état clinique imposant une
limitation (personnelle, sociale,
professionnelle) dans l’activité d’un
sujet en rapport avec l’appareil
respiratoire que la PaO2 soit nor-
male ou abaissée.
Depuis environ vingt ans, de
nombreuses études se sont intéres-
sées au handicap respiratoire des
patients atteints de broncho-pneu-
mopathies chroniques obstructives
(BPCO) en terme d’évaluation mais
aussi de réhabilitation.
La dyspnée est un des facteurs
principaux du handicap au cours
des BPCO, car elle limite les possi-
bilités d’effort et altère la qualité
de vie du malade qui en est atteint.
En raison de la forte subjectivité de
l’interrogatoire, plusieurs échelles
de dyspnées ont été proposées.
L’échelle catégorielle ou échelle
modérément sévère : VEMS
compris entre 35 % et 50 % de la
valeur théorique
sévère : VEMS < 35 % de la
valeur théorique.
Son déclin annuel est estimé entre
60 et 90 ml dans la BPCO. Le degré
d’inflation est reflété par l’augmen-
tation du volume résiduel qui
précède souvent les premiers
signes d’obstruction détectés par la
courbe débit-volume. L’existence
éventuelle d’une restriction asso-
ciée (CPT) constitue un facteur
pronostique de la maladie.
La mesure des pressions statiques
inspiratoires (PI max) et expira-
toire (PE max) est indiquée pour
rechercher une déficience des
muscles respiratoires susceptibles
Dr André Cornette
CHU Nancy
Handicap respiratoire
Suite page 4
Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses
études se sont intéressées au handicap respiratoire
des patients atteints de broncho-pneumopathies
chroniques obstructives (BPCO).
Aujourd’hui l’évaluation du handicap
respiratoire basée sur des données fonctionnelles
et physiques font l’objet d’un consensus et
sont parfaitement bien codifiées.
INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 5

L’analyse des gaz du sang artériel
de repos est essentielle pour fixer le
degré de gravité de l’insuffisance
respiratoire chronique. Les tests
de diffusion (TLCO) apprécient les
échanges gazeux. Ils sont perturbés
chez l’emphysémateux. La baisse
du TLCO/VA reflète la gravité de la
dégénérescence emphysémateuse.
La valeur du TLCO constitue un
facteur pronostic et prédictif d’une
diminution accélérée du VEMS.
L’étude de la ventilation, des
échanges respiratoires et des gaz
du sang artériel, au cours de
de justifier un réentraînement.
Elle permet d’apprécier le retentis-
sement sur les muscles respiratoires
d’une corticothérapie systémique
ou d’une dénutrition. Elle s’avère
utile également chez les patients
incapables de réaliser une courbe
débit - volume (myopathes).
l’exercice, permettent de mettre en
évidence des anomalies qui n’ap-
paraissaient pas au repos. Les
épreuves de marche pendant une
durée limitée nécessitent un mini-
mum d’appareillage. Elles
permettent d’apprécier l’aptitude
physique du patient dans sa vie
courante. Le sujet doit marcher à
son propre rythme, encouragé,
mais non poussé par son accom-
pagnateur. La distance parcourue
sans arrêt en douze minutes est
bien corrélée aux index de dyspnée.
L’épreuve de marche de six
minutes est actuellement la plus
utilisée. Il ne s’agit pas d’un test
maximal mais
d’un test d’endu-
rance utile pour
suivre l’évolution
du patient ou lors
de tests thérapeu-
tiques.
Pour évaluer pré-
cisément le déficit
fonctionnel et la
tolérance à l’effort
du patient, il
est nécessaire de
mesurer la ventila-
tion et les
échanges gazeux
à des niveaux
connus de puis-
sance. Bien qu’il
permette l’activité habituelle du
patient, le tapis roulant est peu uti-
lisé car il ne permet pas de
quantifier avec précision le travail
fourni. Par ailleurs il est coûteux,
encombrant et bruyant. Durant
l’exercice, fait le plus souvent sur
cycloergomètre, on enregistre la
ventilation, la consommation
d’oxygène, le rejet de CO2, la
pression artérielle et l’électrocar-
diogramme. La consommation
maximale d’oxygène en une minute
(VO2 max) est une mesure précise
et reproductible de l’aptitude aéro-
bie maximale. En pratique, la
mesure retenue est la valeur maxi-
male limitée par les symptômes
(VO2 max SL ou VO2 pic). La
JANVIER 2001 - 4 -Inspirer N° 6
Dossier
Handicap respiratoire
valeur de VO2 au niveau du seuil
ventilatoire et au maximum de l’ef-
fort permet d’évaluer la capacité
du sujet à effectuer des activités de
la vie quotidienne. Elle sert à préci-
ser la nature du handicap :
respiratoire, cardiaque ou muscu-
laire. Elle permet de mesurer le
handicap respiratoire et de suivre
son évolution. L’épreuve d’exercice
sur bicyclette ergomètrique est un
atout essentiel pour la réalisation
d’un réentraînement personnalisé
du patient.
L’évaluation du handicap respira-
toire ne se limite pas au recueil des
données fonctionnelles et phy-
siques, il convient
de prendre en
compte la percep-
tion qu’a le
patient de sa mala-
die. Des études de
la qualité de vie
des BPCO avaient
mis en évidence
une médiocre
perception par les
patients de leur
état et de leur
relation avec les
autres et leur envi-
ronnement.
Une étude récen-
te, incluant 762
patients atteints
de BPCO a été réalisée avec le
questionnaire St-Georges. Elle a
permis de montrer que la percep-
tion du patient de la sévérité de son
atteinte est différente de celle du
pneumologue. La qualité de vie est
corrélée à la dyspnée et au nombre
d’exacerbations.
L’évaluation du handicap respira-
toire est basée sur des données
fonctionnelles et physiques qui ont
fait l’objet de consensus et sont
parfaitement bien codifiées. Il est
maintenant bien établi qu’elle doit
s’accompagner d’études sur la
qualité de vie afin de prendre
en compte la perception qu’a le
malade de son handicap.
L’évaluation du
handicap respiratoire
ne se limite pas au
recueil des données
fonctionnelles
et physiques,
il convient de prendre
en compte la
perception qu’a
le patient de
sa maladie
…
Suite de la page 3
INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 6

Dossier
N
OUS avons besoin
d'étendre le champ de
réhabilitation pour les
patients atteints de
maladie respiratoire grave.
Actuellement, la plupart des
patients font leur réentraînement
en centre de moyen séjour, en
hôpital de semaine ou de jour.
Près de trois millions de patients
atteints de maladie respiratoire
doivent profiter d'un tel entraîne-
ment. La réhabilitation des
patients avec insuffisance respi-
ratoire chronique grave sous
oxygénothérapie ou ventilation
assistée est entreprise de façon
sporadique dans certains établisse-
ments hospitaliers ou centres de
réadaptation.
Leur retour au
domicile est sou-
vent synonyme
d'isolement
social.
Par conséquent,
nos modalités de
fonctionnement
doivent évoluer.
Il faut sélection-
ner et orienter
correctement les
patients vers les
lieux ou ils peu-
vent profiter au maximum des pos-
sibilités existantes. Ceci nous obli-
ge à simplifier les prises e n
charge si nous voulons
atteindre un maximum de ces
personnes.
JANVIER 2001 - 5 -Inspirer N° 6
Pour les patients
appareillés à domicile,
il faut identifier ceux
qui peuvent profiter
d’un réentraînement
à domicile…
Handicap respiratoire
Appareillage à domicile
et réhabilitation
Pour étendre le champ de la réhabilitation
pour les patients atteints de maladie respiratoire
grave, il faut adapter nos modalités
de fonctionnement.
Soins
à domicile :
quel impact
sur le quotidien
des familles?
Elisabeth Vuillemin
ADIRAL-Strasbourg
Claire Boffa, Line Mounier
ANTADIR
Une étude a été conduite par les
SARD de l’Antadir auprès des
familles prenant en charge un
parent adulte, trachéotomisé
et ventilé depuis plus d’un an,
population retenue en raison des
caractéristiques du traitement qui
sont parmi les plus lourdes.
L’objectif de l’étude était de recen-
ser de façon précise les contraintes
quotidiennes des familles – actes
effectués pour le patient et temps
passé – et d’identifier les types
d’aides souhaités – profil des inter-
venants et modalités d’intervention.
11 SARD ont participé à cette
étude, 156 familles ont répondu
au questionnaire.
Un constat :
64 % des familles déclarent ne
pas pouvoir laisser leur patient
sans aucune présence à domicile,
36 % peuvent s’absenter 2 heures
30 en moyenne.
L’intervention des familles,
aussi bien dans les actes de la vie
quotidienne que dans les actes
de traitement est prépondérante,
même si elles sont ponctuellement
aidées par des infirmiers et/ou
kinésithérapeutes.
40 % des familles consacrent
quotidiennement 8 heures ou plus
à leur patient :
Le rôle de soignant accepté mais
lourd, avec en filigrane la crainte
de ne plus pouvoir l’assumer et le
besoin de se reposer.
Les aspirations trachéales, le lever et
le coucher, la toilette viennent en
tête des actes dont les familles
souhaiteraient être soulagées,
régulièrement ou à la demande.
La personne jugée la plus à même
d’intervenir est un(e) auxiliaire de
vie et/ou un(e) garde malade, dans
la mesure où elle serait formée aux
soins spécifiques que demandent
ces patients, en particulier aux
aspirations.
Le décret du 27 mai 1999 autorisant
les actes d’aspiration endo-trachéales
par des personnes non IDE, mais
ayant validé une formation
appropriée, ouvre des perspectives
pour répondre à cette demande :
reste à développer les formations,
définir le mode de financement de
ces intervenants spécifiques
à domicile.
Pour les patients appareillés à
domicile, il faut identifier ceux
qui peuvent profiter d'un réentraî-
nement chez eux. La réadaptation
à l'effort de ces patients peut être
entreprise à l’aide d’organisations
telles que les associations. Il existe
déjà des structures capables de
bien évaluer les besoins matériels,
humains et structurels qui
seraient nécessaires pour identi-
fier les bons candidats pour une
RAE à domicile.
Avec l'Observatoire des patients
par exemple, on sait que 25 % des
personnes sous oxygénothérapie
ont plus de 80 ans et auront peut-
être du mal à s'adapter à une prise
en charge à domicile de ce type.
Une autre étude ANTADIR sur
l'éducation des patients, montre
que l'observance à l'OLD est très
liée aux conseils initiaux donnés
par le prescripteur. Il est donc
nécessaire de mettre en place
des systèmes d'évaluation et d'appli-
cation de critères moins classiques
que ceux employés habituellement
pour débuter la RAE, avec une
prise en charge personnelle du
patient pour une meilleure
connaissance de la maladie, des
limites physiques et de l’accep-
tation du handicap.
Dr Dan Veale
Dr Philippe Rodriguez
Centre Bazire, Grenoble
INSPn°6 JD 2 23/07/02 15:37 Page 7
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%