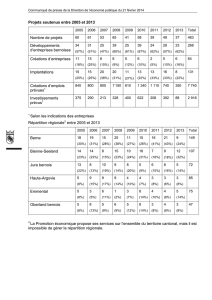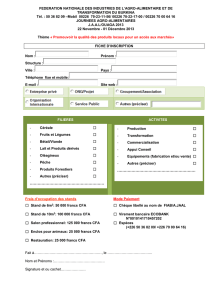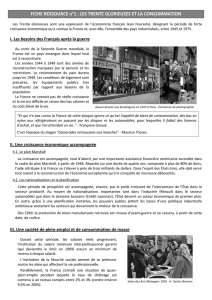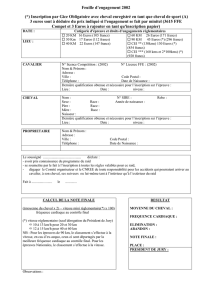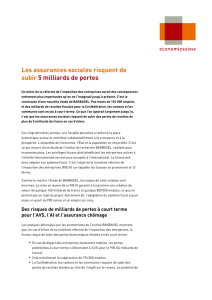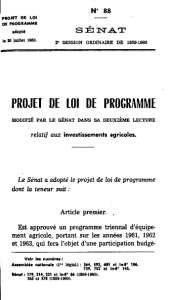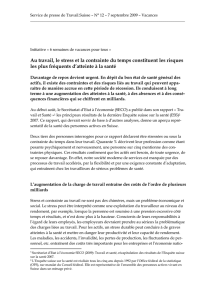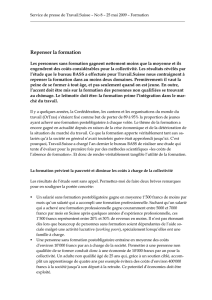1 - ACTES 150 jb_nri

79
J’ai assisté, dans les années 1960, en Algérie, à ce qui
m’apparaît rétrospectivement comme une véritable
expérimentation sociale. Ce pays dans lequel certaines
populations montagnardes reculées et isolées, comme
celles que j’ai pu étudier en Kabylie, avaient pu conser-
ver, à peu près intactes, les traditions d’une économie
précapitaliste tout à fait étrangère à la logique du mar-
ché, a connu, avec la guerre de libération, et certaines
des mesures de la politique militaire de répression,
comme les regroupements de population opérés par l’ar-
mée française, une sorte d’accélération historique qui
a fait coexister (ou se télescoper), sous le regard de l’ob-
servateur, deux formes, ordinairement séparées par un
intervalle de plusieurs siècles, de système économique
aux exigences contradictoires1.
Je voudrais ici évoquer brièvement, sans revenir
sur le détail des analyses déjà publiées et en donnant la
priorité à des informations inédites, conservées dans mes
carnets de terrain, ce qui m’est apparu en pleine clar-
té dans cette sorte de situation de laboratoire: la dis-
cordance entre des dispositions économiques façon-
nées dans une économie précapitaliste et le cosmos
économique importé et imposé, parfois de la manière
la plus brutale, par la colonisation, obligeait à décou-
vrir que l’accès aux conduites économiques les plus élé-
mentaires (travail salarié, épargne, crédit, régulation des
naissances, etc.) ne va nullement de soi et que l’agent
économique dit «rationnel» est le produit de conditions
historiques tout à fait particulières. C’est très précisé-
ment ce qu’ignorent et la théorie économique qui enre-
gistre et ratifie sous le nom de «théorie de l’action
rationnelle» un cas particulier d’habitus économique his-
toriquement situé et daté sans s’interroger le moins
du monde, tant il lui paraît aller de soi, sur les condi-
tions économiques et sociales qui le rendent possible,
et la «nouvelle sociologie économique2» qui, faute de
disposer d’une véritable théorie de l’agent économique,
reprend par défaut la Rational Action Theory et omet
d’historiciser les dispositions qui, comme le champ
économique, ont une genèse sociale. C’est sans doute
parce que je me suis trouvé placé dans une situation où
je pouvais observer de visu le désarroi ou la détresse
Pierre Bourdieu
La fabrique de l’habitus
économique
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 150 p.79-90
1.Les lieux, conditions et objectifs des investigations sur lesquels cet article revient sont spécifiés en détail dans deux livres parus simultanément au début des
années 1960:
Travail et travailleurs en Algérie
(Pierre Bourdieu, avec Alain Darbel, Jean-Pierre Rivet et Claude Seibel, Paris-La Haye, Mouton, 1963), sur la trans-
formation des dispositions économiques et des structures sociales accompagnant la diffusion de l’émigration, de l’urbanisation et du travail salarié à travers l’Algérie;
et
Le Déracinement. La crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie
(Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Paris, Minuit, 1964), sur les bouleversements de la
société rurale, principalement en Kabylie, résultant de la colonisation et surtout de la politique de déplacement forcé, dite de «regroupement», par laquelle l’armée
française cherchait à détruire les bases sociales de l’aile armée du mouvement nationaliste. Les principaux résultats de cette recherche sont récapitulés de
manière succincte dans le premier chapitre d’
Algérie 60
(P. Bourdieu, Paris, Minuit, 1977), «Le désenchantement du monde». 2.Pour un échantillon représen-
tatif de ce courant de la sociologie nord-américaine, issu de la réappropriation de Polanyi et de Weber et du développement de l’analyse des réseaux visant à
rompre avec une conception atomisée des agents économiques, voir Richard Swedberg (éd.),
Explorations in Economic Sociology,
New York, Russell Sage
Foundation, 1993; et Mark Granovetter, «The Old and the New Economic Sociology: A History and an Agenda»,
in
Roger Friedland et A. F. Robertson (éds),
Beyond
the Marketplace
, New York, Aldine De Gruyter, 1990, p.89-112; «Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis»,
Acta Sociologica
,
35-1, 1993, p.3-12. Pour une approche visant à réinscrire la sociologie économique dans la «théorie du choix rationnel » étroitement définie qui révèle la philo-
sophie de l’action utilitariste et individualiste qui leur est commune, on peut lire James S. Coleman, «A Rational Choice Perspective on Economic Sociology»,
in
Neil J. Smelser et Richard Swedberg (éds),
The Handbook of Economic Sociology
, New York, Russell Sage Foundation, 1994, p.166-180. Pour le contraste
avec la même problématique posée en termes ethnologiques, voir Stuart Plattner (éd.),
Economic Anthropology,
Stanford, Stanford University Press, 1989.

80
d’agents économiques dépourvus des dispositions taci-
tement exigées par un ordre économique pour nous tout
à fait familier, où, étant une structure sociale incorpo-
rée, donc naturalisée, elles apparaissent comme allant
de soi, naturelles, et universelles, que j’ai pu avoir l’idée
d’analyser statistiquement les conditions de possibilité
de ces dispositions historiquement constituées.
Quelques propriétés
de l’économie précapitaliste
Toutes les caractéristiques majeures des pratiques
économiques précapitalistes peuvent se rattacher au fait
que les conduites que nous considérons comme éco-
nomiques ne sont pas autonomisées et constituées
comme telles, c’est-à-dire comme ressortissant à un
ordre spécifique, régi par des lois irréductibles à celles
qui régissent les relations sociales ordinaires, notamment
entre parents.
Dans la société kabyle de la fin de l’ère coloniale, les
échanges entre parents ou entre voisins obéissent à la
logique du don et du contre-don. Les personnes hono-
rables ne vendent pas du lait («Tu parles! Il a vendu du
lait!»), ni du beurre ou du fromage, ou encore des
légumes ou des fruits, mais on en «fait profiter les voi-
sins»… Le meunier qui a un excédent de farine ne son-
gerait pas à vendre un produit qui, comme la farine, est
la base même de l’alimentation. La logique de l’échan-
ge de dons se combine avec la logique mythico-rituelle
pour interdire de rendre vide un ustensile: ce qui est ainsi
renvoyé est appelé el fel, c’est-à-dire «le porte-bon-
heur», comme ce qu’on donne au maçon, œufs ou
volailles, lorsqu’il va travailler hors du village. Même
chose pour les services, régis par des règles strictes de
réciprocité et de gratuité; et aussi pour les prêts. Ainsi,
la charka du bœuf (par laquelle un paysan prête un bœuf
pour une durée déterminée contre un certain nombre de
mesures de grains) ne peut s’instaurer qu’entre quasi-
étrangers (c’est-à-dire en cas de défaillance des plus
proches) et elle est entourée de toutes sortes de dissi-
mulations et euphémisations destinées à en masquer ou
en refouler les potentialités mercantiles: le plus souvent,
les deux «contractants» préfèrent la cacher d’un com-
mun accord, l’emprunteur essayant de dissimuler son
dénuement et de laisser croire que le bœuf est sa pro-
priété, le prêteur se prêtant au jeu parce qu’il est mieux
de tenir cachée une transaction qui n’est pas strictement
conforme au sentiment de l’équité, le capital ne pouvant
jamais être perçu et traité comme tel. Tout se passe
comme si la transaction devenait de plus en plus rédui-
te à sa «vérité» économique à mesure que le rapport
entre les agents concernés par l’échange devient plus éloi-
gné, donc plus neutre et impersonnel, le poids relatif de
la générosité et du sentiment de l’équité décroissant
alors continûment, dans ces rapports structuralement
ambigus, au profit de l’intérêt et du calcul3.
Les rapports réduits à leur dimension purement
«économique» sont conçus comme des rapports de
guerre, qui ne peuvent s’engager qu’entre étrangers. Le
lieu par excellence de la guerre économique est le mar-
ché, moins le marché de village ou de tribu, lieu où l’on
côtoie encore des familiers, que les grands marchés
des petites villes lointaines (Bordj bou Arreridj, Akbou
ou Maison-Carrée, dans la bouche des informateurs) où
l’on s’affronte à des inconnus, et au plus redoutable
d’entre eux, le maquignon, et où l’on est exposé, du
même coup, à toutes les ruses et les supercheries de la
guerre sans merci. Et l’on peut dégager des innombra-
bles récits des infortunes du marché quelques règles
de prudence: quand l’objet de la transaction est bien
connu, sans équivoque, comme une terre, un rapport
d’échange anonyme est possible et le choix se porte en
priorité, sinon de manière exclusive, sur la chose ache-
tée; quand il est mal connu, équivoque et peut donner
matière à tromperies (comme un mulet qui peut se
révéler rétif ou un bœuf qui peut être artificiellement
«grossi» ou donner des coups de corne), le choix se porte
en priorité sur le vendeur, et, en tout cas, on
s’efforce de substituer un rapport personnel à un rap-
port impersonnel et anonyme, notamment en prenant
toutes sortes de garanties et en mobilisant des «garants»
et des témoins, qui visent en quelque sorte à noyer la rela-
tion de l’acheteur et du vendeur dans un réseau d’in-
termédiaires4.
Les stratégies d’honneur qui régissent les échanges
ordinaires ne sont pas totalement absentes des échan-
ges extra-ordinaires du marché: ainsi, comme cela se fait
aussi à l’occasion des mariages, le vendeur, après les
échanges verbaux qui se concluent par la fixation du
prix, rend ostensiblement à l’acheteur une part relati-
vement importante de la somme «pour qu’il achète de
la viande aux enfants». Et l’on raconte de nombreux cas
d’achats de terres déterminés par le souci de protéger
un parent ou une parente contre la dépossession au pro-
Pierre Bourdieu
3.J’ai montré ailleurs qu’une semblable répression de l’intérêt strictement «économique» tend à gouverner le champ de la production artistique au fur et à mesure
de sa constitution historique (P. Bourdieu,
Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire,
Paris, Seuil, 1992). 4. Pour une analyse convergente du
point de vue de la théorie de l’information, voir la dissection du fonctionnement du bazar de Sefrou au Maroc opérée par Clifford Geertz («The Bazaar Economy :
Information and Search in Peasant Marketing»,
American Economic Review,
68, mai 1968, p.28-32). Un même mécanisme de réduction de l’incertitude entou-
rant l’échange économique est décrit par Charles W. Smith dans son ethnographie des ventes aux enchères (
Auctions: The Social Construction of Value
, Berkeley,
University of California Press, 1990). 5.On trouvera une analyse similaire des facteurs empêchant que la terre ne devienne une pure marchandise dans les campa-
gnes du Béarn qui m’a permis, à l’époque, de mieux déchiffrer la logique de l’économie paysanne algérienne dans «Célibat et condition paysanne» (
Études
rurales
, 5-6, avril 1963, p.32-136, repris
in Le Bal des célibataires
, Paris, Seuil, coll. «Points », 2002). 6.P. Bourdieu et A. Sayad,
Le Déracinement
,
op. cit.

81
fit d’un étranger ou, dans une autre logique, pour affir-
mer le point d’honneur d’un groupe en face d’un grou-
pe rival. Bref, la logique du marché, c’est-à-dire de la
guerre, n’est jamais vraiment acceptée et reconnue en
tant que telle et ceux qui s’en accommodent, maqui-
gnon, collecteur des droits du marché ou usurier, sont
voués au mépris5.
Une brève parenthèse sur les relations entre les pay-
sans et les artisans, notamment les forgerons et les
meuniers, et sur leurs transformations, corrélatives de
l’apparition de véritables métiers de commerce, per-
mettra de vérifier que la logique proprement écono-
mique n’est pas indépendante de la logique des rapports
sociaux dans lesquels elle est immergée. Ainsi, dans la
Kabylie des années 1950, le travail des forgerons était
l’objet d’une transaction non monétaire le plus souvent
réglée par le droit coutumier, le forgeron du village
devant assurer à chaque paysan les réparations néces-
saires à l’entretien de son matériel en échange d’un pré-
lèvement annuel d’une part de la récolte proportion-
nelle au nombre de paires de bœufs possédées. Le
cas des moulins à eau d’Aghbala, que j’ai étudié avec
Abdelmalek Sayad, permet de saisir l’interpénétra-
tion des relations sociales et des relations écono-
miques: du fait que, à la différence des forgerons,
très fortement stigmatisés, les meuniers n’étaient pas
exclus de la communauté, bien qu’ils comptent parmi
les plus déshérités, chaque moulin s’attachait, par le
jeu des échanges de services et le chassé-croisé des rela-
tions et des alliances, une clientèle stable, traitée avec
des égards spéciaux, un peu comme des hôtes, et pré-
levait une part (un dixième) des grains traités en
échange du service rendu.
Avec le déclin de l’agriculture lié à l’introduction
d’activités nouvelles (artisanat, commerce, etc.) et à
l’apparition de ressources non agricoles liées à l’émi-
gration6, le recours aux moulins à eau traditionnels
régresse (on s’approvisionne directement en semoule au
lieu de faire moudre le grain récolté) et le moulin à
moteur prend la place, ruinant, comme par magie, tout
le système des conventions qui régissait le jeu de la soli-
darité collective dans le cas de la mouture traditionnelle.
Ainsi, par exemple, il était de tradition de traiter gra-
tuitement et en priorité toute charge de grains n’ayant
pas été apportée à dos de bête; il ne pouvait s’agir que
de la petite réserve d’un pauvre, issue du glanage, des
dons de l’Aïd, de la dîme prélevée sur les récoltes, de
l’aide d’un parent plus riche ou encore de la mendici-
té auprès des aires à battre, quantité trop réduite en tout
cas pour pouvoir être amputée encore d’un dixième et
trop impatiemment attendue pour qu’on puisse en dif-
férer la transformation. À travers le moulin à moteur,
acquis le plus souvent à force d’économies (au lieu
d’être simplement un bien d’usage hérité), et perçu et
traité comme un simple moyen de production (au sens
de l’économie), s’introduit la logique de l’investissement
et du calcul des coûts et des profits, en lieu et place des
satisfactions de l’accomplissement autarcique que pou-
vait procurer au paysan propriétaire de tout ou partie
d’un moulin à eau le fait de moudre son propre grain:
un vieux fellah se souvient d’avoir utilisé le moulin
dont il possède les trois quarts pendant trente-cinq
jours d’affilée, soit durant le quart de la période
d’activité; l’utilisateur du moulin mécanique, si pauvre
soit-il, se trouve converti en client et le meunier se
comporte à son égard en commerçant soucieux de ren-
trer dans ses frais.
Cette transformation des activités «artisanales»,
toujours subordonnées jusqu’alors à l’activité agricole
et le plus souvent exercées par des catégories stigma-
tisées, comme les Noirs, ou par les plus pauvres, à titre
de complément du khammessat (forme traditionnelle
de métayage au quint) ou du métayage, en activités à
part entière, en véritables «métiers», a son équivalent
dans l’ordre du commerce qui ne pouvait être, autre-
fois, qu’une activité complémentaire, associée à l’agri-
culture (on aurait considéré comme un «paresseux»
celui qui serait resté «assis sur une chaise», des «jour-
nées entières», «à l’ombre»). Aussi veillait-on à n’ou-
vrir boutique que le matin, avant le départ aux champs,
et le soir au retour du travail, pendant la belle saison.
Le local imparti au commerce faisait partie de l’habi-
tation et les familiers (ou, quand on n’avait pas droit à
cette intimité, la vieille de la maison) n’hésitaient pas
à appeler ou à entrer dans la maison pour se faire
servir un paquet de café ou de sucre (soit par le
maître de maison, soit par une des femmes, soit par un
des garçons spécialisé à cet effet).
Tout vient à changer lorsque, dans les années 1960,
on voit apparaître le commerçant à plein temps qui ne
veut plus exercer le métier de paysan, laissant ses ter-
res, s’il en a, à son fils, son frère ou à un khammès.
Présent en permanence dans sa boutique, désormais dis-
tincte de la maison, pendant des heures d’ouverture bien
fixées, souvent habillé autrement que le fellah, il a le sen-
timent de faire quelque chose en tenant boutique (et non
de perdre son temps), même lorsque, dans les regrou-
pements, produits de la fausse urbanisation opérée par
l’armée, son activité est en fait très réduite (sa boutique
devenant en fait un lieu de réunion où l’on vient pour
bavarder sans consommer). Cette «ascension » des
commerçants est, pour les vieux paysans attachés à
l’économie de la bonne foi (niya), un des signes de l’ef-
fondrement du monde ancien, comme l’explique tel
informateur du regroupement de Aïn Aghbel.
«Même les bouchers se moquent maintenant des
cultivateurs. Il leur suffit d’avoir un magasin, une
chemise spéciale pour le travail, de changer de vête-
La fabrique de l’habitus économique

82
ments, d’avoir des ouvriers qui égorgent [les bêtes],
qui nettoient, qui vendent sur les marchés, pour ces-
ser d’être des bouchers [métier traditionnellement
méprisé, comme celui de forgeron] et devenir des
“riches”. C’est devenu un “métier” [en français].
Maintenant, tout est métier. Quel est ton métier,
demande-t-on ? Et chacun de se trouver un métier.
Qui, pour avoir entreposé trois boîtes de sucre et
deux paquets de café dans un local, se dit commer-
çant; qui parce qu’il sait clouer quatre planches se
dit menuisier; les chauffeurs ne se comptent plus,
même s’il n’y a pas de voitures, il suffit pour cela
d’avoir en poche son permis. Est-ce que cela donne à
manger ? C’est l’armée [française] qui a fait un peu
ça, qui a donné un métier aux gens. Il y a eu d’abord
l’autodéfense, c’est le premier métier […]. Il y a eu
par la suite les harkis, les goumiers, les moukhazni,
les sardjan [sergent], kabran [caporal], serdjan chef,
il y a eu le sakritir et le khodja [cadre], sans parler
du maire (el mir) et ses conseillers (iqounsayan-is).
Après ça, il suffit que le lieutenant apprenne qu’un tel
sait faire ceci ou cela, pour qu’il le mentionne comme
ayant ce métier; petit à petit tout le monde est venu à
oublier qu’il y a le travail de la terre que l’on néglige.
Au recensement, j’ai entendu Mohand L. s’insurger
parce qu’on l’a porté comme cultivateur, alors qu’on
a trouvé un vrai métier à tous les autres inscrits:
“Vous me méprisez; les vrais cultivateurs, vous leur
avez trouvé un métier, moi, parce que je ne possède
pas un arpent (thamtirth), vous faites de moi un
fellah. Voilà des cultivateurs, de la terre, ils en ont
jusqu’au seuil de leur porte, et pourtant l’un est
chauffeur, l’autre commerçant. Je ne parle pas de
Hocine M. qui, lui, est elkhodja gel biro (khodja
dans le bureau) ! Moi aussi, j’ai un métier !”»
Et il continue en racontant comment ce personnage
s’est improvisé maquignon (tadjar) et intermédiaire et,
contre commission, assure des ventes de bois ou appro-
visionne le village en paille ou tout autre bien:
«Il y a aussi le travail en France qui nous a valu des
soudeurs, des peintres-tapissiers, des travailleurs sur
machines. La mine a donné des piqueurs, des boi-
seurs, des coffreurs. Il ne manque que des ingénieurs.
Tous ces gens ont cessé de travailler depuis fort long-
temps, ils gardent toujours leur métier, surtout si sur
leur carte d’identité il y a le métier; c’est la preuve
irréfutable. À ceux qui n’ont pas de métier, il reste la
possibilité d’être antriti [retraité, en retraite] ou anfa-
liditi [en invalidité].»
Les conditions économiques de l’accès aux
pratiques économiques
Ce long monologue haut en couleur évoque, pêle-mêle,
quelques-uns des facteurs tels que l’émigration ou l’ac-
tivité classificatoire de l’armée française, grande pour-
voyeuse aussi de fausses activités, qui, avec la généra-
lisation des échanges monétaires et l’introduction
d’innovations techniques, ont introduit, jusque dans
le monde rural, la logique de l’économie monétaire et
du calcul économique dit rationnel. Mener en milieu
rural l’étude des transformations des pratiques éco-
nomiques permet de voir mieux, et plus complète-
ment, ce qu’elles mettent en jeu, c’est-à-dire tout un
style de vie ou, mieux, tout un système de croyances.
Si bien qu’il faut parler, pour les décrire, non d’a-
daptation, mais de conversion7.
Pour faire comprendre à des lecteurs qui, comme nos
économistes et nos sociologues de l’économie, sont
dans l’économie dite rationnelle comme des poissons
dans l’eau, que le mot de conversion n’est pas trop
fort, et pour provoquer en eux la conversion de tout
l’esprit qui est nécessaire pour rompre avec l’univers de
présupposés profondément incorporés qui nous font
juger évidentes, naturelles et nécessaires, donc ration-
nelles, les conduites économiques en usage dans notre
monde économique, il faudrait que je puisse ici évoquer
la longue suite d’expériences souvent infimes qui m’ont
fait éprouver de manière sensible et concrète le carac-
tère contingent et arbitraire de ces conduites ordinai-
res, marquées du sceau du plus parfait naturel, que nous
accomplissons tous les jours dans la routine de nos
pratiques économiques. Comme, par exemple, le fait de
se faire rendre la monnaie, dans un magasin, au lieu
d’arriver chez le «commerçant», comme en Kabylie,
avec, dans la main, la somme minutieusement décomp-
tée correspondant exactement au prix de l’objet que l’on
vient acheter.
Je me souviens encore être resté de longues heures
à poser des questions à un paysan kabyle qui essayait
de m’expliquer une forme traditionnelle de prêt de
bétail parce qu’il ne m’était pas venu à l’esprit que le
prêteur pût, contre toute raison «économique», se sen-
tir l’obligé de l’emprunteur au nom de l’idée que celui-
ci assurait l’entretien de la bête qu’il aurait bien fallu
nourrir en tout cas. Je me souviens aussi de la somme
d’observations anecdotiques et de constats statistiques
que j’ai dû accumuler avant de comprendre la philo-
sophie implicite du travail, fondée sur l’équivalence
du travail et de la rémunération en argent, que j’enga-
Pierre Bourdieu
7.En l’absence d’une telle conversion, c’est l’ensemble des stratégies de reproduction qui se trouvent enrayées et en fin de course bloquées, et la reconversion
devient impossible, menant le groupe à la démoralisation, voire à l’auto-extinction, comme on le voit bien dans le cas de paysannerie française (
cf.
Sylvain
Maresca,
Les Dirigeants paysans
, Paris, Minuit, 1983).

83
geais dans mon interprétation spontanée de ce monde
et qui m’empêchait de comprendre complètement cer-
taines conduites ou certains étonnements de mes infor-
mateurs (celui du vieux Kabyle découvrant la multi-
plication des «métiers» que j’ai cités ci-dessus) : la
conduite, jugée suprêmement scandaleuse, du maçon
qui, au retour d’un long séjour en France, demanda
qu’on ajoute à son salaire une somme correspondant au
prix du repas offert à la fin des travaux auquel, par un
manquement inouï à la bienséance, il avait refusé de
prendre part; ou le fait que, pour un nombre d’heures
ou de jours de travail objectivement identiques, les
paysans des régions du sud de l’Algérie, moins affectées
par l’émigration (et par la politique d’encadrement de
l’armée), se disaient plus souvent occupés, comme pay-
sans, que les Kabyles, plus enclins à s’attribuer un
«métiers» ou à se dire chômeurs. Cette philosophie
allait pour moi tellement de soi qu’il ne m’apparaissait
pas qu’elle me dissimulait le travail d’invention et de
conversion que ceux que j’étais en train d’observer
devaient accomplir pour s’arracher à une vision, pour
moi très difficile à penser, de l’activité comme occupa-
tion sociale socialement reconnue, indépendamment
de toute sanction matérielle, et pouvant, à la limite, se
réduire à l’accomplissement de la fonction propre d’hom-
me, qui ne perd pas son temps, lorsqu’il parle avec
d’autres hommes à l’assemblée ou lorsqu’il distribue le
travail aux membres de la maisonnée.
De même que j’avais dû m’imprégner suffisamment
de la logique du système mythico-rituel kabyle pour
être capable de commettre délibérément des «barba-
rismes» dans les questions que je leur posais (en faisant
par exemple intervenir un objet fabriqué par le feu, un
peigne à carder la laine, dans un rituel où l’on attendait
un objet féminin, comme l’eau ou la laine) afin de sus-
citer le démenti ou le rire de mes informatrices, plus
capables, comme nous en matière de langue, de repérer
des fautes que d’énoncer des règles, ce qui est l’affaire
des grammairiens et non des simples locuteurs, de
même, mais sans doute plus difficilement, parce que rien
ne me préparait à penser l’économie, la mienne surtout,
comme un système de croyances, j’ai dû apprendre peu
à peu, à travers des observations ethnographiques cor-
roborées ensuite par l’analyse statistique, la logique
pratique de l’économie précapitaliste, en même temps
que j’essayais tant bien que mal d’en écrire la grammaire.
C’est sans doute la familiarité quasi indigène avec la
logique pratique de l’économie précapitaliste que j’avais
acquise à travers l’enquête ethnographique et qui avait
«réveillé», par une sorte d’anamnèse8méthodiquement
provoquée, des souvenirs profondément enfouis de mon
enfance campagnarde (j’avais ainsi été envoyé, plus
d’une fois, avec la monnaie exactement comptée dans
la main, chez l’épicier, qu’il fallait faire venir en criant
«houhou» à l’entrée de la maison) qui m’a permis
d’apercevoir tout ce que pouvait avoir d’historique-
ment extra-ordinaire, dans son apparente banalité, l’his-
toire, rapportée par les journaux du 29 octobre 1959,
de ces enfants de Lowestoft, en Angleterre, qui avaient
créé une société d’assurance contre les punitions pré-
voyant que, pour une fessée, l’assuré recevrait quatre
shillings et qui, devant certains abus, étaient allés jusqu’à
établir une clause supplémentaire selon laquelle la socié-
té n’était pas responsable des accidents volontaires.
C’est aussi cette compréhension pratique d’une éco-
nomie des pratiques économiques devenue parfaite-
ment exotique qui m’a permis de découvrir et de com-
prendre que, comme le rappelle Bergson, «il faut des
siècles de culture pour produire un utilitariste comme
Stuart Mill» ou, autrement dit, que tout ce que la scien-
ce économique se donne comme un donné, c’est-à-dire
l’ensemble des dispositions de l’agent économique qui
fondent l’illusion de l’universalité anhistorique des
catégories et des concepts utilisés par cette science,
est en fait le produit d’une longue histoire collective, et
doit être acquis au cours de l’histoire individuelle, dans
et par un travail de conversion qui ne peut réussir que
sous certaines conditions. Cet «utilitariste» ainsi res-
titué à son exotisme, j’ai voulu, après tant d’autres,
comme Weber9, Sombart10 ou Tawney11, que je lisais
avec passion, contribuer à comprendre comment il
s’était peu à peu inventé, tout au long de l’histoire, en
me donnant pour projet explicite d’observer les
processus d’acquisition de toutes ces dispositions qui
sont accordées d’emblée aux petits écoliers «sponta-
nément» stuartmilliens de Lowestoft, comme le calcul
des coûts et des profits, le prêt à intérêt, l’épargne, le
crédit, l’investissement ou même le travail; et même
d’établir rigoureusement, par les voies de la statistique,
les conditions économiques et culturelles de l’accès à
la conduite économique dite rationnelle.
Le principe de tous les renversements de la vision du
La fabrique de l’habitus économique
8.La même anamnèse peut être déclenchée par la réappropriation historique des croyances et des pratiques économiques effacées par l’histoire économique,
i.e. la transmutation de dispositions et de représentations collectives devenues littéralement impensables pour nous, telle celle provoquée par la révolution symbo-
lique (dans le domaine de la religion, de la statistique, de la famille et de l’entreprise) qui a «mis la mort sur le marché» et rendu possible l’invention de l’industrie
de l’assurance-vie à la fin du XIXesiècle en Amérique (Viviana Zelizer,
Morals and Markets : the Development of Life Insurance in the United States
, New York, Columbia
University Press, 1979). Elle peut être également favorisée par cette sorte d’involution économique brutale qui rend subitement obsolète l’habitus économique
formellement rationnel d’un ancien cosmos économique ordonné, telle que l’analyse Burawoy dans le cas de la Russie post-communiste (Michael Burawoy, Pavel
Krotov et Tatyana Lytkina, «Involution and Destitution in Postcommunist Russia »,
Ethnography
, 1-1, été 2000, p.43-66). 9. Max Weber,
Gesammelte Aufsätze
zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
, Tübingen, Mohr, 1924. 10. Werner Sombart,
The Quintessence of Capitalism: A Study of the History and Psychology of
the Modern Business Man
, Londres, Unwin, 1915. 11.Richard Henry Tawney,
Religion and the Rise of Capitalism,
Londres, John Murray, 1926.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%