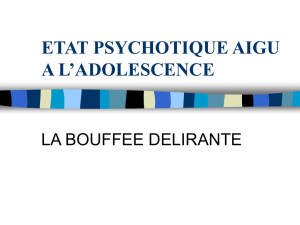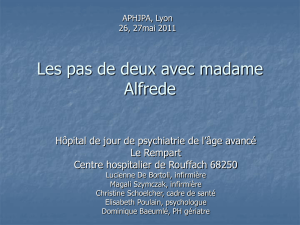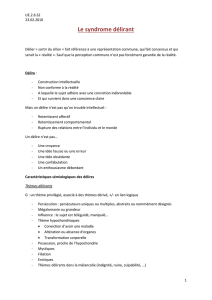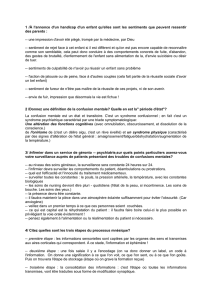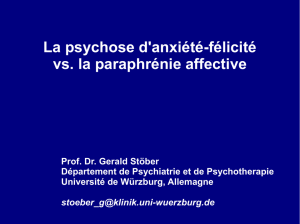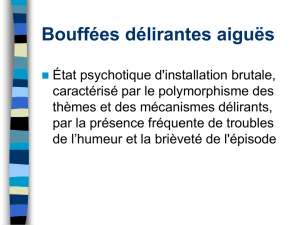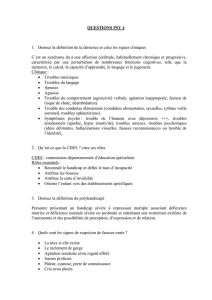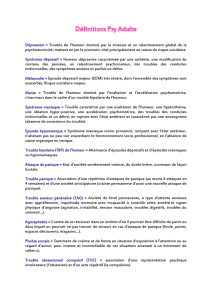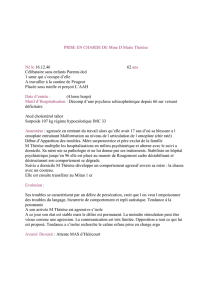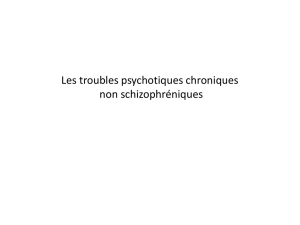Trouble de l`humeur unipolaire dépressif

Résumé
Nous avons tenté de montrer la difficulté nosogaphique entre dépression unipolaire et
paraphrénie, en particulier quand tous les traitements, y compris l'ECT, se sont montrés peu
efficaces.
Mme A a présenté un délire mégalomaniaque avec vécu persécutif. Pendant des années,
imagination et intuitions étaient stables, sans hallucinations.
Ce cas clinique fait penser à la paraphrénie, comme évolution d'un accès de dépression
majeure. Comme s’il existait un continum entre les diverses psychoses.
Notre exposé présente la paraphrénie comme une évolution possible de troubles thymiques, et
soulève la question des délires chroniques, et celle de l'unicité des psychoses.
Mots clés : trouble unipolaire, délire chronique, paraphrénie, fabulation, nosographie
Summary
We aim to see how difficult nosography seems to be between unipolar depression and
paraphrenia, especially when treatments (even with ECT) have had a poor efficacity.
Mrs A. presented megalomania and persecution ideas, and for years lived with a chronic
delusional state. She showed nor dissociation, neither cognitive impairement. She only kept
delusion, after three depressive relapses.
Mechanisms were imaginative, intuitive, without hallucinations, but with little coherence, and
delusion was constantly stable.
This case brings to regard paraphrenia as an evolutionary state of a persistent major
depressive period. It is like a continuum between different kinds of psychosis.
Our talk regards paraphrenia as a secondary process with thymic disorders, and opens as well
the discussion on the nosographic place of chronic delusion, and questions the concept of
single psychosis.
Key words: unipolar disorder, paraphenia, chronic delusional state, confabulation, nosography
2

INTRODUCTION
Nous présentons le cas d’une patiente dont les troubles ont débuté à l’âge de
20 ans, marqués par trois épisodes de décompensation. L’exposé de son
histoire clinique semble particulièrement intéressant alors que nous
constatons l’échec successif des thérapeutiques proposées, posant ainsi la
question du diagnostic, et interrogeant sur les liens entre les différentes
entités diagnostiques en psychiatrie.
HISTOIRE CLINIQUE ET EVOLUTION
Madame A. présente un premier épisode de décompensation en 1972, suite
à la naissance de sa deuxième fille. Le tableau clinique associe alors une
3

symptomatologie dépressive à un délire à thèmes persécutoires et
mégalomaniaques : ayant jeté du pain, elle estime avoir commis des péchés
irréparables, qui vont progressivement anéantir sa famille puis l’ensemble
de l’humanité. Elle a enfreint les commandements de Dieu, et mérite son
châtiment. Elle doit être également punie par la justice des hommes, qui la
surveille par l’intermédiaire de caméras cachées dans les prises et les
interrupteurs de sa maison. La honte, la culpabilité et le sentiment
d’incapacité sont associés à une douleur morale intense.
Plusieurs semaines de traitement antidépresseur permettent une restauration
progressive de l’humeur, jusqu’à la disparition complète des troubles.
En 1984, une nouvelle rechute s’amorce, sans facteur déclenchant retrouvé.
La clinique est similaire à celle du premier épisode ; la prise en charge
institutionnelle permet une nette amélioration thymique, et le délire n’est
plus exprimé directement. Madame A. retrouve son rythme de vie habituel
et reprend son activité professionnelle, pendant plusieurs années encore,
sans manifestations dépressives ou délirantes.
Un troisième accès dépressif débute en 2004, consécutif à l’arrêt de toute
activité professionnelle. Les idées délirantes ont envahi progressivement
tout le champ de pensée de la patiente, reprenant les thèmes habituels, et
s’accompagnant d’éléments mélancoliques, où dominent culpabilité et
indignation.
Les divers traitements chimiothérapiques proposés, de même que
l’électroconvulsivothérapie, restent sans effet sur les symptômes. Seuls les
groupes à médiation semblent apporter un bénéfice par l’amélioration
thymique et la critique partielle du vécu délirant de culpabilité. Le
fonctionnement de la patiente est opératoire, elle agit sans plaisir, de
manière automatique. Elle éprouve un sentiment de vide intérieur, son
cerveau lui semble détruit, ses sentiments sont morts, elle n’a plus de coeur
et est incurable.
APPROCHE DIAGNOSTIQUE ET DISCUSSION
Diagnostic
La clinique objective un trouble de l’humeur évoluant par accès, pour
lesquels des facteurs de déclenchement peuvent être retrouvés. Ces accès
associent une thymie dépressive à des éléments délirants, posant le
diagnostic de dépression unipolaire avec éléments psychotiques.
De nombreux traits du typus mélancolique [3, 29], décrit par Tellenbach en
1961, s’observent chez Madame A., notamment un rapport affectif à la
conscience morale (sentiment constant d’être en faute, sensibilité à la
morale et la religion), et des caractères obsessionnels ou pseudo-maniaques
(obsession de la faute, activités répétitives pour lutter contre le délire
assiégeant).
Kraepelin, en 1907, définit la mélancolie comme « le développement
insensible d’une dépression anxieuse, à laquelle se joignent en proportions
4

variables des conceptions délirantes, dont l’élément principal apparaît
comme étant un certain rapport du sujet à la morale et à la loi ».
Binswanger insiste sur le sentiment de perte comme étant un thème
fondamental de l’état mélancolique [7] ; la perte mélancolique, qui
concerne tous les domaines de la vie, est une évidence pour la patiente : elle
a perdu ses capacités, sa dignité et son honneur à tout jamais.
Selon Georges Dumas, la maladie a une origine intellectuelle : c’est à la
suite d’un événement douloureux ou d’une idée fixe qu’elle se déclare et se
maintient [13]. L’idée délirante, ici celle d’être indigne pour tous les péchés
commis, apparaît la première et forme le pivot de la mélancolie,
déterminant une dépression réactionnelle. L’auteur qualifie de létanie cette
expression réitérée de motifs qui varient peu, l’état mélancolique étant
caractérisé par un délire monotone, reflet de l’invasion lente du Moi par
l’état affectif du malade [9, 13].
La clinique renvoie également aux observations de Cotard sur le délire de
négation du mélancolique [10]. Il s’agit ici d’une forme atténuée (honte,
désespoir, déshonneur, perte irréparable) [21], avec cependant la notion de
négation corporelle (vide intérieur, absence de cerveau, de coeur). L’auteur
rattache ce délire à un état d’anesthésie sensitive. La culpabilité démesurée
et le pouvoir délirant d’un impact sur l’humanité renvoient à la notion
d’énormité, que Cotard nomme « faux délire de grandeur », le délire
prenant ici une forme mélancolique et négative.
Dans ce tableau où prédominent l’immobilité, la péjoration des idées, le
pessimisme, résume bien le « syndrome mélancolique » décrit par Ey. On y
retrouve les deux dimensions fondamentales de la conscience mélancolique,
étant « dans un cas suspendue dans le vide du passé, dans l’autre ouverte
sur le présent et l’avenir comme un gouffre béant » [14].
Diagnostic différentiel
La persistance du délire jusqu’à ce jour réalise un tableau de délire
chronique. Il se différencie du délire schizophrénique par son caractère
relativement systématisé, sa bonne adaptation à la réalité, et par l’absence
de désorganisation et de dissociation [18].
L’association d’éléments thymiques et délirants évoque le trouble schizo-
affectif (TSA), concept évoluant entre les pôles schizophrénique et affectif
[5, 6, 25]. Les troubles thymiques exclusivement dépressifs renvoient au
sous-type dépressif du TSA [1]. Mais ici, la symptomatologie délirante est
toujours congruente à l’humeur, ce qui récuse le TSA.
L’évolution de l’épisode actuel réalise un délire chronique non
schizophrénique, permettant de discuter le diagnostic avec celui de
paraphrénie [16, 18, 19, 23] : le délire, en marge de la réalité
quotidienne n’envahit pas totalement la vie psychique de la patiente ;
ses capacités intellectuelles sont intactes ; les mécanismes sont
essentiellement imaginatifs, intuitifs, sans hallucinations ; le délire
manque de cohérence, reste stable dans le temps, sans ajout
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%