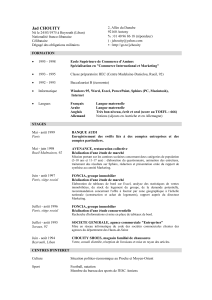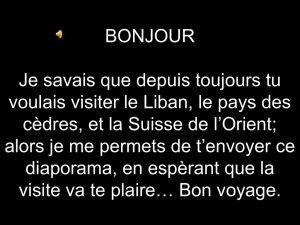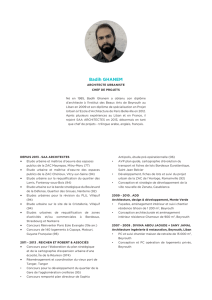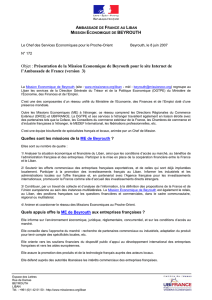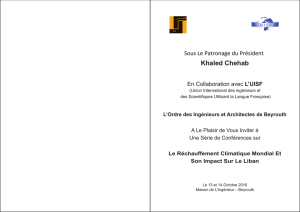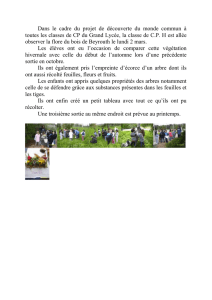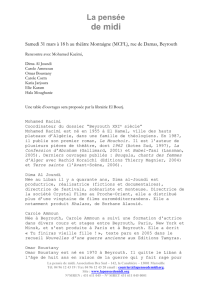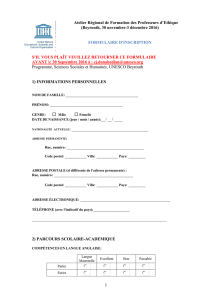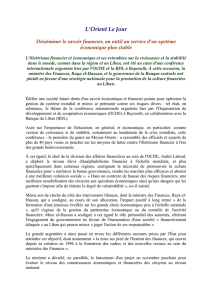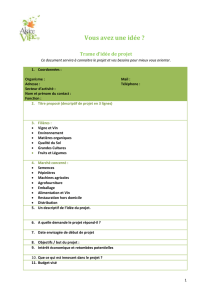l`industrie et le commerce des alcools à la veille du mandat

Page | 1
L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES ALCOOLS À
LA VEILLE DU MANDAT FRANÇAIS - BEYROUTH ET LE
MONT-LIBAN
Rudyard KAZAN - Chargé de cours à la FGM
RÉSUMÉ
Cet article aborde le sujet de l’industrie et du commerce des alcools à la veille
du mandat français, couvrant essentiellement la période 1900 -1920, et ce dans
Beyrouth et le Mont-Liban. Il traite successivement de l’état des entreprises
d’arack et du vin et de leur production, du commerce des alcools et de leur
consommation, de la publicité, des poids et des mesures utilisés à l’époque, et
enfin de l’importance du commerce des alcools par rapport au fisc ottoman.
Mots clés : Commerce des alcools - Consommation des alcools - Fisc
ottoman- Industrie de l’arack- Industrie du vin - Poids et mesures- Publicité des
alcools
1. Introduction
Cet article traite d’un sujet souvent négligé par les chercheurs et ignoré par le
public libanais à la fois dans le contenu, le temps et l’espace, à savoir celui de
l’industrie et du commerce des alcools
1
à la veille du mandat français, couvrant
essentiellement la période 1900 -1920 (correspondant à celle de la fin du
Moutassarifat et du début du mandat français au Liban et en Syrie
2
) , et ce dans
une région déterminée, Beyrouth et le Mont-Liban. Nous traiterons
successivement de l’état des entreprises d’arack et du vin et de leur production,
du commerce des alcools et de leur consommation, de la publicité, des poids et
des mesures utilisés à l’époque, et enfin de l’importance du commerce des
alcools par rapport au fisc ottoman.
2- Des Entreprises de petite dimension favorisant les relations
conviviales entre patrons et ouvriers.
Au début du siècle dernier, il n’existait pas de grandes entreprises industrielles,
et celles des alcools étaient de dimension très petite. Huvelin affirme, dans son
ouvrage « Que vaut la Syrie ? », publié à la veille du mandat, qu’il n’existait en
Syrie que de petites entreprises de production dans lesquelles la division du
1
Il faut distinguer les produits fermentés (vin et bière) des produits distillés qui englobent les
eaux-de-vie (Arack, Whisky, rhum, cognac, etc.), appelés à l’époque alcool de bouche pour les
différencier de l’alcool industriel impropre à la consommation.
2
Le mandat français sur la Syrie et le Liban a été institué par la Société des Nations (SDN), le 25
avril 1920.

Page | 2
travail restait rudimentaire. Le patron y travaille seul ou assisté de quelques
ouvriers avec des capitaux exigus et un outillage grossier. Les métiers sont
groupés par quartier dans les bazars. Les ateliers s’ouvrent sur la rue et servent
en même temps de magasin de vente (Huvelin : 26). Il affirme aussi qu’il
n’existait pas en Syrie cent entreprises groupant dans le même atelier plus de
cinquante travailleurs. Il n’y en a pas une qui compte plus de trois cents. Il ajoute
que « cet émiettement de la fabrication, la médiocrité de l’outillage, l’infériorité de
la technique handicapent fortement le fabricant syrien par rapport à ses
concurrents étrangers » (Gemayel : 11).
Cette vision est corroborée et complétée dans le rapport des autorités du
mandat de 1928 adressé à la Société des Nations. Ce rapport affirmait ainsi que
« la plupart des ateliers sont familiaux soit que le chef de famille vende
directement son travail, soit qu’il travaille pour un entrepreneur…Il serait
prématuré de dire que l’industrie, au sens européen du mot, existe dans les pays
de mandat français… Dans les ateliers familiaux…le travail n’exige en aucune
manière une tension analogue à celle qui est exigée des ouvriers dans les
ateliers modernes… » (Gemayel : 11). Généralement, l’unité artisanale était
composée d’un maître-artisan qui groupait autour de lui quelques ouvriers
choisis le plus souvent parmi ses parents proches ou éloignés. Les conventions
de travail étaient basées sur la confiance réciproque et sur des considérations
morales beaucoup plus que sur les règles impératives de droit ; il s’agissait le
plus souvent d’un accord verbal entre patron et ouvrier (Gemayel : 15).
Ainsi, durant les premières décennies du XXᵉ siècle, l’origine sociale des
patrons qui étaient le plus souvent d’anciens employés ou des paysans, conférait
aux rapports entre employeur et ouvrier un caractère de cordialité et de
bonhomie. L’ouvrier qui connaît le plus souvent le curriculum vitae et le passé
modeste de son patron pouvait difficilement lui envier une situation qui ne
ressemblait, en rien, au patronat héréditaire. La fortune et la position sociale de
l’employeur ne pouvaient apparaître comme le droit exclusif d’une classe
déterminée : l’observation et le simple bon sens indiquaient qu’elles pouvaient
être convoitées et acquises par chacun, s’il est doué d’une certaine habileté,
d’une endurance au travail, d’un sens spéculatif (Donato : 20).
On retrouve cette même simplicité dans les considérations qui président à
l’embauchage des ouvriers ; il n’était pas question à l’époque d’exiger du
prolétariat une formation technique, une certaine qualification professionnelle ;
l’employeur engageait de préférence des ouvriers de son village, de sa région,
de sa communauté religieuse (Donato : 20).
Quelques-uns lui étaient recommandés par ses amis, par sa clientèle.
Les obligations sociales qui sont aujourd’hui mises à la charge du patron, en
vertu d’une législation spéciale, étaient exécutées assez souvent de manière
spontanée ; les patrons ou leurs épouses venaient en aide à leurs ouvriers

Page | 3
quand ceux-ci se mariaient ou mariaient leurs enfants, quand ils avaient besoin
de soins médicaux, etc.(Donato : 20)
L’ouvrier à son tour, vouait fidélité au patron ; il lui rendait, en marge de
son activité professionnelle, certains petits services, et se considérait comme
étant son homme. Le prolétariat libanais n’étant pas organisé politiquement en
ce temps-là, les ouvriers embrassaient les idées et points de vue politiques de
leurs patrons (Donato : 20).
Un ingénieur français qui avait séjourné longtemps au Liban écrivait :
« D’ailleurs dans ce groupe humain assez réduit qu’est l’usine libanaise, chacun
se connaît. Et l’on sait que lorsque des hommes qui se connaissent sont en
rapport, ils ne pèsent plus l’un par rapport à l’autre leur poids social, mais leurs
poids d’intelligence, de volonté, d’initiative de sens des situations et des
psychologies. » (Uhry : 12)
Ce point de vue est corroboré par Mills qui affirme dans un ouvrage publié
au milieu du siècle dernier, que, dans les petites industries au Liban, le
caractère paternaliste y prédomine (Mills : 71). Mills affirme que dans ce type de
management c’est le patron qui gère tout n’acceptant aucune interférence ou
objections des hommes sous sa main. De plus, comme l’affirme Shams qui
pense que ce type défini ci-haut par Mills est applicable aux industries des
alcools, le changement d’employés (labor turnover) est pratiquement nul. De
plus, la plupart de ces entreprises sont des sociétés de personnes (Mills : 71).
Ainsi, à l’aube du mandat les entreprises étaient artisanales. Le mandat
instaura un protectionnisme douanier qui fit disparaitre l’industrie artisanale au
profit de l’industrie manufacturière. Au Liban, l’activité industrielle englobait
surtout le domaine agroalimentaire, du bâtiment (cimenterie de Chekka) de
l’habillement et du cuir (Moussali : 49-54). Et nous verrons apparaitre dans les
années 1930 quatre distilleries industrielles ce qui augmenta largement la
production
3
.
3
Durant la période du mandat français, quatre distilleries opéraient au Liban. La première grande
distillerie, la « Fabrique d’Alcool » de Bhamdoun de la famille Abdel Nour date de 1927. Trois
autres distilleries sont fondées durant les deux années qui vont suivre : la Distillerie de Friedrich
AberleàJal el Dib (1928), celle de Melissinde à Tripoli et, en 1929, et, la plus moderne de toutes,
« La Société Nationale Industrielle » à Dora (dans la banlieue nord de Beyrouth), fondée sous
forme de société anonyme au capital de 25 000 Livres Sterling réparties en 6 250 actions.Son
conseil d’administration comprenait onze membres. Il était présidé par le député NaoumBakhos.
Le vice-président était Youssef Gemayel, également membre de la Société de Chimie Industrielle
de France. Cf. « Chronique des Industries libanaises. II. Alcool – Distillerie », Le Commerce du
Levant, 15 mai 1931, pp. 1-2

Page | 4
3- Une production limitée à l'arack et au vin
Au début du XIXᵉ siècle, le Moutassarifat du Mont-Liban produisait 20 000
quintaux
4
de raisin, 1 000 quintaux de vin et 300 quintaux d'eau-de-vie à 50, 40
et 250 paras
5
le quintal respectivement.
Dans un article sur l’industrie libanaise publié dans un recueil édité par
Ismail Hakki Bey dernier Moutassarif du Mont-Liban, Asfar affirme que l’arack est
considéré comme « une des boissons nationales » du pays et que sa fabrication
« était courante » dans le Mont-Liban (Hakki : 67). Toujours selon lui, il était
exporté en Egypte et en Amérique. Deux régions du Moutassarifat se
spécialisaient dans cette fabrication : Zouk (banlieue est de Beyrouth) et la ville
de Zahlé (dans la Bekaa) qui en produit la plus large quantité (35 000 kg de vin
et 100 000 kg d’arack annuellement selon les registres de la dette publique
ottomane) (Hakki : 67). Quant au vin, il était produit dans plusieurs régions du
Metn et du Kesrouan (Khonshara, Bteghrine, Salima, Bhaness, Bickfaya, Beit-
Chebab, Zekrit, Zouk Mosbeh, Ghazir, Rayfoun, Sebaal) (Hakki : 35).
Jouplain affirme, quant à lui, que la vigne était l’une « des principales
ressources du pays » et réussit parfaitement bien sur les coteaux à côté des
mûriers et des oliviers. Il dit aussi que « les fins gourmets apprécient très bien les
vins du Caza du Kesrouan, connu sous le nom de vin d’or du Liban ». Quant aux
autres vins du pays, il affirme qu’ils sont excellents mais que leurs valeurs
diminuent d’année en année en raison de leur mauvaise fabrication (Jouplain :
109).
Mais Jouplain nous donne des chiffres et données sensiblement différents
de ceux d’Asfar, bien que les deux auteurs aient écrit leurs ouvrages à peu près
à la même époque. Ainsi, pour Jouplain la récolte moyenne de raisin est de 4,5
millions de kilos par ans. Il estime la fabrication du vin à 350 000 kilos. Quant à la
surface de la vigne, elle était de 2 500 hectares. Concernant la production par
région, Jouplain affirme que les vignobles les plus renommés sont ceux des
coteaux de Zahlé qui forment selon lui l’unique culture de la région. Zahlé produit
en moyenne 75 000 kilos de vin et 550 000 kilos d’arack. Jouplain cite aussi qu’il
y a 84 vignobles à Ehden et 180 dans le caza du Koura. Sans plus donner des
chiffres il affirme qu’il y avait des vignobles dans les villes de Bhamdoun et de
Barouk (dans le Chouf) et de Jbeil et Mairouba (dans le Kesrouan), et enfin de
Chouair (dans le Metn) (Jouplain : 497).
Quant à Huvelin,il affirme que la vigne réussit à merveille dans beaucoup
de régions en Syrie (c’est-à-dire dans la Syrie et le Liban actuels). Elle pourrait,
selon lui, rendre infiniment davantage et de meilleurs produits. Le vignoble
s’étend sur 84 298 hectares et produit 300 000 à 350 000 tonnes de raisin. La
fabrication du vin, concentrée dans le Liban, n’utilise qu’une faible partie de la
récolte. Les raisins qui ne sont pas consommés frais servent à fabriquer du Dibs
4
1 quintal = 66 700 grammes
5
Petite monnaie de cuivre en usage dans l’Empire ottoman et à valeur variable selon les pays

Page | 5
(gelée cuite), l’arack, ou sont transformés en raisins secs. L’exportation des vins
est insignifiante (Huvelin : 18).
Mais toujours selon Huvelin, « le commerce des alcools de bouche,
liqueurs, vins et bières, n’a en Orient qu’une importance secondaire : la clientèle
musulmane ne consomme pas de boissons fermentées ». Toutefois, il ajoute
qu’il « existe une population chrétienne indigène et une population étrangère
suffisantes pour fournir à l’importation de ces articles certains débouchés. Quant
à l’alcool de qualité inférieure, produit par la distillation du seigle, des pommes de
terre ou du riz, il sert à la fabrication de l’arack (Huvelin : 18).
Concernant la fabrication de l’alcool, le voyageur britannique
Morewood affirme, dans un ouvrage publié en 1838, que la capitale de Syrie
distillait des raisins secs en y ajoutant de la semence d’anis. Mais seuls les
chrétiens et Juifs avaient le droit à fabriquer de l’alcool (Morewood : 45). Citant
des voyageurs il mentionne que le vin était produit en abondance en Syrie. Le
miri pour chaque cents plants de vigne était de l’ordre de 10 paras. Il dit que le
plus célèbre des vins est le vin d’or du Mont Liban (Morewood : 46).
Tableau I
IMPORTATIONS D’ALCOOLS
Année 1919
Produits Quantités Valeur Origines
Moyenne en tonnes Moyenne en francs
Alcool de grain
Et de Pomme de terre 460 200 000 Russie, Autriche, Java
Vins en fûts et
En Bouteilles 300 150 000 Chypre, Grèce, France
Liqueurs (Cognac, Kouniac grec,
Mastic, Chartreuse, whisky, etc.) 215 300 000 Allemagne, Autriche, Amérique
Source
Paul Huvelin, Que vaut la Syrie ?, Chambre de commerce de Marseille, Congrès français de la Syrie, Paris, Librairie Ancienne
Honoré Champion / Edouard Champion, 1919, p. 44
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%