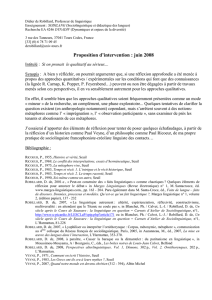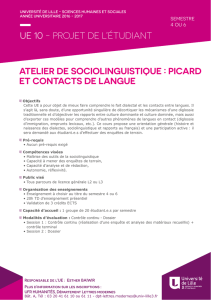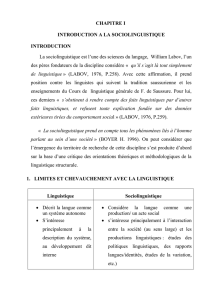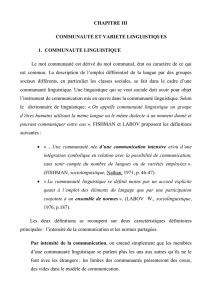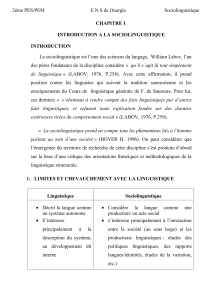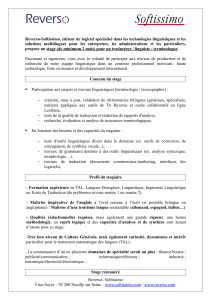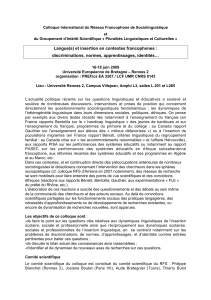blanchet CAS n°1

1
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 1
Quels « linguistes » parlent de quoi, à qui, quand, comment et
pourquoi ?
Pour un débat épistémologique sur l’étude des phénomènes
linguistiques1
Philippe Blanchet
CREDILIF-ERELLIF (EA 3207)
Université Rennes 2 Haute Bretagne
philippe[email protected]
Résumé
Ce texte propose une analyse des enjeux épistémologiques de la crise
existentielle actuelle des sciences du langage, du point de vue de
sociolinguistiques perçues comme dominées dans ce champ par
l’hégémonie des structurolinguistiques. Constatant les émergences
sociohistoriques parallèles de ces grands courants théoriques, il
propose une autre configuration du champ scientifique et institutionnel
des sciences du langage n’impliquant ni action/réaction, ni notions de
marges ou de noyau dur, ni notions de recherche fondamentale ou
appliquée. Il s’agit alors de poser une question radicale : « mais de quoi
parlent les linguistes ? » et de soulever, en utilisant l’exemple de la
phonologie, le paradoxe épistémologique de ces structurolinguistiques
qui appliquent une démarche « asociale » à un objet « social ».
Analysant ensuite les structurolinguistiques comme des produits
historiques de leur contexte idéologique et intellectuel, il présente
comme un renouvellement épistémologique l’adoption d’une
épistémologie de la complexité en sciences du langage. Il en illustre la
portée heuristique avec l’exemple de la conceptualisation des « unités
multiplexes sociolinguistiques ». Le choix concomitant d’un paradigme
interprétatif amène à mettre l’accent sur la notion, parfois surexploitée,
de « représentation » et, dès lors, à affirmer plus avant la pertinence de
1Ce texte a été rédigé grâce à des interactions régulières et stimulantes avec Louis-
Jean Calvet et Didier de Robillard que je tiens à remercier ici. Cette rédaction a été
parallèle à la lecture de la thèse de Valentin Feussi (Une construction du français à
Douala – Cameroun, Tours, 2006, dir., D. de Robillard) et a largement bénéficié des
stimulations provoquées par ces travaux théoriques et de terrain. Que Valentin Feussi
en soit doublement remercié.

Ph. Blanchet
2
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 1
ce concept dans un cadre profondément constructiviste. Ce qui le pose
comme principe épistémologique fondamental dans une alternative aux
sciences positives et quantitatives. Les conséquences scientifiques et
sociales de cette reconstruction de la linguistique sont exemplifiées dans
l’enseignement des langues et les politiques linguistiques, par les
concepts de « compétence plurilingue » et d’« individuation
sociolinguistique ».
1. Le dominé comme révélateur : enjeux épistémologiques
d’une crise existentielle pour les sciences du langage
Depuis bientôt un demi-siècle que s’est affirmé clairement un
courant (socio)linguistique alternatif à un courant
(structuro)linguistique2d’abord structuraliste (d’inspiration
saussurienne) puis générativiste (et nombre de ses avatars cognitivistes
plus récents3), cette autre façon alternative de penser et de concrétiser les
sciences du langage n’a eu de cesse de se poser en s’opposant. La
plupart des ouvrages de présentation ou d’introduction à « la »4
sociolinguistique, sinon tous5, et la plupart des thèses en ce domaine,
sinon toutes, commencent par une attaque en règle contre « la »
linguistique dite « interne, structuro-générative, etc. », afin de justifier la
pertinence, voire l’existence même, de l’approche choisie. Cette
question a occupé beaucoup des textes et débats portant sur des
Perspectives théoriques en sociolinguistique et publiés dans Blanchet et
Robillard, 2003. Face à la « crise de la linguistique », les sociolinguistes
ont développé une insatisfaction, y compris à cause de la réception
insuffisante des réponses qu’ils y proposaient, insatisfaction qui semble
les avoir conduits à une sorte de « crise existentielle » qui révèle une
2Pour la commodité de l’exposé, je distinguerai les sociolinguistiques et les
structurolinguistiques, faute de mieux (voir les termes alternatifs proposés ici même
par D. de Robillard), en maintenant des pluriels qui englobent des variantes diverses
réunies sous chaque intitulé.
3Mais pas tous, ou en tout cas pas au même degré, cf. François, 2004.
4Le singulier insiste à raison sur les principes communs mais évite, à tort, les
variantes de mise en œuvre de ces principes.
5Il n’y a guère que l’école de Montpellier (R. Lafont, H. Boyer) qui accepte la
dichotomie saussurienne Langue/parole et qui situe la sociolinguistique comme une
linguistique de la parole en quelque sorte complémentaire de la linguistique de la
Langue (Lafont, 1983, 11-13 ; Boyer, 1996, 5-6).

Ph. Blanchet
3
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 1
crise épistémologique touchant l’ensemble du champ des sciences du
langage. J’ai moi-même en partie sacrifié à ce rituel d’individuation, au
moins en soulignant l’ensemble de ces discours (Blanchet, 2000, 80 et
suiv.), car la perspective plus franchement épistémologique de ma
Linguistique de terrain justifiait probablement la nécessité accrue - on se
rattrape comme on peut - d’une telle démarche (même motivation chez
Calvet 2004, 102-136 à propos de Chomsky). Ces modalités sociales et
sociopolitiques de construction des pratiques et des institutions
scientifiques me semblent devoir être rappelées, néanmoins, puisque je
crois qu’il n’y a pas de science neutre indépendante de son contexte.
1.1. Structurolinguistiques et sociolinguistiques : des émergences
sociohistoriques parallèles
Cette argumentation est souvent présentée en termes historiques,
comme une émergence issue des limites mêmes, rapidement rencontrées,
des structurolinguistiques issues du cours de F. de Saussure. Comme
dans certaines sciences à dominante hypothético-déductive, où l’on tente
d’expliquer certains phénomènes par la « théorie Machin » ou la
« théorie des bidules », et où l’on élabore de nouvelles théories quand
l’explication par Machin ou les Bidules ne fonctionnent pas, on aurait
élaboré une théorie sociolinguistique pour expliquer ce qu’une théorie
structurolinguistique peine à expliquer.
Sur le plan strictement chronologique, c’est sans doute une erreur
d’appréciation. Comme plusieurs d’entre nous l’ont montré, de
Marcellesi et Gardin (1974) à Calvet (1993) et moi-même (2000), ces
variantes ethno-socio en linguistique (qu’en première approximation je
qualifierai d’approche « contextualisante, historicisante et
complexifiante des phénomènes langagiers », les LICH de D. de
Robillard ici-même), se sont développées de façon parallèle aux
structurolinguistiques d’inspiration saussurienne (les LSDH de D. de
Robillard et les OLNI de L.-J. Calvet ici-même) au moins depuis le
XIXème siècle, via les comparatistes, philologues, dialectologues… puis
avec Meillet, Labov, etc. (je ne reviens pas sur cette filiation
intellectuelle désormais connue). Certains vont même jusqu’à dire que
« la » linguistique saussurienne et ses suites constituent une parenthèse à
refermer entre les approches historicisantes du XIXème et le renouveau
sociopragmatique de la fin du XXème. Il est vrai que les linguistiques de

Ph. Blanchet
4
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 1
cette obédience ont connu une expansion exponentielle dans les années
1950-70, au point de devenir hégémoniques et que l’on a pu se
demander si « le vingtième siècle a été le siècle de Saussure » (Chevalier
et Encrevé, 2006). Ce serait oublier, néanmoins, la profondeur des
racines historiques de l’approche logicienne des « langues » qui fonde
épistémologiquement les structurolinguistiques et qui remonte à Platon
via les grammaires traditionnelles (cf. infra et D. de Robillard ici-
même). L’affaire est plus complexe qu’une simple dichotomie. Et les
sociolinguistiques partagent, du reste, quelques sources communes
exploitées de façon différente (la philologie comparée, par exemple, où
les « contextualistes » ont vu avant tout l’importance d’une inscription
socio-historique des fonctionnements linguistiques pour les interpréter et
où les « structuralistes » ont vu avant tout des régularités de formes et
d’évolutions linguistiques pour les classifier, cf. infra). On retrouvera
tout au long de leurs histoires globalement parallèles (et rarement
orthogonales), des croisements de ce type qui donneront lieu à de
nouvelles divergences :
-par exemple avec la linguistique fonctionnelle de Martinet, que
L.-J. Calvet - qui en est issu - range du côté du structuralisme (Calvet,
1993, 19 ; 2003, 18 et 2004, 184) et que je vois moi-même - qui l’ai
découverte comme une alternative salvatrice au générativisme que
j’avais subi dans ma formation d’angliciste - avant tout comme une
remise en question fondamentale du structuro-générativisme « dur »
(Blanchet, 2000, 51 et 2002), plutôt suivi en cela par D. de Robillard
(2003) ;
-par exemple avec la « pragmatique du langage ordinaire » (théorie
des actes de langages) également intégrée en sémantique formelle et
cognitive (cf. Moeschler et Auchlin, 1997 ; Victorri, 2004, 97) et en
sociolinguistique interactionnelle (Gumperz, 1989 ; Blanchet, 1995),
mais de façon divergente.
L’explication par les limites explicatives de certaines théories ne
semble pas plus convaincante (d’autant qu’elle implique la vision
chronologique invalidée ci-dessus). Les sociolinguistiques sont
clairement affichées comme construisant radicalement d’autres
« objets » (ou plutôt différents phénomènes) et non comme proposant
d’autres explications aux problèmes descriptifs/explicatifs des

Ph. Blanchet
5
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 1
structurolinguistiques quant à leurs objets : on est bien dans des sciences
du langage hétérogènes et pas seulement hétéroclites, pour reprendre la
formulation de L.-J. Calvet ici même (on ne contribue pas à la
confection du même plat, on élabore des menus différents, pour
poursuivre sur sa métaphore de la cuisine).
1.2. Ni marges ni noyau dur : une autre configuration du champ
scientifique et institutionnel
En revanche, sur le plan des relations symboliques, sur le « marché
scientifique » pour le dire façon Bourdieu, cette vision en successivité
s’explique probablement par une relation de type dominant/dominé
profondément intégrée chez de nombreux sociolinguistes et qui renvoie
à une satellisation caractéristique des processus de minoration6, c’est-à-
dire à une relation centre/périphérie (cf. infra). Ceci tient à deux raisons
principales, je crois. D’une part, au fait que, à l’évidence, c’est la
variante que je qualifierai en première approximation d’approche
« réifiante, réductrice et mécaniste » de la linguistique (les LSDH) qui a,
au cours du XXème siècle, été hégémonique (imposant ses modèles et
occupant dès lors l’essentiel de l’espace institutionnel et discursif) ;
d’autre part, au fait que, étudiant des phénomènes langagiers définis
comme des « pratiques sociales hétérogènes et ouvertes »7, concentrés
sur la variabilité de ces phénomènes observés sur le terrain via une
empathie ethnographique, les sociolinguistes se sont surtout consacrés à
des pratiques, à des locuteurs, à des groupes sociaux et à des situations
souvent majoritaires en nombre mais hors des normes sociopolitiques
hégémoniques, notamment académiques et linguistiques (usages
linguistiques réputés « déviants », locaux, de groupes sociaux minorisés,
« exotiques », etc.). Cela les a conduits à adopter ou à renforcer en eux
(puisqu’ils sont souvent issus des groupes linguistiques et praticiens des
variétés qu’ils étudient) la posture du dominé8. Il y aurait beaucoup à
6Sur ce point voir Marcellesi, 2003 et Blanchet, 2005, ainsi que, sous une autre
terminologie, à Calvet, 1999 (modèle gravitationnel).
7Soit l’inverse du « système homogène et clos » de Saussure et de ses suites.
8J’avoue d’ailleurs me trouver dans cette situation et m’amuser de ma propre tendance
- au moins elle est consciente ! - à opter dans de nombreuses alternatives pour les
positions minoritaires quantitativement/qualitativement : avoir un ordinateur Apple,
habiter à la campagne, adhérer à un syndicat non majoritaire, ne presque pas regarder la
télévision, écrire des poèmes en provençal, apprendre l’haoussa et l’arabe maghrébin,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
1
/
66
100%