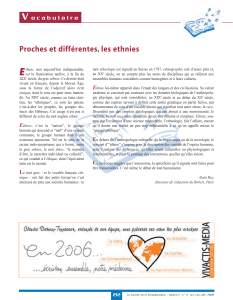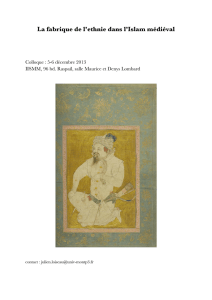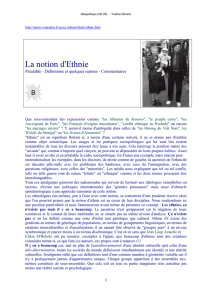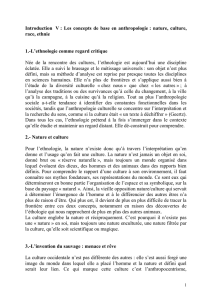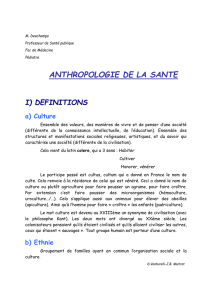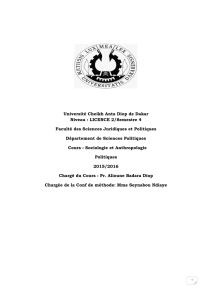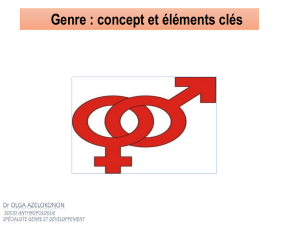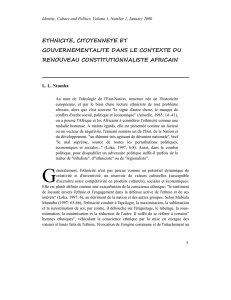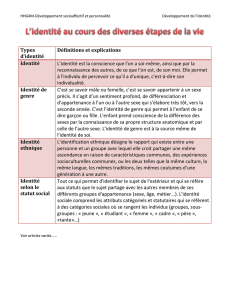LE POUVOIR DE L `ETHNIE

L EPOUVOIR DE L’ ETHNIE


PaulAbouna
L EPOUVOIR DE L’ ETHNIE
Introduction à l’ethnocratie
Préface de Mbonji Edjenguèlè

©L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-56577-7
EAN : 9782296565777

A
Mon frère aîné Martin Ombga Zing, brutalement soustrait àlavie dans un
accident d’avion le05 mai 2007 àDouala.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%