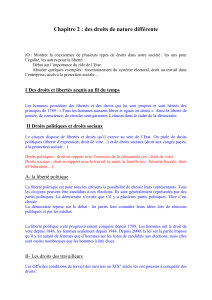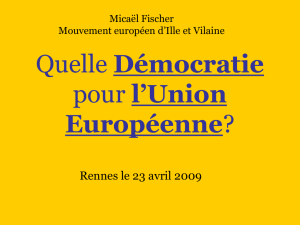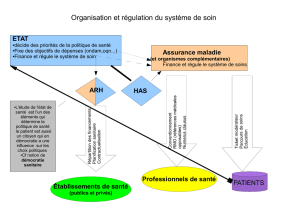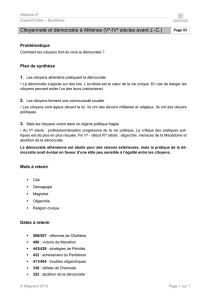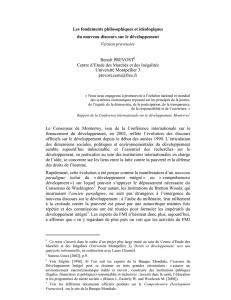RELATIONS PARENTS/ENFANTS

1
RELATIONS PARENTS/ENFANTS
© Réussir n° 27 – Déc. 1994
Michel FIZE, CNRS/Centre de Recherches Interdisciplinaire de Vaucresson, auteur de « la
démocratie familiale » (Ed. Presses de la Renaissance).
L’évolution des relations parents/enfants de 1945 à aujourd’hui
Une citation me paraît tout à fait appropriée à notre sujet ; Durkheim, le père fondateur de la
sociologie française, a écrit au début du siècle : « c’est un postulat essentiel de la
psychologie qu’une institution humaine ne saurait reposer sur l’erreur et le mensonge, sans
quoi elle n’aurait pu durer. Si donc elle dure, c’est parce quelle doit correspondre à certains
besoins, à certaines fonctions en d’autres termes qu’elle a sa raison d’être ».
Il en est ainsi de la famille à propos de laquelle aujourd’hui on dit à peu près tout : cette
famille, on l’aime nous disent tous les sondages ; elle est une sécurité ; mais on dit aussi
qu’elle est en crise, éclatée, morcelée, à l’abandon, démissionnaire, impuissante,
maltraitante et maltraitée. Les qualificatifs sont nombreux, on parle aussi de famille
patriarcale, matriarcale, de famille nucléaire et de la famille élargie, de famille autoritaire et
de famille démocratique, de famille unie et de famille désunie. On a un peu l’impression que
la famille d’aujourd’hui ressemble à ces grandes actrices qui changent régulièrement de
parures, qui se plaisent à modifier leur visage et qui, bien sûr, nous troublent chaque fois un
peu plus et nous laissent dans l’incertitude.
La famille moderne : ses caractéristiques
La première question à se poser est peut-être de se demander à quoi ressemble cette
famille moderne, qui a connu au cours de ces trente dernières années une véritable
révolution, une révolution qui n’affiche pas son nom (on n’a pas dit, comme en 1789, on va
faire la révolution, on va changer de régime) mais plutôt une révolution silencieuse, et peut-
être un peu sournoise. Les changements se sont effectués d’une manière progressive mais
profonde.
Quels sont les signes les plus visibles ?
• La baisse du taux de fécondité, soulignée par tous les démographes et qui commence
dès 1964.
• La baisse du nombre des mariages et l’introduction des consentements mutuels qui va
engendrer parallèlement la montée du divorce et l’augmentation des familles
monoparentales qui représentent maintenant à peu près 10 % des familles.
• Le développement des naissances hors mariage qui atteignent selon les dernières
statistiques 30 % de l’ensemble des naissances dans notre pays.
• La disparition de la puissance paternelle héritée de l’antiquité grecque et romaine au
profit de l’autorité parentale avec de temps à autre l’introduction d’un débat autour de la
responsabilité parentale comme dans le système allemand.
A côté de cela, il y a des changements moins connus qui concernent les rapports intra-
familiaux dans la vie de tous les jours et qui relèvent de l’intimité des familles qu’il n’est pas

2
toujours facile d’observer et donc de qualifier. Quelles sont donc les modifications qui
peuvent être notées au cours de ce dernier demi-siècle, dans les relations
parents/adolescents que j’ai particulièrement étudiées, étant entendu que dans bien des
domaines le terme « adolescent » peut être remplacé par « enfant ».
Au niveau des idées d’abord, il y a, trois évolutions marquantes :
• Le progrès de la démocratie politique, ce qui ne veut pas dire le progrès de la perfection
politique, sinon on risquerait en parlant de démocratie, d’accréditer tel ou tel régime. Le
progrès de la démocratie politique est quelque chose d’important si on se réfère à
l’analyse d’Alexis de Tocqueville qui a bien montré le lien étroit qui existe dans les deux
sens entre le progrès de la démocratie politique et les progrès de la démocratie familiale.
Vous vous souvenez sans doute de l’idée de la participation qui s’est développée en
1968 en même temps qu’à cette époque on assistait à l’effondrement de tous les
systèmes d’autorité. Là est vraiment l’événement révolutionnaire : quand on parcourt
l’histoire, on s’aperçoit que l’autorité a pu ici ou là, à certaines périodes, être contestée,
mais jamais dans sa légitimité. A partir du moment où le rapport de force était détenu par
tel ou tel groupe, le changement pouvait s’opérer entre les dominés et les dominants.
• L’affirmation de ce que j’appellerai les mouvements féministes, ce qui est extrêmement
important pour l’évolution du statut de la femme mais également pour celui de l’enfant :
car l’histoire nous enseigne que là où le statut de la femme se trouve amélioré par
rapport au statut de l’homme, l’enfant en bénéficie à son tour. Donc, tout progrès dans le
statut de la femme équivaut très souvent à un progrès dans le statut de l’enfant.
• Le développement de l’idéologie psychanalytique, la dernière des grandes idéologies a-t-
on dit ; ce n’est pas la psychanalyse qui est ici en question mais ce qu’on fait notamment
dans les médias et ce que les familles en ont retenu. Ainsi toute une série de familles ont
été formées à cette idée qu’il ne fallait pas interdire sous prétexte que cela risquait
d’entraîner un traumatisme affectif chez l’enfant. Vous vous souvenez du slogan de
1968 : « il est interdit d’interdire », on a donc agité cette menace du traumatisme affectif
qui aurait pu résulter des interdictions faites à l’enfant, ce qui a provoqué excès et
débordements.
Au niveau socio-démographique deux évolutions sont à souligner :
• L’expansion des couches moyennes qui se sont révélées être une classe libérale sur le
plan des idées, soucieuse au surplus de propager un modèle culturel à l’ensemble de la
société. Ce constat est extrêmement intéressant et novateur, car on n’a jamais vu dans
l’histoire, à ma connaissance, un mouvement des idées partir du centre. En général, cela
vient d’en haut : au 19ème siècle, le changement vient des classes favorisées et donc de
la bourgeoisie et descend progressivement vers les autres catégories sociales. Ici le
mouvement est parti du centre et ses ramifications se sont étendues vers le haut et vers
le bas. Vers le haut c’est-à-dire remontant vers ce qu’on appelle de moins en moins la
bourgeoisie mais qui correspond encore à quelque chose de précis sur le plan culturel ;
vers le bas, c’est-à-dire descendant vers les catégories urbaines salariées donc les
familles ouvrières (ou ce qu’il en reste aujourd’hui) et vers les familles rurales avec dans
ce cas un certain décalage dans le temps.
• L’affirmation d’une nouvelle classe d’âge « l’adolescence », très bien décrite par Edgar
Morin dès 1963. C’est un phénomène qui me paraît capital à la fois parce que c’est une
classe d’âge qui devient quantitativement importante (les adolescents des années 60
sont les enfants du baby boom) et parce que c’est une classe en voie de scolarisation
massive. L’enseignement secondaire autrefois réservé à l’élite sociale du 19ème siècle,
donc aux enfants de la bourgeoisie, s’ouvre à toutes les catégories sociales, ou en tout
cas à de plus en plus de catégories sociales dans un mouvement qui n’a pas cessé de
s’affirmer depuis 30 ans. On passe de 100 000 élèves dans l’enseignement secondaire
en 1900, à 1 million en 1950 et à 2 millions en 1960 ; c’est-à-dire qu’en une décennie le

3
nombre des enfants scolarisés dans l’enseignement secondaire a été multiplié par deux ;
on est passé de l’adolescence pour quelques-uns à l’adolescence pour tous, étant
entendu qu’on ne peut parler d’adolescence qu’à partir du moment où l’on voit s’affirmer
une classe d’âge en milieu scolaire, c’est-à-dire une classe d’âge qui va prendre un peu
ses distances par rapport à la famille. La première grande atteinte à l’équilibre familial a
été précisément l’introduction de l’enseignement laïque et obligatoire à la fin du siècle
dernier, car la famille n’est plus dès cet instant la seule source du savoir et doit affronter
une autre source de savoir dispensée par les maîtres et les enseignants de
l’enseignement public.
Il est essentiel d’ajouter que cette classe d’âge nombreuse et scolarisée va se réunir
autour d’une culture propre qu’Edgar Morin va appeler la culture adolescente. Cette
culture se réfère d’abord à deux grandes figures emblématiques du cinéma américain
« L’équipée sauvage » en 1955 avec Marlon Brando et plus encore « La fureur de
vivre » en 1957 avec James Dean dont on parle toujours 35 ans après.
L’amorce de ce mouvement important de culture adolescente va sonner le début des
grandes difficultés familiales parce qu’à mon avis cela va enclencher un métabolisme
dont on subit le choc aujourd’hui, ce choc qu’on va appeler le fossé des générations.
Cette culture adolescente se traduit dans le fait que la culture des enfants ne sera plus
ou sera de moins en moins la culture des parents : on préfère s’habiller jeune et ne plus
copier l’habillement des parents : on va vouloir écouter sa musique jeune plutôt que
celle des parents. C’est un phénomène qui touche tous les adolescents quels qu’ils
soient : si vous allez dans les « beaux quartiers », vous trouverez des jeunes
« branchés » rock, hard rock ou même rap de préférence à la musique de leurs parents.
Il y a maintenant chez les jeunes la conscience d’appartenir un peu à une classe d’âge
qui a pris ses distances, et largement ses distances, avec la génération aînée.
Comment fonctionne la famille moderne ?
Je crois que sur le nouvel ordre juridique familial s’est greffé un nouveau type de
relations entre époux, entre parents et enfants en prenant le terme enfant au sens
large : nouveau type de relation que j’ai appelé « démocratie familiale » et que j’ai défini
pour qu’il n’y ait pas de confusion dans les esprits comme une sorte de rééquilibrage du
rapport des forces au sein de la famille au profit des enfants. Je pèse tous mes mots et
je dis bien rapport de forces parce qu’on est sorti d’un régime de droit pour introduire
précisément un régime de force avec évidemment toutes les dérives possibles : rapport
de force verbale ou physique. Il y a de la violence verbale dans la famille moderne et
parfois de la violence physique dans les deux sens : il existe des enfants maltraités mais
aussi des parents martyrs. On ne parle plus beaucoup actuellement de ce deuxième
phénomène mais j’aurai tendance à penser que, comme pour le phénomène des
bandes, il est peut-être plus fréquent et présent qu’on ne le croit.
Quelles sont les données marquantes de ce nouveau type de relation, de cette
démocratie familiale ?
• C’est un régime où le contenu est plus important que la forme : un régime peu
formaliste, qui a abandonné la politesse des mots, l’attention aux mots, un régime
qui voit s’effacer ce qu’on appelait autrefois les règles de préséance. Avant, les
parents avaient la priorité dans l’occupation de certains lieux, la salle de bains par
exemple ; aujourd’hui, c’est celui qui est le plus pressé, celui qui doit s’en aller le
premier qui passe avant les autres. De même, l’obligation des réunions communes,
notamment au moment des repas, a perdu du terrain ; si on peut tous se réunir pour
le repas du soir, c’est déjà une belle performance. Donc, la famille moderne
fonctionne moins selon un code de conduite un peu formalisé et davantage dans la

4
spontanéité et en fonction des impératifs des uns et des autres et par conséquence
en fonction de la force des uns et des autres.
• Les statuts des uns et des autres importent moins que les compétences ou les
valeurs personnelles des individus. Il reste bien sûr des parents d’un côté et des
enfants de l’autre mais parents et enfants ne sont plus placés dans cette relation
hiérarchique qui était symbolisée autrefois par cette attitude extrêmement simple qui
se résumait dans la formule « j’ai raison parce que je suis ton père ». C’était alors le
statut du père qui cautionnait le bien fondé du propos. Il n’y a plus aujourd’hui cette
relation hiérarchique stricte mais plutôt une relation qui s’apparente à ce qu’on
pourrait appeler la citoyenneté familiale, c’est-à-dire qu’on essaye de pratiquer
aujourd’hui une citoyenneté de droits et de devoirs.
• Ce régime est un régime de libertés et de droits pour les adolescents. C’est vers les
années 70 que les enfants sont partis à la conquête des libertés : libertés
vestimentaires, liberté pour les filles de se maquiller alors que dans les années 60
elles ne pouvaient ni se maquiller ni porter un pantalon dans un établissement
scolaire. A l’époque aussi, garçons et filles étaient séparés ; la mixité a été introduite
et largement pratiquée depuis. Les années 1980 me semblent avoir été marquées
par un affrontement pour d’autres libertés : liberté de sortie qui est vite devenue un
acquis social. Mais la demande a été plus loin car il s’est agi d’obtenir la liberté de
fixer librement l’heure de rentrer à la maison.
Au delà de cet approfondissement des libertés dans les années 80, s’engage aussi
un processus d’égalisation des conditions pour reprendre l’expression de
Tocqueville, qui font que les enfants vont se poser en partenaires égalitaires au sein
de la famille. Il faut tout de suite dire qu’ils ne sont pas sans rien dans leur
escarcelle, car ils ont un savoir propre notamment par rapport à la technique
moderne ; dans beaucoup de familles, ce sont les enfants qui font l’apprentissage
des parents en matière de vidéo, d’ordinateur ; et les parents qui ont senti le danger
se mettent à leur tour derrière les consoles.
Quels sont les objectifs et les fonctions de la famille moderne ?
Comme je l’ai écrit, je crois que les familles modernes n’ont pas (à supposer qu’elles
n’en aient jamais eu) de stratégie claire, cohérente, ordonnée autour d’un système de
règles, de normes, de valeurs. Mais il y a un discours qui revient constamment dès le
milieu des années 80, et encore vers la fin de celles-ci, et qui correspond en fait à un
objectif qui semble partagé par toutes les familles quelles qu’elles soient. A la question :
que souhaitez-vous pour vos enfants ? qu’attendez-vous de votre éducation ? la
réponse qui vient fréquemment c’est : que nos enfants soient bien dans leur peau ! On
peut dire qu’il y a consensus sur l’idée de l’épanouissement personnel.
On retrouve un autre consensus sur un autre thème : l’école. Les familles quelles
qu’elles soient et d’où qu’elles viennent affirment leur volonté de voir leurs enfants
réussir à l’école ; cette attente est extrêmement forte dans les familles favorisées ; plus
on monte dans l’échelle sociale, plus l’attachement à la réussite paraît grand jusqu’à
friser l’obsession. Cette pression supplémentaire sur la tête des enfants est
particulièrement forte dans notre pays : la France est, à l’exception du Japon, le pays qui
a la pression scolaire la plus forte. On peut dire que c’est un système quasiment délirant
car hors de nos frontières, on constate qu’on peut fonctionner différemment sans être
moins intelligent. Le système scolaire français aurait beaucoup à gagner s’il s’inspirait du
système scolaire allemand qui permet l’expression d’activités artistiques donc des
activités d’épanouissement que souhaitent les parents, qui offre aussi toute une palette
d’activités sportives qui évitent aux enfants d’avoir des emplois du temps de PDG.

5
Les deux objectifs recherchés par les parents semblent donc : que les enfants soient
bien dans leur peau et qu’ils réussissent en classe. C’est à partir de là qu’on fait un
constat de la bonne santé de la famille.
Plusieurs fonctions me paraissent être remplies dans la famille actuelle vis à vis des
enfants. D’abord une fonction économique ; elle apparaît d’autant plus importante et
urgente que la crise sociale s’étend et s’approfondit. Je vous renvoie sur ce point à tout
ce que l’on dit sur la présence beaucoup plus longue des enfants sous le toit familial qui
me semble liée à la fois au problème du chômage et à la prolongation des études mais
qui s’explique aussi par la cherté de la vie : prendre un appartement n’est pas simple et
beaucoup vont le faire avec l’appui financier des parents. Il ne faut pas non plus écarter
dans l’explication de ce phénomène le facteur affectif : on reste sans doute dans sa
famille parce que le monde extérieur est un monde difficile tandis que chez ses parents
on a une sécurité qui est à la fois d’ordre matériel mais aussi de l’ordre des sentiments.
Au sujet de la fonction éducative, je serai un peu plus sceptique et je rejoindrai un
certain nombre d’analyses de mes collègues qui parlent d’une véritable crise ou même
d’une panne de transmission des normes et valeurs chez les parents vis à vis de leurs
enfants. Il faut, à ce propos, rappeler que 68 a constitué un grand bouleversement, a
engendré la mise à mort d’un système de valeurs et de normes qui pour certaines
étaient légitimement contestables sans le remplacer par un ensemble d’autres valeurs :
en fait, il n’y a pas eu substitution d’un système par un autre mais une sorte de
pulvérisation des normes et des valeurs qui fait non pas qu’il n’y en a plus mais peut-être
qu’il y en a trop ; on pourrait presque dire qu’on est arrivé à un système de normes
personnalisées, ou en tout cas de règles de conduite qui fait que chacun bricole comme
il veut son code de comportement.
A commencer par les parents qui n’ont plus probablement de schémas clairs en tête et
qui peuvent eux-mêmes légitimement s’interroger sur la légitimité de ce qui leur est
permis de transmettre, par exemple dans le domaine de la sexualité. C’est un domaine
où les parents s’interrogent : où mettre le permis, l’interdit ? Est-ce que pour un garçon
ramener sa petite amie sous le toit familial, permettre à la petite amie de vivre sous le
toit familial, c’est bien ou ce n’est pas bien ? Je crois qu’il y a là une grande confusion
dans l’esprit de nombreuses familles et sans doute aussi un sentiment d’impuissance : le
garçon ramène sa petite amie et l’installe sous le toit familial et les parents ne peuvent
pas ou ne peuvent plus changer quoi que ce soit. Les parents étant ainsi en panne de
cohérence au niveau des réponses des normes transmettent du flou ou rien et placent
en même temps les enfants en situation de déséquilibre ou d’instabilité.
J’étais il y a quelques jours à un colloque sur la jeunesse à Bordeaux et une
psychosociologue soulignait qu’il y a aujourd’hui un certain nombre de valeurs qu’on ne
nomme plus. On ne dit plus les mots honnêteté, tolérance… on ne nomme plus le bien
du mal. D’où un certain nombre de dérives dont on aura peut-être l’occasion de parler à
propos de ces affaires de Liverpool et de Vitry-sur-Seine. Autrefois, délinquance juvénile
était assimilée à délinquance des jeunes de milieu populaire ; c’était rassurant parce
qu’on savait où la situer et on pouvait l’analyser correctement. Il en a été de même
quand on a parlé des bandes de blousons noirs mais déjà on oubliait qu’il y avait aussi
des bandes de blousons dorés qui sévissaient sous d’autres formes. Maintenant, on se
rend compte que la délinquance juvénile, comme ce type d’événements dont je viens de
parler, peuvent se produire n’importe où et dans toutes les catégories sociales.
Pour conclure, je dirai que ce fossé des générations dont parlait Margaret Mead en
1970, à mon sens, non seulement ne s’est pas comblé mais s’est au contraire élargi.
 6
6
1
/
6
100%