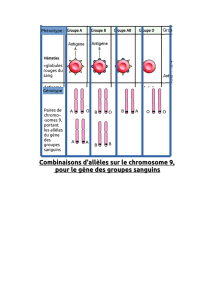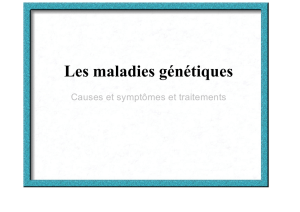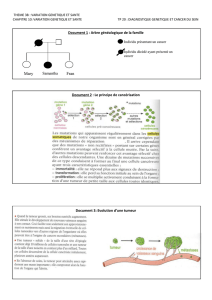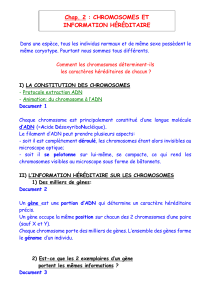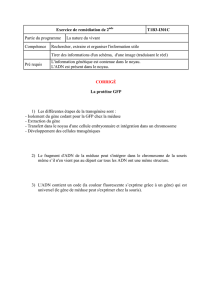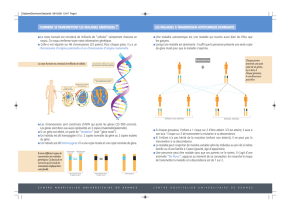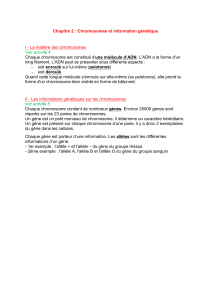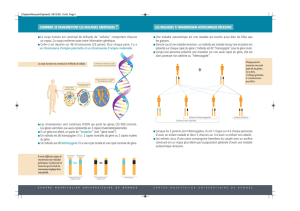Maladies génétiques

Lorsque le gène muté est situé sur l’une des 22
paires autosomiques, semblables chez l'homme et
chez la femme, la transmission est autosomique.
Les personnes des deux sexes peuvent être
indifféremment atteintes.
•
Transmission autosomique dominante
Dystrophie musculaire facio-scapulo-
humérale (FSH)
La FSH est une maladie autosomique dominante. Elle se
manifeste chez une personne hétérozygote, porteuse de
l'anomalie en un seul exemplaire : délétion d'une petite
séquence d'ADN située sur le chromosome 4 en 4q35.
Cette séquence, répétée de 10 à 100 fois chez une
personne indemne, comporte moins de 10 répétitions (le
plus souvent 4, 5 ou 6) chez une personne atteinte.
Il est difficile d’établir une corrélation entre la sympto-
matologie clinique et la taille de la délétion. Cependant,
les manifestations sont plus sévères si le nombre de
répétitions est faible (2 à 3) et plus modérées si celui-ci
est proche de la normale (8 à 9). Le nombre de
répétitions est variable d'une famille à l'autre mais
constant au sein d'une famille.
L'expressivité de la maladie est très variable d'une
personne à l'autre : certaines ne présentent que peu de
signes, voire aucun. La maladie peut évoluer silen-
cieusement et les premiers signes n'apparaître qu'à
l'adolescence. Un homme ou une femme atteint(e) de
FSH a une probabilité de 1/2 de transmettre la délétion à
chacun de ses enfants. Les garçons et les filles ayant
hérité de la délétion peuvent exprimer la maladie. Dans
certaines familles, une seule personne peut être
atteinte. Avant d'affirmer qu'il s'agit d'une néomutation,
il faut vérifier qu'aucun de ses parents n'est porteur de
la délétion.
Le test génétique spécifique n'est réalisé qu'après
recueil écrit du consentement éclairé de la personne à
risque. Habituellement, il n'est pas effectué chez les
mineurs asymptomatiques. Le diagnostic prénatal est
possible mais soulève des problèmes éthiques à cause
de la variabilité de l'expression de la maladie.
•Transmission autosomique récessive
Amyotrophies spinales
Les amyotrophies spinales sont des maladies auto-
somiques récessives. Elles se manifestent chez les
enfants homozygotes c'est-à-dire ayant reçu de leur père
et de leur mère l'anomalie génique : délétion du gène
SMN localisé sur le chromosome 5. Pour un couple à
risque (2 conjoints hétérozygotes pour la délétion du
gène SMN), la probabilité, à chaque grossesse, d'avoir
un enfant atteint (fille ou garçon) est de 1/4, la
probabilité de donner naissance à un enfant indemne
étant de 3/4.
Pour une personne de la famille, la probabilité d'être
hétérozygote dépend de son lien de parenté avec le
malade : elle est de 2/3 pour un frère ou une sœur, de
1/2 pour un oncle ou une tante, 1/3 pour un neveu ou
une nièce et de 1/4 pour un cousin. Cependant, une
personne hétérozygote a rarement un enfant atteint.
Tout dépend du statut de son conjoint. Si celui-ci est
indemne, les enfants seront indemnes avec une proba-
bilité de 1/2 d'être hétérozygotes. Mais, le conjoint peut
être hétérozygote soit en raison d'un lien de parenté
soit par hasard : la probabilité dépend alors de la
fréquence des hétérozygotes dans la population : 1/40
pour les ASI. Bien que le risque soit faible, certains
couples peuvent avoir un enfant atteint : la probabilité,
pour un frère (ou une sœur) d'une personne atteinte,
d'avoir un enfant atteint est de 1/240 ; elle est de 1/320
pour un oncle ou une tante.
La délétion du gène SMN est observée dans les quatre
types d'amyotrophie spinale. Sa présence permet de
confirmer le diagnostic évoqué chez 95% des personnes
atteintes. Un diagnostic prénatal est possible.
En revanche, du fait de la complexité de la région
génomique concernée, il est actuellement impossible
de détecter les personnes hétérozygotes par l'étude
directe de l'ADN.
Transmission autosomique
Le génotype mitochondrial ne se définit pas
seulement par l'existence d'une mutation, mais
aussi par la proportion de molécules d'ADN
mitochondrial (ADNmt) mutées dans un tissu.
Myopathies mitochondriales
Le phénotype des maladies mitochondriales dépend du
nombre de molécules d'ADNmt mutées et des tissus
concernés. L'atteinte des muscles est associée à celle
d'autres organes. L'expression de la maladie est très
variable et les signes musculaires ne sont pas toujours
au premier plan. Il est possible d'observer des phéno-
types normaux alors que les biopsies musculaires
contiennent jusqu'à 20% de molécules d'ADNmt mutées
ou délétées. Dans le cas des myopathies mitochon-
driales, l'étude génétique de la famille est souvent
déroutante car les enfants d'une même mère n'expri-
ment pas nécessairement la maladie. En effet s'ils peu-
vent tous présenter la mutation, la proportion de
molécules mutées peut être variable d'une personne à
l'autre et donner lieu à des phénotypes différents. Si
une femme peut donner naissance aussi bien à des filles
atteintes qu'à des fils atteints, seules les filles peuvent à
leur tour transmettre l'ADNmt muté à leurs enfants. Les
fils ne peuvent pas avoir d'enfant atteint. Le conseil
génétique est particulièrement difficile, notamment si
l'étude moléculaire n'a pas retrouvé de mutations de
l'ADNmt apportant la preuve de la transmission mater-
nelle. En effet, il existe des maladies mitochondriales
qui peuvent être en rapport avec des mutations de
l'ADN nucléaire obéissant à une transmission mendé-
lienne. Le diagnostic prénatal est toujours délicat.
Transmission de l'ADN mitochondrial
Maladies génétiques : que
Les maladies monogéniques peuvent être soit autosomiqu
(récessives ou dominantes). Selon le mode de transmissio
au même risque. En outre, certaines maladies sont génét
être à l'origine de la même maladie. Elles peuvent aussi
le risque, c'est-à-dire évaluer la probabilité qu'une malad
nouveau, est un des objectifs du conseil génétique (acte
médecin spécialisé en génétique médicale).
La plupart des gènes sont localisés dans le noyau de
la cellule. Quelques gènes sont, cependant, présents
dans le cytoplasme. Localisés dans les mitochondries
(ADN mitochondrial), ils sont exclusivement d'origine
maternelle. En effet, lors de la fécondation, seules les
mitochondries contenues dans le cytoplasme des
gamètes de la femme sont transmises. Le cytoplasme
des spermatozoïdes ne participe pas à la formation
de l'oeuf.
FICHE TECHNIQUE
Hétérozygote atteint Homozygote indemne
A a a a
A
A a a a
aa
Parents
Gamètes
Descendants
Hétérozygote atteint
1/2 Homozygote indemne
1/2
Hétérozygote indemne Hétérozygote indemne
b B b B
b
b b b B B b B B
BbB
Parents
Gamètes
Descendants
Homozygote
atteint
1/4
Hétérozygote
indemne
1/4
Hétérozygote
indemne
1/4
Homozygote
indemne
1/4
Hérédité cytoplasmique. Transmission de l'ADN mitochondrial.
La transmission de l'ADN mitochondrial (ADNmt) ne suit pas les lois de
l'hérédité mendélienne qui ne s'appliquent qu'aux gènes portés par les
chromosomes nucléaires. Les mitochondries suivent une hérédité cytoplasmique
différente de l'hérédité mendélienne. Seules les mères transmettent leur ADN
mitochondrial à leur descendance (hérédité dite maternelle).
Lorsqu'il existe une altération du génome mitochondrial (délétion, duplication,
mutation ponctuelle), elle ne concerne qu'une partie des mitochondries de la
cellule (hétéroplasmie). Dans chaque cellule coexistent, en proportion variable,
des molécules d'ADNmt normal et des molécules d'ADNmt muté. Au fil des
divisions cellulaires, la répartition des mitochondries mutées se fait au hasard.
La mutation est transmise mais la proportion d'ADNmt normal et d'ADNmt
muté varie d'une génération de cellules à l'autre, d'un tissu à l'autre, d'un
organe à l'autre. L'expression de la maladie varie donc d'une personne à
l'autre y compris au sein d'une même famille. Le diagnostic de maladie
mitochondriale est difficile à établir en raison de la grande variabilité
d'expression et de transmission des altérations de l'ADN mitochondrial.
Hérédité mendélienne.
Transmission autosomique dominante.
La personne atteinte possède le gène muté en un
exemplaire (altération d'un seul des deux allèles). Elle peut
le transmettre à ses enfants : une maladie dominante se
transmet verticalement, de génération en génération.
Chaque enfant d'un homme atteint ou d'une femme atteinte
peut hériter de la maladie avec une probabilité de 1/2.
Si l'enfant n'hérite pas de la maladie, la transmission est
interrompue dans cette branche de la famille.
Les manifestations cliniques peuvent être différentes d'un
patient à l'autre du fait de l'expressivité variable de la
maladie. Par ailleurs, les symptômes peuvent se manifester
plus ou moins tardivement. Certaines personnes porteuses
du gène muté peuvent ne pas exprimer la maladie ou
l'exprimer sous une forme très modérée. Elles peuvent
néanmoins transmettre ce gène à leur descendance :
la maladie semble avoir sauté une génération.
La maladie peut aussi survenir chez un enfant sans
qu'aucun des parents soit atteint ou porteur du gène
muté : il s'agit d'une nouvelle mutation (néomutation).
Le risque ne concerne alors que la descendance
directe du malade.
Hérédité mendélienne.
Transmission autosomique récessive.
La personne atteinte possède le gène muté en deux
exemplaires (altération des deux allèles).
Ses deux parents (père et mère) sont indemnes mais ils
sont porteurs du gène muté à l'état hétérozygote
(seul un des deux allèles est altéré).
À chaque naissance, ce couple a une probabilité de 1/4
d'avoir un enfant atteint et une probabilité de 3/4 d'avoir
un enfant indemne.
Les frères et soeurs indemnes d'une personne atteinte ont
une probabilité de 2/3 d'être hétérozygotes.
Etre hétérozygote n'a, en règle générale, aucune
conséquence. Une personne hétérozygote aura des enfants
indemnes, sauf si son conjoint est, par hasard ou
en raison d'un lien de parenté, hétérozygote pour une
mutation du même gène.
Les maladies génétiques étant rares,
la descendance d'une personne atteinte ou de ses
apparentés est peu exposée à la maladie, en l'absence de
consanguinité (ou de l'existence de la même maladie
dans la famille du conjoint).

Lorsque le gène muté est situé sur le
chromosome X, la maladie est dite liée à l'X.
Elle est le plus souvent récessive et s'exprime
essentiellement chez l'homme du fait de la
présence d'un seul chromosome X. Elle peut
aussi être dominante et se manifester quel
que soit le sexe.
•Transmission récessive liée à l'X
Dystrophie musculaire de Duchenne (DMD)
La DMD est une maladie récessive liée à l'X. Elle est due
à l'absence de dystrophine dans le muscle. Le gène
DYS
en cause, localisé sur le chromosome X en Xq21 est de
très grande taille et code la dystrophine. Une anomalie
de ce gène (délétion, duplication ou mutation ponc-
tuelle) est responsable de la DMD.
Cette maladie transmise par des femmes asympto-
matiques touche essentiellement les garçons. Une
femme conductrice a une probabilité de 1/4 d'avoir un
garçon malade : ses fils peuvent être atteints une fois
sur deux. Une fille sur deux peut être conductrice. La
sœur d'un garçon atteint de DMD a une probabilité de
1/2 d'être conductrice si sa mère l'est, elle a donc une
probabilité de 1/8 d'avoir un fils atteint. Si l'anomalie
moléculaire a été mise en évidence chez le garçon
atteint (4 familles sur 5), un test génétique par analyse
directe de l'ADN peut être proposé aux femmes à risque
de la famille. Dans le cas contraire, il faut recourir à une
étude familiale de l'ADN par méthode indirecte. Un
diagnostic prénatal est réalisable chez les femmes
conductrices.
Quand dans une famille, un seul garçon est atteint de
DMD, sa mère n'est pas nécessairement conductrice (1/3
des cas). Il peut s'agir, soit d'une néomutation apparue
chez son fils (ses autres enfants ne peuvent pas hériter
de l'anomalie génétique), soit d'un mosaïcisme germinal
(la mutation est présente dans les ovules et non dans
les autres cellules de la mère). Malgré la rareté du
mosaïcisme, un diagnostic prénatal est habituellement
proposé dans ce contexte.
Dystrophie musculaire de Becker (DMB)
La DMB est une forme moins sévère de la dystrophie
musculaire de Duchenne (DMD). Elle est due à une
anomalie du gène
DYS
, responsable d'une altération de
la dystrophine. La dystrophine est produite mais elle est
soit de plus petite taille (protéine tronquée) soit en
quantité insuffisante.
La DMB évolue plus lentement que la DMD et la perte de
la marche est plus tardive. Un homme atteint peut avoir
des enfants : toutes ses filles sont conductrices et
peuvent, à leur tour, avoir des fils atteints ; tous ses fils
sont indemnes et leur descendance sera aussi indemne.
Comme pour la DMD, il est possible de reconnaître les
femmes conductrices parmi les femmes à risque de la
famille. Un diagnostic prénatal est réalisable mais la
décision à prendre, pour un enfant à naître reconnu
porteur de l'anomalie, est souvent difficile.
•Transmission dominante liée à l'X
Maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT)
La CMT peut obéir à plusieurs modes de transmission. Il
existe des formes dominantes autosomiques (CMT1A,
CMT1B et CMT2), les plus fréquentes ; des formes
récessives autosomiques (CMT4) ; une forme dominante
liée à l'X (CMTX) due à l'anomalie d'un gène situé en
Xq13.21. Ce gène code la connexine 32. Les anomalies
géniques sont des mutations ponctuelles ou des
délétions intragéniques.
Quand elle est dominante liée à l'X, la CMT peut toucher
les deux sexes. Un homme atteint n'a aucun fils atteint
mais il transmet la maladie à toutes ses filles. En
revanche, une femme atteinte a une probabilité de 1/2
d'avoir des filles ou des fils atteints.
Une autre particularité de cette forme de CMT liée à l'X,
est l'expression plus modérée de la maladie chez
la femme en raison de l'existence d'un second
chromosome X. Tout dépend de la proportion de
chromosomes X mutés inactivés : plus elle est élevée,
moins la maladie s'exprime.
Transmission liée à l'X
ls modes de transmission ?
ues (dominantes ou récessives), soit liées à l'X
on de la maladie, la descendance n'est pas exposée
tiquement hétérogènes, des gènes différents pouvant
avoir des modes de transmission différents. Evaluer
die survenue dans une famille s'y manifeste à
médical complexe relevant de la compétence d'un
Femme hétérozygote
(conductrice) Homme indemne
x X X Y
x
X
xX
Fille conductrice
1/4
Parents
Gamètes
Descendants
X X
Fille indemne
1/4
X Y
Fils indemne
1/4
Fils atteint
1/4
x
Y
X Y
Femme indemneHomme atteint
X Xx
Y
X
Fille conductrice
1/2
Parents
Gamètes
Descendants
x X
Fils indemne
1/2
X Y
x
Y
Femme
atteinte Homme indemne
X x x Y
X
x
x
X
Fille atteinte
1/4
Parents
Gamètes
Descendants
x x
Fille indemne
1/4
x Y
Fils indemne
1/4
Fils atteint
1/4
X
Y
x Y
Femme indemneHomme atteint
x xX
Y
x
Fille atteinte
1/2
Parents
Gamètes
Descendants
X x
Fils indemne
1/2
Y x
XY
Mitochondrie (ADNmt)
Noyau
Cytoplasme
ADN nucléaire
Cytoplasme
Noyau
Mitochondrie Noyau
ADN nucléaire
OVOCYTE SPERMATOZOÏDE
CELLULE
SOMA
SOMA
TIQUE
DIVISIONS
CELLULAIRES
OVOCYTE SPERMATOZOÏDE
CELLULE
SOMATIQUE
Mitochondrie
(ADNmt normal)
Mitochondrie
(ADNmt muté)
Homoplasmie
(ADNmt normal)
Homoplasmie
(ADNmt muté)
Hétéroplasmie
(ADNmt normal et muté)
(Répartition au hasard dans les tissus)
DIVISIONS
CELLULAIRES
Noyau
ADN nucléaire
Transmission récessive liée à l'X. Femme conductrice.
Une femme porteuse d'un gène muté à un seul exemplaire n'a
habituellement aucun signe de la maladie. Le gène non muté situé
sur le second chromosome X vient compenser ce défaut. Lorsqu'une
mère est hétérozygote (c'est-à-dire conductrice), un garçon sur 2
risque d'être atteint et une fille sur 2 risque d'être conductrice
comme sa mère. Aucune des filles n'exprime la maladie. Les filles
conductrices ont la même probabilité que leur mère d'avoir des fils
atteints et des filles conductrices.
Transmission récessive
liée à l'X. Homme atteint.
Un homme qui a un gène
muté sur le seul
chromosome X qu'il
possède exprime la
maladie. Lorsqu'un père
est atteint, tous ses
garçons sont indemnes et
aucune de ses filles
n'exprime la maladie.
Cependant, toutes ses
filles sont nécessairement
conductrices (porteuses
du gène à l'état
hétérozygote).
Transmission dominante liée à l'X. Femme atteinte.
Les femmes expriment souvent la maladie sous une forme
modérée, le gène (non muté), situé sur l'autre chromosome X,
atténuant en partie l'effet du gène muté. Lorsque la mère est
atteinte, elle peut transmettre le gène muté, situé sur un de ses
deux chromosomes X, à ses filles et à ses fils : un garçon sur 2 et
une fille sur 2 risquent d'être atteints.
Transmission dominante
liée à l'X. Homme atteint.
Lorsque le père
est atteint, il transmet
le gène muté, situé sur
le chromosome X,
à toutes ses filles qui
expriment la maladie.
Seuls les garçons sont
indemnes puisqu'ils
reçoivent de leur père
le chromosome Y.
Il n'y a jamais de
transmission père-fils.
Hérédité cytoplasmique. Mitochondries et ADN mitochondrial (ADNmt).
Chaque cellule humaine possède de plusieurs dizaines à plusieurs millers de
mitochondries et chaque mitochondrie compte plusieurs copies d'ADNmt.
Seul l'ADN nucléaire du spermatozoïde est retenu au cours de la
fécondation. L'hérédité cytoplasmique est donc maternelle. Les mères
transmettent leur ADNmt à tous leurs enfants. Les filles, à leur tour,
transmettent leur ADNmt à la génération suivante. En revanche, les hommes
ne transmettent jamais leur ADNmt.

Enquête familiale.
Arbre généalogique.
Famille touchée par une
maladie à transmission
autosomique dominante.
Enquête familiale.
Arbre généalogique.
Famille touchée par une
maladie à transmission
autosomique récessive.
Enquête familiale.
Arbre généalogique.
Famille touchée par une
maladie à transmission
récessive liée à l’X.
Maladies génétiques :
quels modes de transmission ?
Vous êtes médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute,
infirmière, professionnel du secteur médico-social,
A VOTRE DEMANDE, NOUS VOUS ADRESSERONS :
■Les coordonnées des équipes spécialisées dans les maladies neuromusculaires les plus
proches de votre lieu d'exercice
■La classification actualisée des maladies neuromusculaires
■Des Fiches Techniques mises à jour sur les maladies neuromusculaires
■Le Bulletin d'information médicale sur les maladies neuromusculaires
■Des Comptes Rendus Flash , synthèses de colloques sur les maladies
neuromusculaires
■La liste complète des publications
■Bientôt des informations en ligne sur
http://www.afm-telethon.asso.fr/
(site en construction)
•Une anomalie chromosomique peut être présente de façon homogène dans toutes les cellules et
résulte alors d'un accident de la méïose paternelle ou maternelle, au moment de la formation des
gamètes. Lorsqu'elle ne concerne qu'une partie des cellules (mosaïque), elle résulte d'un accident
survenu lors de la division de l'œuf fécondé. Ainsi, la plupart des anomalies chromosomiques sont
accidentelles, mais certaines peuvent être héritées. Habituellement décelées au moyen d'un caryotype,
elles s'avèrent être des anomalies de nombre ou de structure.
•Les anomalies de nombre (trisomie 21, syndromes de Turner et de Klinefelter) résultent d'une erreur
dans la répartition des chromosomes au moment de la formation d'un gamète. Celui-ci contient deux
chromosomes de la même paire (ou aucun) au lieu d'un seul. Les anomalies de nombre (98% des cas)
sont le plus souvent accidentelles (le caryotype des parents est normal) et théoriquement, la famille
n'encoure aucun risque. Cependant, avoir eu un enfant porteur d'une anomalie chromosomique
de novo
augmente un peu le risque pour un autre enfant à naître du couple. L'âge maternel constitue un facteur
de risque accru à partir de 40 ans mais le risque augmente progressivement dès 35 ans.
•Les anomalies de structure résultent de cassures chromosomiques suivies ou non de recollement.
Quand elles ne s'accompagnent ni de gain, ni de perte de matériel génétique, elles sont dites
équilibrées. Lorsqu'elles sont déséquilibrées, elles peuvent engendrer des pathologies diverses. Si l'un
des parents a une anomalie équilibrée, il peut transmettre l'anomalie à ses enfants sous forme équilibrée
ou déséquilibrée ; le risque de récurrence varie selon les chromosomes impliqués et le sexe du parent
porteur.
•Les anomalies chromosomiques inframicroscopiques ne peuvent être décelées que par des méthodes
conjuguant la cytogénétique classique et la cytogénétique moléculaire. Ces microdélétions rendent
compte de plus en plus de syndromes malformatifs, le plus souvent accidentels mais qui peuvent parfois
être hérités d'un des parents (syndromes de Willi-Prader, d'Angelman, de Williams).
Maladies multifactorielles :
hérédité polygénique
•Pour certaines maladies (malformation congénitale, hypertension artérielle, diabète
sucré, obésité, cancers...), la répartition des personnes atteintes dans une même
famille ne peut pas s'expliquer par les lois de Mendel. La susceptibilité d'une
personne à manifester la maladie est sous la dépendance de plusieurs gènes
(hérédité polygénique) et de facteurs environnementaux. Individuellement, chaque
gène, chaque facteur a un effet faible sur l'apparition de la maladie ; celle-ci
n'apparaît que si la susceptibilité atteint un seuil critique : la maladie est dite
multifactorielle. Les apparentés d'un sujet malade ont en commun avec lui certains
gènes de susceptibilité d'où un plus grand nombre de personnes atteintes dans la
famille que dans la population générale.
•Dans certaines familles, quelques unes de ces maladies multifactorielles relèvent en
réalité d'un gène unique. Elles se transmettent comme une maladie monogénique.
Environ 5% des cancers du sein, survenant souvent chez la femme jeune, sont
autosomiques dominants ; il en est de même pour les cancers du colon, le diabète
non insulinodépendant, la sclérose latérale amyotrophique. L'hypercholestérolémie
familiale peut également se transmettre sur le mode autosomique dominant.
Anomalies chromosomiques :
le plus souvent des accidents
CONSEIL GÉNÉTIQUE
■Le conseil génétique, délivré par un médecin généticien, repose sur le diagnostic
précis de la maladie. Il s'adresse en priorité à des couples supposés à risque du fait
d'antécédents. Donner un conseil génétique, c'est évaluer la probabilité qu'une maladie
survenue dans une famille s'y manifeste à nouveau.
■La possibilité de réaliser des tests génétiques permet d'améliorer le conseil
génétique pour de nombreuses pathologies. Le test génétique n'est pas seulement
effectué dans l'objectif du diagnostic prénatal, mais il peut être fait pour préciser le
statut génétique d'une personne asymptomatique exposée à développer une maladie
du fait d'antécédents.
■Le conseil génétique doit être préconceptionnel. Informé, le couple peut décider
d'avoir un enfant malgré le risque encouru ou y renoncer sans devoir vivre l'épreuve
d'une interruption de grossesse. Il peut conduire à un diagnostic prénatal (DPN)
s'il est possible voire à un diagnostic préimplantatoire (DPI), mais aussi à une
assistance médicale à la procréation (AMP) avec don de gamètes ou à une adoption.
■Le DPN permet de savoir si un enfant à naître a, ou non, hérité de l'anomalie
génétique préalablement identifiée dans la famille. Le DPI réalisé sur une ou deux
cellules embryonnaires ne peut être effectué qu'avec une AMP, cependant des difficultés
techniques persistent. Pour nombre de pathologies, il n'existe pas de DPN fiable
ni par conséquent de DPI.
■Une autre dimension du conseil génétique est l'accompagnement des personnes
atteintes de maladies génétiques et de leur famille.
■Les coordonnées des consultations de conseil génétique en France sont disponibles
auprès de : Allo-Gènes, Centre national d'information sur les maladies génétiques
(N° Azur : 0 801 63 19 20).
Vous êtes médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute,
infirmière, professionnel du secteur médico-social,
A VOTRE DEMANDE, NOUS VOUS ADRESSERONS :
■Les coordonnées des équipes spécialisées dans les maladies neuromusculaires les plus
proches de votre lieu d'exercice
■La classification actualisée des maladies neuromusculaires
■Des Fiches Techniques mises à jour sur les maladies neuromusculaires
■Le Bulletin d'information médicale sur les maladies neuromusculaires
■Des Comptes Rendus Flash , synthèses de colloques sur les maladies
neuromusculaires
■La liste complète des publications
■Bientôt des informations en ligne sur
http://www.afm-telethon.asso.fr/
(site en construction)
©AFM 09/99 • Fiche Technique Myoline • Rédaction : E. Biard • Validation : M. L. B. Briard • Maquette : I. Pereira • e-mail : [email protected] • Impression : ep 3000 - 01 64 93 89 89
nion
nion consanguine
umeaux monozygotes
umeaux dizygotes
Avortement spontané
iagnostic prénatal

Septembre 1999
■Chaque gène est présent en double exemplaire sous forme de 2
allèles (l'un d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle). Chez
les homozygotes, les deux allèles d'un même gène sont identiques.
Chez les hétérozygotes, ils sont différents.
■Les anomalies géniques sont diverses. Il peut s'agir du simple
changement d'une base (mutation ponctuelle) ou d'une perte d'un
fragment plus ou moins grand du gène (délétion). L'anomalie peut
consister en un grand nombre de répétitions de trois bases (triplets)
comme pour la maladie de Steinert. Cette répétition peut s'amplifier
au fil des générations passant de la prémutation sans conséquence
réelle, à la mutation complète responsable de signes cliniques.
■La présence du même allèle sur les deux loci homologues d'une
paire de chromosomes caractérise l'homozygotie. Une personne
homozygote possède deux allèles identiques (normaux ou mutés).
■La présence de deux allèles différents sur les deux loci homologues
d'une paire de chromosomes détermine l'hétérozygotie. Chez une
personne hétérozygote, l'un des allèles est muté et l'autre est normal.
■Une maladie est dominante si l'altération d'un des 2 allèles du
gène en cause suffit à l'apparition des signes cliniques. Le gène muté
s'exprime à l'état hétérozygote.
■Une maladie est récessive lorsque l'altération des deux allèles du
gène est nécessaire à l'apparition des signes cliniques. Le gène muté
s'exprime à l'état homozygote. Si un seul allèle est altéré, la maladie
ne se manifeste pas cliniquement.
■Une maladie liée à l'X est consécutive à la déficience d'un gène
situé sur le chromosome sexuel X (le sexe masculin est
essentiellement atteint). La 23ème paire de chromosomes différencie
les deux sexes. La femme a deux chromosomes X (XX), l'homme
possède un chromosome X et un chromosome Y (XY).
■Une maladie autosomique est consécutive à la déficience d'un
gène situé sur l'une des 22 paires d'autosomes (chromosomes non
sexuels), comparables dans les 2 sexes.
■L'expressivité désigne l'intensité de l'expression phénotypique
d'un gène. On parle d'expressivité variable quand la maladie se mani-
feste de façon plus ou moins importante d'une personne à l'autre y
compris au sein d'une même famille.
■La pénétrance est la probabilité de l'expression d'un gène muté.
En présence d'un défaut de l'expression d'un allèle, on parle d'un
défaut de pénétrance. Certaines personnes porteuses d'un gène muté
peuvent ne pas exprimer la maladie contrairement à d'autres qui sont
atteintes : la pénétrance de la maladie est dite incomplète.
■Un gène muté n'est pas toujours hérité d'un parent. La mutation a
pu survenir dans un des gamètes dont est issue la personne atteinte.
Cette nouvelle mutation dite néomutation ne peut être transmise qu'à
sa descendance. Les autres membres de la famille n'encourent aucun
risque d'être atteints à leur tour.
FICHE TECHNIQUE
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
Hérédité mendélienne : à chaque mot, son sens
L
Les maladies monogéniques
résultent de l'altération d'un gène.
Autosomiques ou liées à l'X, ces
maladies se transmettent selon les lois
de Mendel. Dans la majorité des cas, le
gène déficient se trouve sur un chromo-
some situé dans les noyaux cellulaires.
Les cellules somatiques contiennent 46
chromosomes soit 23 paires dont 22
paires de chromosomes autosomes et
une paire de chromosomes sexuels (XY
pour l'homme et XX pour la femme). Par
contre les cellules germinales (gamètes)
ne comptent que 23 chromosomes.
Chaque personne hérite donc, de son
père et de sa mère, un chromosome de
chacune de leurs 23 paires chromo-
somiques composées de millions de
gènes.
Chaque gène est présent en deux copies
(allèles). L'une, voire les deux, peut être
altérée, le gène est alors muté. Une
personne homozygote pour un gène
présente deux allèles identiques de ce
gène. Si les deux allèles sont différents,
elle est dite hétérozygote. La maladie
est dominante quand l'altération d'un
des deux allèles suffit à l'apparition des
signes cliniques. La maladie est
récessive si deux allèles altérés sont
nécessaires à l'apparition des signes ;
la présence d'un seul allèle altéré n'en-
traîne pas de manifestations cliniques
mais le gène muté peut être transmis à
la descendance ; l'absence d'une symp-
tomatologie patente n'exclut pas la pré-
sence d'une expression biologique de la
maladie sans conséquence fonctionnelle.
Les mitochondries possédant leur propre
chromosome, le gène muté peut se
trouver sur l'ADN mitochondrial. La
transmission de l'ADN mitochondrial
n'obéit pas aux lois de Mendel, elle est
purement maternelle. En effet, les mito-
chondries sont uniquement transmises
par le cytoplasme de l'ovocyte.
Une altération de l'ADN peut survenir au
sein d'un groupe de cellules (cancer,
voire certains syndromes congénitaux).
Cette altération somatique de l'ADN
n'est pas transmissible.
Maladies
génétiques :
quels modes
de transmission ?
FICHE TECHNIQUE
Sujet de sexe féminin
Femme hétérozygote transmettrice
Sujet de sexe masculin
Sujet de sexe inconnu
Sujet décédé
Sujet atteint
Grossesse en cours
Un
Un
Ju
Ju
A
Di
1
/
4
100%