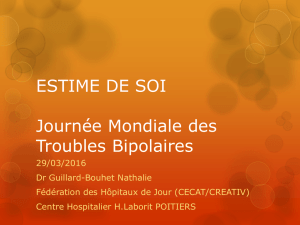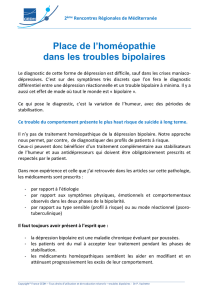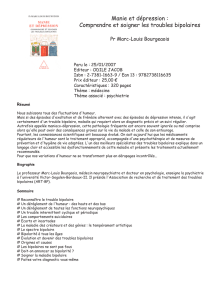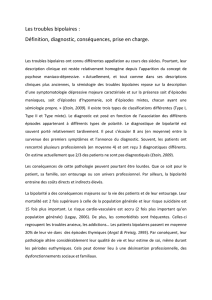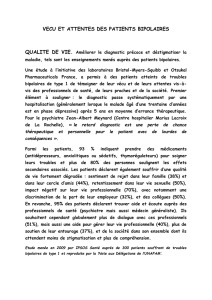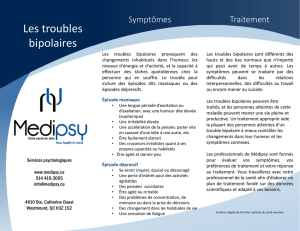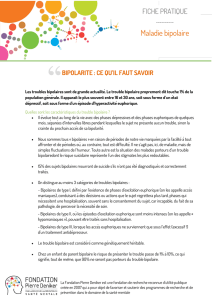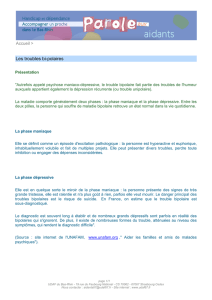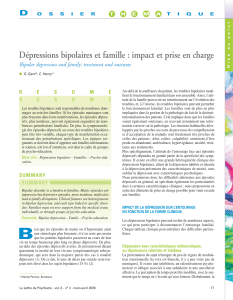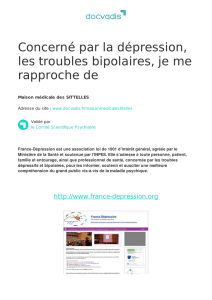Les dépressions bipolaires

L’Encéphale, 2006 ;
32 :
497-500, cahier 2
S 497
Les dépressions bipolaires
Les deux maladies de l’humeur : troubles unipolaires
(dépressions récurrentes) et troubles bipolaires (maniaco-dépressifs)
M.-L. BOURGEOIS
(1)
(1) IPSO, Université de Bordeaux 2 (Victor Segalen), 121, rue de la Béchade, 33076 Bordeaux cedex, [email protected].
Il est désormais admis qu’il existe deux types distincts
de troubles de l’humeur :
1) la maladie dépressive récurrente, naguère et encore
parfois qualifiée de trouble unipolaire, caractérisée par la
récurrence d’épisodes dépressifs (EDM ou épisodes
dépressifs dits majeurs, c’est-à-dire avérés) ;
2) les troubles bipolaires, caractérisés par la récurrence
d’épisodes maniaques ou hypomaniaques, alternant le
plus souvent (mais pas obligatoirement) avec des épiso-
des de dépression.
La différenciation entre les deux types de trouble thy-
mique repose sur des arguments cliniques, épidémiologi-
ques, génétiques, pronostiques et thérapeutiques. En par-
ticulier, la prise en charge et l’indication des médicaments
sont très différentes dans les deux types de pathologie :
schématiquement, les antidépresseurs pour les dépres-
sions récurrentes, les thymorégulateurs pour les dépres-
sions bipolaires.
Il existe de nombreux types de troubles bipolaires
(type I, type II, cyclothymie etc..). Nous ne parlerons pas
des formes récurrentes purement maniaques (dite manies
unipolaires), qui seraient essentiellement masculines.
D’une part, leur existence est contestée par beaucoup
d’auteurs, au motif qu’il y aurait toujours des phases
dépressives, d’intensité plus ou moins grande, passant
inaperçues. D’autre part, les patients de ce type seraient
à risque plus élevé de complications et d’effets négatifs
dus aux antidépresseurs.
Dans le spectre bipolaire, certains patients ont une pro-
pension nettement plus grande à souffrir d’épisodes
d’excitation maniaque et d’autres à souffrir d’épisodes
dépressifs, complets ou non, dépressions majeures ou
mineures, ou bien encore de pathologies dites « sous le
seuil », subsyndromiques, infracliniques, ou de formes
brèves. Angst et Perris (4, 5) ont été à l’origine de la dif-
férenciation unipolaire-bipolaire et de la différenciation
des sous types bipolaires
(figure 1)
.
D = Dépression majeure ; d = Dépression mineure ; M = Manie ; m = Hypomanie.
FIG. 1. —
L’évolution de la distinction bipolaire-unipolaire
(4).
Catégories diagnostiques
Maladie maniaco-dépressive
Classifications
DSM I, DSM II & CIM-6-9
Unipolaire Bipolaire Personnalité
cyclothymique
Cyclothymie (trouble)
BP I BP II
(Bipolaire, NOS)
RDC & DSM III (1980)
DSM III-R (1987)
DSM IV (1994), CIM-10(1992)
DMDMdmD md
Cyclothymie

M.-L. Bourgeois L’Encéphale, 2006 ;
32 :
497-500, cahier 2
S 498
SPECTRE BIPOLAIRE (MANIACODÉPRESSIF)
ET SOUS TYPES BIPOLAIRES
La conception orthodoxe actuelle des troubles bipolai-
res inclut le type I (manie + dépression), le type II (hypo-
manie + dépression), la cyclothymie (symptômes hypo-
maniaques + symptômes dépressifs), les états mixtes,
(intrication d’un syndrome maniaque et d’un syndrome
dépressif) et les cycles rapides.
La conception élargie du spectre bipolaire ajoute un type
III (excitation maniaque ou hypomaniaque induite par les anti-
dépresseurs) et d’autres types encore caractérisés par des
épisodes thymiques de durée brève ou par un tempérament
affectif du type hyperthymique, irritable ou cyclothymique.
COMMENT RECONNAÎTRE LA NATURE BIPOLAIRE
D’UNE DÉPRESSION ?
Il est convenu que les états dépressifs majeurs se
caractérisent par un certain nombre de symptômes
d’intensité et de durée déterminée, le tableau clinique
étant supposé être le même pour les troubles unipolaires
et bipolaires. Il existe cependant un certain nombre de
nuances qui, en dehors même de l’évolution, devraient
permettre de distinguer les deux catégories de
dépression : les arguments cliniques et toute une série
d’index prédictifs de la nature bipolaire d’une dépression.
Lorsque le patient a déjà présenté des épisodes d’exci-
tation du niveau maniaque ou hypomaniaque, ou lorsque
son tempérament et son comportement étaient précé-
demment quelque peu excités, exaltés, hyperactifs, (c’est-
à-dire un tempérament hyperthymique), il est relativement
facile de suspecter la bipolarité. De la même manière, lors-
que dans la famille, en particulier chez les parents de pre-
mier degré, existent des antécédents de pathologie bipo-
laire, la probabilité est plus élevée qu’il s’agisse d’une
dépression bipolaire.
Enfin on peut suspecter la bipolarité lorsque la réponse
aux traitements antidépresseurs est négative avec des
éléments d’irritation et de dysphorie induite par ces médi-
caments.
On trouvera dans le
tableau I
les différences cliniques
(déjà esquissées par Kraepelin) proposées par Potter
(17), entre les deux types de pathologie.
LES DÉPRESSIONS PSEUDO-UNIPOLAIRES
Lorsqu’un patient présente un accès dépressif, en
l’absence d’antécédents personnels ou même familiaux
de manie ou d’hypomanie, une série d’indices permet de
suspecter la bipolarité. Ces facteurs prédictifs de bipolarité
ont été validés par Akiskal
et al.
(2) et confirmés ultérieu-
rement (9, 12).
LA PRÉPONDÉRANCE DES SYMPTÔMES
ET SYNDROMES DÉPRESSIFS
DANS LES TROUBLES BIPOLAIRES
On a récemment confirmé que les états dépressifs, pour
un tiers d’entre eux s’inscrivaient dans l’évolution d’une
maladie bipolaire ou sur un terrain présentant une vulné-
rabilité élevée pour ce type de pathologie.
La manie et l’hypomanie sont les éléments cardinaux
des troubles bipolaires. Ce sont ces épisodes d’excitation
qui permettent d’assurer le diagnostic de bipolarité. Pour
autant, il est maintenant admis que la souffrance et le han-
dicap des patients sont essentiellement liés à la pathologie
dépressive. Le suivi sur 10 ans d’une large cohorte nord-
américaine de malades bipolaires a révélé que plus de
50 % du temps chez ces patients sont obérés par des
symptômes et des syndromes dépressifs, très pénibles
(14, 15). Cela ne justifie pas pour autant l’emploi systé-
matique des médicaments antidépresseurs puisque ces
derniers peuvent compliquer le tableau et l’évolution des
troubles.
RISQUE SUICIDAIRE ACCRU ET COMORBIDITÉ
ÉLEVÉE (ABUS DE DROGUES ET D’ALCOOL)
15 à 20 % des patients bipolaires meurent par suicide.
Diverses études rétrospectives ont montré que le traite-
ment régulier par Lithium réduisait nettement ce risque.
D’une façon générale une prise en charge thérapeutique
TABLEAU I. —
Différences cliniques entre troubles unipolaires/
bipolaires pour la dépression,selon W.Z. Potter
(17).
Dépression bipolaire Dépression unipolaire
Retrait calme
Ralentissement psychomoteur
Hypersomnie
Moins de symptômes anxieux,
Moins de plaintes somatiques
Moins de colère
Plus d’activité physique
et mentale
Plaintes somatiques
Troubles du sommeil
Anxiété
Colère
Généralement, le patient bipolaire est moins conscient et se plaint moins
de sa dépression et de sa dysphorie. Il y a un plus grand risque pour
ce type de patient de ne pas être traité et de se suicider.
TABLEAU II. —
Variables prédictives
d’une évolution bipolaire I
(2).
Facteurs prédictifs Sensi-
bilité
(%)
Spéci-
ficité
(%)
Valeur
prédictive
(%)
Hypomanie pharmacologique 32 100 100
Histoire familiale de bipolarité 56 98 94
Forte charge héréditaire 32 95 87
Dépression avec hypersomnie
et ralentissement 59 88 83
Dépression psychotique 42 85 74
Transmission familiale
multigénérationnelle continue
39 83 72
Début en
post partum
58 84 88
Début avant 25 ans 71 68 69

L’Encéphale, 2006 ;
32 :
497-500, cahier 2 Les dépressions bipolaires
S 499
complète et très régulière contribue vraisemblablement à
une forte diminution de cette complication fatale.
Des troubles bipolaires ont une comorbidité élevée
avec d’autres pathologies mentales : l’abus d’alcool et de
drogue dans au moins 60 % des cas, divers troubles
anxieux. Ils peuvent être aussi intriqués avec des troubles
de la personnalité pathologique (Axe II). Il est alors néces-
saire de diversifier le traitement en ajoutant à la thymoré-
gulation la prise en charge de ces pathologies associées.
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
DES ÉTATS DÉPRESSIFS BIPOLAIRES
On distingue classiquement trois phases dans le trai-
tement des états dépressifs :
1) la phase de traitement aigu,
2) la phase de continuation,
3) la phase de maintenance.
En matière de pathologie dépressive il est convenu que
chaque EDM impose un traitement médicamenteux pour
une durée de six moins au mois. En réalité il s’agit plus
souvent d’une maladie au long cours, faite de rechutes et
de récidives, imposant en conséquence un traitement con-
tinu qui sera prophylactique.
Pour les dépressions récurrentes unipolaires, il s’agit
des médicaments antidépresseurs proprement dits. Par
contre, ce traitement prophylactique est beaucoup plus
délicat en ce qui concerne les troubles bipolaires. Ce sera
donc en fonction des sous types que l’on devra choisir les
médicaments utiles :
– thymorégulateurs, éventuellement associés de
façon ponctuelle dans certains cas avec des antidépres-
seurs ;
– on recommande d’utiliser les antidépresseurs du
type ISRS (inhibiteur spécifique de la recapture de la séro-
tonine) quand prédominent les symptômes dépressifs en
particulier dans les troubles bipolaires type II. Les tricycli-
ques sont à éviter ;
– aux États-Unis, le Bupropion est présenté comme
l’antidépresseur de référence pour les bipolaires, mais en
France il est frappé de contre-indication pour la bipolarité !
– pour la phase de continuation, on essaie de limiter
la durée de prescription de l’antidépresseur et l’on insiste
sur le traitement prophylactique ;
– les thymorégulateurs occupent le premier plan dans
les trois phases thérapeutiques : traitement aigu, de con-
tinuation et de maintenance.
La mise au point récente de Dubovsky (11) constate la
pauvreté et les limites en matière d’études contrôlées pour
le traitement des dépressions bipolaires.
Dans les formes résistantes et pour les états mixtes,
l’électroconvulsivothérapie (ECT) reste le traitement de
choix.
LES TRAITEMENTS THYMORÉGULATEURS
On s’accorde généralement pour définir comme thy-
morégulateur un médicament qui normalise un épisode
thymique et joue un rôle préventif pour d’éventuels épi-
sodes ultérieurs, sans aggraver ou induire des épisodes
et symptômes de polarité opposée. En fait, il n’y a à ce
jour que peu de médicaments répondant à ce critère.
C’est toujours le Lithium qui reste considéré comme le
régulateur de référence par son action thérapeutique,
pour les épisodes d’excitation maniaque ou hypomania-
que et par son action antidépressive. Par ailleurs, il est
l’adjuvant le plus amplement démontré quant à la supplé-
mentation d’un traitement antidépresseur. Il doit cepen-
dant être prescrit avec circonspection car il suppose une
observance parfaitement régulière au long cours, une
surveillance biologique régulière, car il comporte des ris-
ques de complications, en particulier d’insuffisance grave
de la thyroïde et de néphropathie. Il est dangereux en cas
d’ingestion massive suicidaire (coma, séquelles neurolo-
giques etc.). Dans la méta-analyse de Bauer
et al.
(6) sont
retenus comme thymorégulateurs, outre le Lithium, la
Lamotrigine qui préviendrait ou atténuerait la pathologie
dépressive. Sont aussi signalés la Carbamazépine,
l’acide Valproïque (en cas de contre-indication du
Lithium). Ils nécessitent eux aussi une surveillance étroite
pour leurs effets secondaires et leurs complications trop
souvent ignorés et négligés.
Enfin, ont émergé plus récemment les nouveaux anti-
psychotiques dits atypiques, tel que la Clozapine, l’Ami-
sulpride, la Rispéridone, l’Olanzapine.
Tous ces traitements doivent être gérés par un psychia-
tre formé à la psychiatrie biologique et à la psycho-
pharmacologie, en coordination de soins avec le médecin
traitant. Celui-ci devra accompagner le traitement et
jouera un rôle majeur dans la surveillance et la partie
suivante de la prise en charge du patient et de sa famille.
PSYCHOTHÉRAPIE ET PSYCHO-ÉDUCATION
Les ressources pharmacologiques sont largement
popularisées par l’industrie pharmaceutique. Aussi doit-
on insister sur l’approche psychosociale. Il y a encore
beaucoup à faire pour convaincre la communauté, les
patients et même les soignants en général, de l’existence
et de la gravité des troubles bipolaires, pour faire connaître
la clinique de ces troubles, en particulier la dépression du
type II. Il s’agit de faire accepter aux patients, aux familles
et à la collectivité, la réalité de cette pathologie polymorphe
et handicapante, de faire accepter ce diagnostic et enga-
ger les patients dans un processus thérapeutique continu.
Il existe désormais des modules de prise en charge de
type thérapie cognitive et comportementale, ou thérapie
interpersonnelle ou des thérapies de groupe du type
psycho-éducation.

M.-L. Bourgeois L’Encéphale, 2006 ;
32 :
497-500, cahier 2
S 500
Références
1. AKISKAL HS. The bipolar spectrum : new concepts in classification
and diagnosis.
In
: Grinspoon L, ed. Psychiatry Update : The Ame-
rican Psychiatric. Association Annual Review, vol 2. Washington :
DC/American Psychiatric Press, 1983 : 271-92.
2. AKISKAL HS, WALKER P, PUZANTIAN VR
et al.
Bipolar outcome
in the course of depressive illness. J Affect Disord 1983 ; 5 : 115-28.
3. AKISKAL HS, MASER JD, ZELLER PJ
et al.
Switching form unipolar
to bipolar II. An 11 year prospective study of clinical and tempera-
ment predictors in 559 patients. Arch Gen Psychiatry 1995 ; 52 :
114-23.
4. ANGST J. Zur Aetioloie und Nosologie endogener depressiver Pys-
choser. Berlin : Springer, 1966.
5. PERRIS C. A study of Bipolar and Unipolar Recurrent Depressive
Psychosis. Acta Psychiatr Scand 1966 ; 42 (Supl 196).
6. BAUER M, MITCHNER L. What is a « Mood Stabilizer » ? An Evi-
dence-Based Response. Am J Psychiatry 2004 ; 161 : 3-18.
7. BOURGEOIS ML, MARTINEZ R, DEGEILH B
et al.
Les facteurs pré-
dictifs de bipolarisation des troubles dépressifs. Encéphale 1988 ;
XIV : 353-7.
8. BOURGEOIS ML. Dépression bipolaire : aspects cliniques et thé-
rapeutiques. Ann Med Psychol 2001 ; 159 (4) : 251-60.
9. BOURGEOIS ML, VERDOUX H, PEYRE F
et al.
Indices et facteurs
prédictifs de bipolarité dans les états dépressifs. Étude de
219 patients hospitalisés pour dépression. Ann Med Psychol 1996 ;
154 (10) : 577-88.
10. CALABRESE JR, KASPER S, JOHNSON G
et al.
Internacional con-
sensus group of bipolar I Depresion treatment guidelines. J Clin Psy-
chiatry 2004 ; 65 : 571-9.
11. DUBOVSKY SL. Treatment of bipolar depression. Psychiatr Clin N
Am 2005 ; 28 : 349-70.
12. GASSAB L, MECHRI A, GAHA L
et al.
Facteurs corrélés à la bipo-
larité dans les depressions majeures : étude d’une population hos-
pitalière tunisienne. Encéphale 2002 ; XXVIII : 283-9.
13. GOODWIN GM. For the consensus Group of the British Association
for Psychopharmacology. Evidence-based guidelines for treating
bipolar disorder : recommendations from the Britisch Association for
Psychopharmacology.
14. JUDD, AKISKAL, SCHTTLER
et al.
A prospective investigation of
the natural history of the long natural history of the weekly sympto-
matic status of bipolar. Arch Gen Pyschiatry 2003 ; 60 : 261-9.
15. JUDD, AKISKAL, SCHTTLER
et al.
The long-term natural history of
the weekly symptomatic status of bipolar. Arch Gen Pyschiatry
2002 ; 59 : 530-7.
16. KASPER S. Issues in the treatment of bipolar disorder in European.
Neuropsychopharmacol 2003 ; 13 : S37-S42.
17. POTTER WZ, 1998.
18. SCOTT J, COLOM F. Psychosocial treatments for bipolar disorder.
Psychiatr Clin N Am 2005 ; 28 : 371-84.
TABLEAU III. —
Les cibles du traitement psychosocial
des troubles bipolaires
(18).
1) Psycho-éducation concernant les troubles bipolaires.
2) Hygiène de vie : régularité (sommeil, relations sociales,
travail, évitement des stress), suppression de l’alcool et des
drogues.
3) Observance du traitement.
4) Reconnaissance précoce et prise en charge des signes de
rechute.
1
/
4
100%