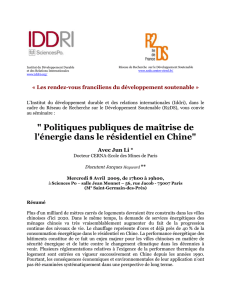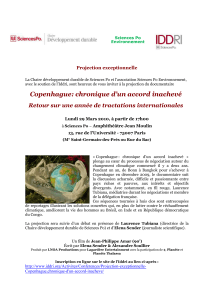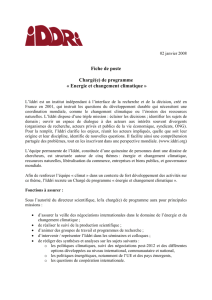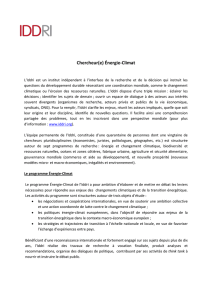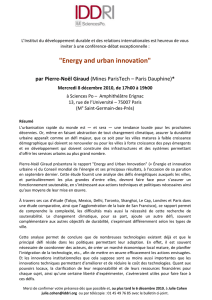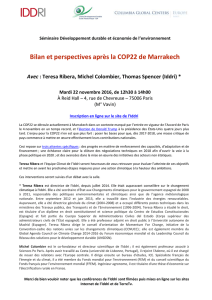Les politiques d`efficacité énergétique en France et en Allemagne

Institut du développement durable
et des relations internationales
27, rue Saint-Guillaume
75337 Paris cedex 07 France
Les politiques d’efficacité
énergétique en France
et en Allemagne : quand
deux voisins empruntent
des chemins différents
STUDY
N°04/13 MARS 2013 | CLIMAT
Loïc Chappoz (Iddri)
PEUT-ON DÉCRETER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ?
La France comme l’Allemagne mènent depuis les années , et pour
des raisons qui ont évolué dans le temps, des politiques de promotion
de l’efficacité énergétique. Pour ce faire, les deux pays ont développé
un panel d’instruments (des normes aux incitations de marché) dont il
est parfois difficile de mesurer les impacts. L’amélioration de l’efficacité
énergétique des deux pays s’explique-t-elle par les politiques menées, par
l’influence de la régulation européenne ou par les stratégies économiques
des acteurs ? Quel est l’impact des différents instruments sur les consom-
mations et les comportements ? Une politique centralisée est-elle plus
efficace qu’une approche décentralisée ? La comparaison des résultats
obtenus dans les deux pays incite à se garder de tout jugement péremp-
toire et à repérer les dimensions circonstancielles de réussite des poli-
tiques menées.
OÙ SONT LES GISEMENTS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ?
Plus de la moitié des mesures d’efficacité énergétique prises par
l’Allemagne et la France concernent le bâtiment, loin devant l’industrie
(respectivement % et % des mesures prises en Allemagne et la
France) et les transports ( % et % des mesures prises). Néanmoins,
cette étude montre que les efforts supplémentaires d’amélioration de
l’efficacité énergétique de ces pays devront à l’avenir porter sur le parc
existant de bâtiments ainsi que sur le secteur des transports, où le poten-
tiel est le plus difficile à concrétiser.
LE PRIX DE L’ÉNERGIE INFLUENCE LES COMPORTEMENTS D’USAGE
ET D’ACHAT
Quand on s’attaque à l’efficacité énergétique de secteurs comme les
transports, l’industrie ou l’équipement des ménages, les réglementations
nationales, régionales ou communautaires rencontrent très vite leurs
limites. De même, les incitations ne suffisent pas à changer les compor-
tements si elles ne s’inscrivent pas dans une modification profonde des
modes de production et de l’offre de produits sur le marché. Les exemples
de la réforme fiscale écologique allemande et de la différence de taxation
entre essence et diesel en France montrent une élasticité-prix de la con-
sommation d’énergie, mais aussi une influence du prix sur les décisions
d’achat d’équipements (véhicules, appareils électroménagers…).
www.iddri.org

Copyright © IDDRI
En tant que fondation reconnue d’utilité publique,
l’Iddri encourage, sous réserve de citation (réfé-
rence bibliographique et/ou URL correspon-
dante), la reproduction et la communication de
ses contenus, à des fins personnelles, dans le cadre
de recherches ou à des fins pédagogiques. Toute
utilisation commerciale (en version imprimée ou
électronique) est toutefois interdite.
Sauf mention contraire, les opinions, interpréta-
tions et conclusions exprimées sont celles de leurs
auteurs, et n’engagent pas nécessairement l’Iddri
en tant qu’institution.
Citation: Chappoz, L. (), Les politiques d’effi-
cacité énergétique en France et en Allemagne : quand
deux voisins empruntent des chemins différents, Study
n°/, Iddri, Paris, France, p.
Pour toute question sur cette publication, merci de
contacter l’auteur :
Loïc Chappoz – [email protected]
ISSN -

IDÉES POUR LE DÉBAT 05/2011 3
IDDRI
Les politiques d’efficacité
énergétique en France
et en Allemagne: quand
deux voisins empruntent
des chemins différents
Loïc Chappoz (Iddri)
INTRODUCTION 5
1. LES CHOCS PÉTROLIERS, DÉCLENCHEURS
DES POLITIQUES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 5
2. DE FORTES DISPARITÉS DE TRAITEMENT ENTRE
LES DIFFÉRENTS SECTEURS DE L’ÉCONOMIE 8
3. LA RÉFORME FISCALE ALLEMANDE: UN SIGNAL PRIX
CLAIR EN FAVEUR DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 11
4. DES MESURES TRANSVERSALES À FORT POTENTIEL:
CERTIFICATS BLANCS EN FRANCE
ET ESCO EN ALLEMAGNE 14
5. L’INDUSTRIE, MOTEUR DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE MALGRÉ DES POLITIQUES
PEU NOMBREUSES ET PEU EFFICACES 16
6. TRANSPORT: L’AUGMENTATION DE LA DEMANDE
EFFACE LES GAINS D’EFFICACITÉ 18
7. LE BÂTIMENT CONCENTRE L’ESSENTIEL
DES POLITIQUES DE RÉDUCTION DE LA DEMANDE 22
RÉFÉRENCES 34

LISTE DES FIGURES
Figure 1. Budget annuel d’intervention de l’Ademe
et de ses prédécesseurs (en euros de 2004*). 7
Figure 2. Nombre et impact des politiques
et mesures d’efficacité énergétique en France (F)
et en Allemagne (A) recensées dans MURE,
par secteur (1974-2008). 9
Figure 3. Évolution des index d’efficacité totaux et par
secteur (industrie, résidentiel et transport)
en France et en Allemagne. 10
Figure 4. Prix des matières premières
pour la production d’électricité allemande. 12
Figure 5. Prix de l’électricité hors taxe pour l’industrie
et le résidentiel en France et en Allemagne. 12
Figure 6. Différences entre le prix hors taxe
et toutes taxes comprises de l’électricité en France
et en Allemagne, pour l’industrie et le résidentiel. 12
Figure 7. Prix de l’électricité TTC pour l’industrie
et le résidentiel en France et en Allemagne. 13
Figure 8. Prix TTC de l’électricité pour les ménages
en 2008 dans l’union européenne. 13
Figure 9. Principe de fonctionnement d’une ESCO. 15
Figure 10. Structure des ESCO en Allemagne. 16
Figure 11. Consommation d’énergie finale
de l’industrie divisée par sa valeur ajoutée
en France et en Allemagne. 17
Figure 12. Consommation moyenne
des automobiles neuves (litres/100km). 19
LISTE DES TABLES
Table 1. Nombre et part des politiques et mesures
par secteur, recensées dans la base de données MURE. 9
Table 2. Augmentation de la fiscalité sur les énergies
fossiles en Allemagne (1999-2003). 11
Table 3. Économies d’énergie annuelles engendrées
par le dispositif des CEE. 15
Table 4. Objectifs sectoriels de réduction
des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre
de l’accord volontaire AERES. 17
Table 5. Répartition des mesures recensées dans MURE
par type d’objectif pour le secteur des transports. 19
Table 6. Variation de la consommation d’énergie
finale par habitant (1991-2008). 23
Table 7. Synthèse de l’évolution de la règlementation
thermique française 24
Figure 13. Évolution du transport de passagers
par habitant. 21
Figure 14. Évolution du transport de marchandises
par habitant. 21
Figure15. Part des taxes dans le prix de l’essence
sans plomb (95 RON, en%). 21
Figure 16. Différences de taxation entre le diesel
et l’essence (en € par litre). 22
Figure 17. Part des véhicules diesel dans le parc
automobile. 22
Figure 18. Décomposition de la demande d’énergie
dans le secteur résidentiel. 24
Figure 19: Évolution des objectifs
de la règlementation thermique française. 25
Figure 20. Évolution de la réglementation thermique
des bâtiments en Allemagne. 25
Figure 21. Renouvellement annuel du parc immobilier
(en% du parc total). 27
Figure 22. Consommation d’électricité spécifique
par habitant (en kWh/ha). 29
Figure 23. Stocks électroménagers par habitant
(unité par hab.). 29
Figure 24. Corrélation entre l’efficacité des appareils
sur le marché et les appareils vendus en 2008. 31
Figure 25. Prix d’achat des congélateurs verticaux A+
et part des ventes des congélateurs A+ et A++ (2008).
Nombre et classe énergétique des modèles
de congélateur sur le marché (2008). 32

Les politiques d’efficacité énergétique en France et en Allemagne: quand deux voisins empruntent des chemins différents
STUDY 07/2012 5
IDDRI
INTRODUCTION
L’Allemagne et la France sont deux leaders euro-
péens avec des niveaux de développement simi-
laires et des produits intérieurs bruts (PIB) par
habitant qui ont évolué de manière comparable
entre et . Leurs économies présentent
néanmoins des structures différentes et ont réagi
très différemment à la crise financière: l’économie
française, qui a initialement mieux résisté, semble
avoir aujourd’hui du mal à rebondir, alors que
l’Allemagne, qui a ressenti plus tôt son impact, se
remet plus rapidement. L’observation de ces résul-
tats a déclenché une vague de comparaisons des
politiques économiques des deux pays, laissant de
côté les politiques énergétiques alors même que les
réseaux électriques des deux pays sont étroite-
ment connectés et ne peuvent pas être consi-
dérés de manière indépendante.
La décision allemande d’accélérer sa sortie du
nucléaire, à la suite de l’accident de Fukushima en
mars , a remis la problématique énergétique
sur le devant de la scène. Aujourd’hui, les éner-
gies fossiles ne peuvent pas assurer seules le relais
du nucléaire en raison des objectifs de réduction
des émissions de gaz à effet de serre de l’Union
européenne (UE). La faisabilité d’une production
électrique reposant principalement sur les renou-
velables est par ailleurs contestée pour des raisons
techniques ou d’acceptation publique. Dans ce
contexte, la réduction des consommation d’éner-
gie par des politiques d’efficacité énergétique
pourrait être l’outil central non seulement pour
permettre à l’Allemagne de fermer ses centrales
nucléaires selon le plan adopté en juin , mais
aussi pour donner à la France un réel choix quant à
ses futurs modes de production d’électricité.
L’Union européenne définit l’efficacité énergé-
tique comme « le rapport entre les résultats, le ser-
vice, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient
et l’énergie consacrée à cet effet ». Améliorer
l’efficacité énergétique d’une économie ne signi-
fie donc pas nécessairement diminuer la quantité
d’énergie totale consommée. En effet, l’augmen-
tation des besoins énergétiques générés par la
croissance du PIB d’un pays dépasse bien sou-
vent les économies réalisées grâce à l’efficacité
énergétique. Sans politique plus large de maîtrise
de la demande, l’énergie consommée à l’échelle
nationale continuera ainsi vraisemblablement
d’augmenter.
Cet article a pour objectif de mettre en perspec-
tive les similitudes et les différences des politiques
françaises et allemandes d’efficacité énergétique.
Il s’appuie, entre autres, sur la base de données
européenne MURE (Mesures d’utilisation ration-
nelle de l’énergie), qui recense les politiques et
mesures en matière d’efficacité énergétique dans
l’Union européenne, ainsi que sur la base de don-
nées Odyssee d’Enerdata, qui compile les princi-
pales données concernant la demande en énergie
en Europe.
Une approche historique (section ), ainsi qu’un
rappel des différences institutionnelles entre les
deux pays, permet en partie d’expliquer des diffé-
rences notables de traitement des différents sec-
teurs des économies allemande et française (sec-
tion ). La politique fiscale allemande (section )
ainsi que certaines mesures transversales propres
ou plus développées dans un des deux pays (sec-
tion ) ont des effets sur chacun des secteurs étu-
diés: l’industrie (section ), les transports (sec-
tion ) et le bâtiment (section ).
1. LES CHOCS PÉTROLIERS,
DÉCLENCHEURS DES POLITIQUES
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
En France comme en Allemagne, les premières
mesures d’économie d’énergie et de recherche d’ef-
ficacité énergétique remontent aux années .
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%