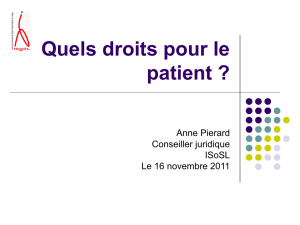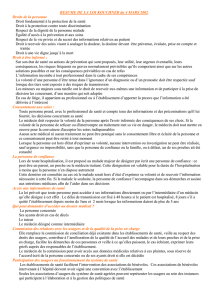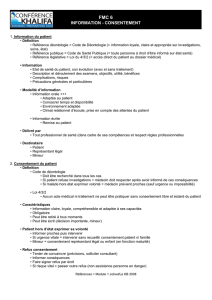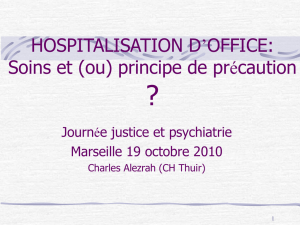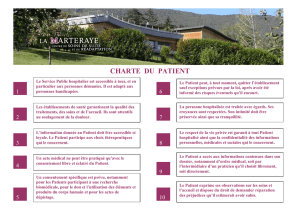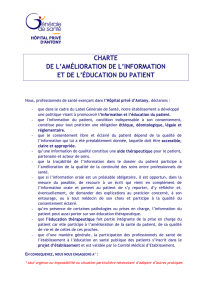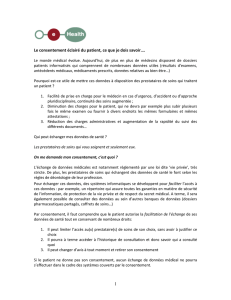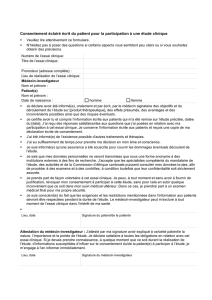Déontologie et psychiatrie - Psychologie

Déontologie et psychiatrie
F Petitjean
B Cordier
C Germain
Résumé.
–
Évolution dans la continuité, telle est l’impression qui ressort de la lecture du
nouveau Code de déontologie (CDM) en application depuis le 8 septembre 1995
[5]
. Les
grands principes demeurent mais certaines dispositions sont renforcées avec quelques
innovations. Depuis l’édition de 1979, une mise à jour était nécessaire, le contexte socio-
économique a changé, de nouvelles lois ont été promulguées, la jurisprudence a évolué et
des progrès scientifiques ont été accomplis. Le précédent article de ce traité sur le même
sujet
[23]
concluait que le CDM (celui de 1979) n’abordait pas suffisamment la psychiatrie et le
malade mental en tant que problèmes spécifiques, alors que dans cette discipline la
dimension éthique est primordiale
[1]
. La dernière édition du Guide d’exercice
professionnel
[14]
présente ainsi le nouveau CDM : « par rapport au précédent, le présent
code accentue l’affirmation des droits des malades, la nécessité de les informer et de les
protéger. Il prend en compte l’élargissement du rôle du médecin (...) pour promouvoir la
santé publique ; il reconnaît sa fonction de conseil, il insiste sur sa compétence et son
entretien dans un contexte d’exercice moins libéral ou plus réglementé ». De tels objectifs,
lorsqu’ils répondentà«laprimauté de la personne » servent particulièrement l’exercice de la
psychiatrie, mais cette nouvelle édition exige toujours de la part du psychiatre un effort
d’adaptation dans l’application de certains articles qui seront ici commentés. Seront visés les
articles touchant à l’indépendance professionnelle, au libre choix, à l’information et au
consentement, au respect du secret professionnel et au respect de l’intégrité physique.
©
1999, Elsevier, Paris.
Déontologie et éthique médicales
La déontologie, étymologiquement science des devoirs, du grec « deontos »
qui signifie « ce qui doit être», est à l’origine une notion de philosophie que
l’usage a limitée à l’application des règles morales qu’impose à des
professionnels l’exercice même de leur métier. Elle est aux confins de la
morale et du droit, la morale disant ce qui est bien (ou mal), le droit ce qui est
juste (ou punissable). La déontologie se différencie de l’éthique qui
correspond à l’ensemble des principes d’une morale professionnelle. Le
champdel’éthiqueestdoncbeaucoupplusvaste,carilenglobedesproblèmes
qui relèvent de questions de principes auxquels un code de déontologie ne
peut répondre. La déontologie médicale a des origines très anciennes dont
témoignent le serment d’Hippocrate et la prière de Maimonide. Le corps
médical fut l’une des premières professions à se préoccuper de codifier ses
règles professionnelles. C’est dans l’entre-deux-guerres que les syndicats
médicaux commencèrent à rédiger un code de déontologie et c’est en 1941
que l’Ordre des médecins, récemment créé, publiait le premier code. De
simple règlement intérieur, il devait être promulgué en 1947, après avis du
Conseil d’État, sous forme de décret portant règlement d’administration
publique. Il fut révisé en 1955, en 1979 et en 1995. Dans la Communauté
européenne, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et l’Italie disposent d’un
code de déontologie médicale, alors que les autres pays se réfèrent plutôt aux
usages et à la jurisprudence. Mais, d’une façon plus générale, la réflexion
européenne actuelle sur l’éthique médicale semble évoluer en suivant plutôt
François Petitjean : Psychiatre des Hôpitaux.
Christine Germain : Assistante spécialiste.
Centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis 75674 Paris cedex 14, France.
Bernard Cordier : Psychiatre des Hôpitaux, hôpital Foch, 40, rue Worth, BP 36, 92151
Suresnes cedex, France.
Toute référence à cet article doit porter la mention : Petitjean F, Cordier B et Germain C.
Déontologie et psychiatrie. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Psychiatrie, 37-061-A-10,
1999, 9 p.
l’approche française qui, en cas de conflits d’intérêt, a tendance à donner la
priorité à l’individu sur la collectivité. En tant que philosophe, Rameix
[25]
observe l’évolution de l’éthique médicale contemporaine et constate qu’elle
oscille entre le bien singulier à faire et les principes universels à respecter. Se
référant à des textes récents, les lois dites de bioéthique (29 juillet 1994), la
charte du patient hospitalisé (6 mai 1995) et le nouveau CDM, elle voit une
mutation importante de la relation médicale, comme si aux devoirs des
médecinssuccédaientles« droitsdesmalades».Elleécrit :« Dans le premier
modèle de relation médicale, paternaliste, le principe moral de bienfaisance
estprioritaire ; il légitimeuneprotection dupatientaffaibliparlamaladie (...)
dans le second modèle, le principe moral premier est celui du respect de
l’autonomie des personnes. »
Ce second modèle, celui de l’autonomie, apparaît prédominant aux États-
Unis et dans le nord de l’Europe. Rameix souligne cependant qu’une
autonomie pure « qui laisserait chaque patient exprimer et faire prévaloir ses
préférences singulières (...) devant une prestation de soins neutres et
indifférents », n’est pas compatible avec la tradition de solidarité qui marque
lesystèmedesantéfrançais.Ainsi,danscertainescirconstances,notresociété
peut accorder une priorité à l’intérêt de la collectivité sur les libertés
individuelles en prononçant des obligations de soins lorsque la santé d’un
individuest altérée, quecettealtérationconstitue undangerpourautrui et que
ce danger peut être supprimé ou diminué par des soins appropriés. Dans le
domaine extrajudiciaire, c’est en partie l’esprit de la loi du 27 juin 1990
relativeàl’hospitalisationenpsychiatrieet,en matière pénale, c’estl’objectif
del’injonction thérapeutiquede la loidu 31décembre1970 surla lutte contre
la toxicomanie et de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles
[19]
. Ce dernier texte, qui concerne
particulièrement les psychiatres, n’est pas sans poser des problèmes
déontologiques qui seront abordés dans les chapitres sur le libre choix, le
consentement et le secret médical.
Indépendance professionnelle
Selon l’article 5 du CDM, « le médecin ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Cette indépendance est un
droitdu maladeet il appartientau médecin,quelque soitson mode d’activité,
de la préserver. Ainsi, elle peut être compromise soit par les liens de
37-061-A-10
ENCYCLOPÉDIE MÉDICO-CHIRURGICALE 37-061-A-10
© Elsevier, Paris

subordination de l’exercice salarié, ou encore par la concurrence au sein de
l’exercice libéral en cabinet ou en clinique. Dans la pratique psychiatrique, il
existe en outre des risques spécifiques d’aliénation de cette indépendance au
nom de l’ordre social et de la cohésion du groupe.
Pouvoir politique
Les exemples de détournement de la psychiatrie pour servir une idéologie
politique témoignent de sa vulnérabilité, mais les exemples de (ré)pressions
exercées par les régimes totalitaires ou par les dictatures sur les psychiatres
témoignent aussi de l’étendue du pouvoir qu’on leur prête. Dans les années
1970, ces abus ont été dénoncés par les associations humanitaires et par des
syndicats de psychiatre et, en 1977, l’Association mondiale de psychiatrie a
réagiet publié unedéclarationsolennelle visantàétablir les baseséthiquesde
l’exercice de la psychiatrie.
On lit notamment dans sa septième proposition : « Le psychiatre ne doit pas
participer à un traitement psychiatrique imposé en l’absence d’une maladie
psychiatrique. »
Pouvoir judiciaire
Selonlaloi,danscertainescirconstances,lajusticepeutimposeruntraitement
àun malade :obligations desoins pourles prévenuset les condamnés(article
R58 du Code de procédure pénale [CPP]) ; injonctions thérapeutiques pour
les toxicomanes (loi du 31 décembre 1970) ; injonction de soins pour les
auteursd’infractionssexuelles(loidu17juin1998),etc,maiscesdispositions
ne doivent pas altérer l’indépendance du médecin ou du psychiatre,
l’obligation de se soigner n’est pas obligation de soigner.
Pouvoir administratif
Il peut s’exercer à travers le préfet, l’Agence régionale de l’hospitalisation
(ARH), la Direction de l’action sanitaire et sociale (DASS), le directeur de
l’établissement. C’est surtout dans le cadre de l’application de la loi du
27 juin 1990, et notamment pour les hospitalisations d’office, que
l’indépendance du médecin ou du psychiatre vis-à-vis du pouvoir
administratif peut être menacée. Il appartient au préfet d’établir que l’ordre
public ou la sûreté des personnes est compromis par un individu, mais il
appartient au médecin d’attester en toute liberté, même s’il est requis, que
cette situation est ou non en relation avec d’éventuels troubles mentaux. De
même, le psychiatre hospitalier ne doit subir aucune pression lorsqu’il
confirme ou non l’indication de ce mode d’hospitalisation.
Pour contribuer à garantir son indépendance, les dispositions essentielles du
statut de praticien hospitalier (PH) (nomination, discipline...) relèvent de
l’administration centrale, c’est-à-dire du ministère. Le PH est dans une
situation de « dépendance administrative » et non de subordination vis-à-vis
del’administration qui l’emploie.Encequi concernelesrelationsentre le PH
et le directeur d’établissement où il exerce, l’article 7 de la loi du 3 janvier
1984, toujours en vigueur, prévoit que le directeur « exerce son autorité sur
l’ensemble du personnel dans le respect de la déontologie (...) et de
l’indépendanceprofessionnelledupraticiendansl’exercicedesonart».Cette
restrictionprendtoute sa valeurdansl’applicationdela loi du27juin1990où
la responsabilité pénale du directeur peut être lourdement engagée.
Il faut mentionner, par ailleurs, qu’en matière de politique de secteur
l’indépendance du psychiatre, chef de secteur, est toute relative car c’est au
directeur de mettre en œuvre la politique définie par le conseil
d’administration et approuvée par le représentant de l’État ; néanmoins, les
contraintes économiques actuelles ne doivent pas entraver l’indépendance
professionnelle du praticien. L’article 95 du CDM rappelle que « en aucune
circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance
dans son exercice médical de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui
l’emploie. »
Hiérarchie médicale hospitalière
Selonl’article69,« l’exercicedelamédecine est personnel ; chaquemédecin
est responsable de ses décisions et de ses actes ». Le corollaire de
l’indépendance du médecin est sa responsabilité personnelle. Elle est entière
dans l’exercice libéral. Pour le PH, non chef de service, le principe de son
indépendance a été confirmé par la loi du 31 juillet 1991 portant réforme
hospitalière,reprisedanslelivreVIIduCodedelasantépublique(CSP),dont
l’article L 714-23 indique : « Le chef de service ou de département assure la
conduite générale du service ou du département et organise son
fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité de chaque
praticien et des missions dévolues à chaque unité fonctionnelle par le projet
de service ou de département [...]. »
Il n’en demeure pas moins qu’au sein des équipes psychiatriques
hospitalières, dès qu’il y a une notion de danger en relation avec le
comportement d’un malade hospitalisé sans son consentement (loi du 27 juin
1990), le partage des responsabilités entre le chef de service et le praticien
certificateurrisqued’entamerl’indépendancedecedernieretmériteraitd’être
reprécisé.
Libre choix
L’article 6 du CDM indique que « Le médecin doit respecter le droit que
possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter
l’exercice de ce droit. »
Hospitalisation et libre choix
Le principe du libre choix est rappelé dans l’article L 710-1 du CSP (loi du
31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, titre 1, chapitre 1
er
, Principes
fondamentaux) :«Le droitdumaladeau libre choixdesonpraticien et deson
établissementdesantéestunprincipefondamental de la législationsanitaire ;
les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection
sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités
techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de
l’autorisationàdispenserdessoinsremboursablesauxassuréssociaux»,ainsi
que dans l’article 9 du décret du 14 janvier 1974 relatif au fonctionnement
des centres hospitaliers : « Dans les disciplines qui comportent plusieurs
services,lesmaladesont,saufencasd’urgenceet compte tenu des possibilités
en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis. ».
Le libre choix ne doit cependant pas aller à l’encontre des intérêts du malade
lui-même : les limitations qui peuvent à l’hôpital contrarier le choix du
malade ont pour contrepartie une garantie d’être correctement soigné
(souvent même mieux soigné) dans des hôpitaux équipés et bien organisés.
Dansun service, lemaladen’apas obligatoirementlessoinsdu médecin qu’il
souhaiterait, les tâches sont réparties entre les différents médecins, le malade
doit faire confiance à une équipe.
Dans cette organisation en équipe, le malade n’est pas toujours le meilleur
juge du médecin qu’il lui faut. L’application trop systématique du libre choix
pourrait conduire à une incohérence de la prise en charge.
La loi du 27 juin 1990 rappelle la règle du libre choix dans les nouvelles
dispositions de l’article L 326-1 du CSP, concernant les hospitalisations
libres : « Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant celui de
son représentant légal, hospitalisé ou maintenu dans un établissement
accueillant des malades mentaux hormis les cas prévus par la loi.
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s’adresser au
praticienou à l’équipedesanté mentale, publiqueouprivée, de sonchoixtant
àl’intérieurqu’àl’extérieurdusecteurpsychiatrique correspondant à sonlieu
de résidence. »
Pour certains commentateurs de la loi du 27 juin 1990, ce texte ne prend pas
en compte les hospitalisations sans consentement, pour lesquelles les
conditions de mise en œuvre du libre choix sont restreintes, ne serait-ce que
du fait du nombre limité d’établissements privés habilités (article L 331 du
CSP) à recevoir ce type d’admission
[2]
.
Libre choix et secteur psychiatrique
Une circulaire du 14 mars 1990, relative à la sectorisation psychiatrique,
rappelle que les obligations des équipes de soins vis-à-vis de la population
des secteurs qu’ils desservent « ne (doivent) en aucun cas amener à une
étanchéitédes territoires,à des filièrescloisonnées, àdes rejetsmotivés par la
« non-appartenance» au secteur »
[31]
.
Eneffet,lasectorisationapuapparaîtreàcertainscommeune remise en cause
du libre choix dans la mesure où ce fonctionnement impose à une équipe
d’être en priorité au service d’une population géographiquement déterminée.
En fait, la sectorisation renforce les obligations médicales en matière de
continuité des soins dans des pathologies pour lesquelles cette nécessité est
particulièrement cruciale.
Libre choix et obligations de soins judiciaires
Il est exceptionnel qu’un juge impose tel ou tel médecin dans le cadre de
l’obligation de soins, tout au plus émet-il le choix d’une institution ou d’un
organisme offrant les garanties nécessaires. L’injonction de soins de la loi du
17 juin 1998 respecte partiellement le libre choix puisque le condamné est
invitéàchoisirunmédecintraitant,maisildoitsoumettre son choix à l’accord
du médecin coordonnateur « pour garantir que le médecin traitant désigné
dispose bien des compétences nécessaires pour suivre la personne
condamnée »(exposé desmotifs). Encas de désaccordpersistant surle choix
effectué, le médecin (traitant) est désigné par le juge de l’application des
peines. Dans cette hypothèse, il n’y a donc plus de libre choix.
DÉONTOLOGIE ET PSYCHIATRIE Psychiatrie37-061-A-10
page 2

Information et consentement aux soins
Règles juridiques et déontologiques
Sur le plan juridique, la relation médecin-malade est fondée, depuis un arrêt
de la Cour de cassation du 20 mai 1936 sur la notion de contrat. L’article
1-101 du Code civil définit le contrat comme « une convention par laquelle
uneou plusieurspersonnes s’obligentvers une ouplusieurs autresà donner,à
faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le contrat apparaît donc comme une
convention génératrice d’obligations. La jurisprudence en a défini les
caractères : contrat civil, informel, verbal et tacite, contrat résiliable, contrat
de moyens et non de résultat. Bien que bilatéral, c’est-à-dire créant des
obligations réciproques, le contrat médical n’en est pas moins particulier,
« sui generis » : la non-exécution par le patient de ses obligations (suivre les
prescriptions, payer les honoraires) n’autorise pas, de ce seul fait, le médecin
à refuser d’exécuter les siennes. Comme dans tout contrat, le libre
consentement des deux parties est nécessaire. Selon l’article 16-3 du Code
civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas
de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé
doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une
intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
L’article 36 du CDM formule de façon très explicite cette obligation de
consentement : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit
êtrerecherché dans touslescas. Lorsquelemalade, en étatd’exprimerseul sa
volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit
respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le
malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir
sans que ses proches aient été prévenus et informés sauf urgence ou
impossibilité.Lesobligationsdumédecinàl’égarddupatientlorsque celui-ci
est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article 42. »
La convention européenne de bioéthique prévoit qu’une intervention dans le
domainedelasanténepeutêtre effectuéequ’aprèsquelapersonneconcernée
y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but
et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses
risques.
Lemalade nepeut bien entendudonner sonconsentementque dansla mesure
où il a reçu une information adéquate sur le traitement qui lui est proposé
(cf Information du malade en psychiatrie).
De façon générale, les textes en vigueur n’exigent pas un consentement écrit.
Des dispositions particulières s’appliquent pour certains actes : la recherche
biomédicale (loi du 20 décembre 1988 dite loi Huriet), le traitement de
données nominatives, le don et l’utilisation des éléments et des produits du
corps humain, l’assistance médicale à la procréation, le diagnostic prénatal,
l’étude des caractéristiques génétiques, le dépistage du virus de
l’immunodéficience humaine. En revanche, comme le soulignent Hoerni et
Saury
[17]
, le refus de consentement exige un écrit. En psychiatrie, cette
question du refus du consentement se pose en cas de sortie contre avis
médical ; ce refus de soins n’est en effet recevable que si le malade ne relève
pas d’une mesure d’hospitalisation sans consentement.
Mineurs
Le mineur, c’est-à-dire le sujet de moins de 18 ans, non émancipé, est
incapable de droit, donc ne peut juridiquement s’engager dans un contrat. La
situation des mineurs au regard des soins est évoquée dans deux articles du
CDM.
Article 42. Un médecin appelé à donner ses soins à un mineur ou à un majeur
protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et
d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit
donner les soins nécessaires.
Si l’avis de l’intéressé ne peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte
dans toute la mesure du possible.
Article 43. Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que
l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
Pour les mineurs hospitalisés, ces obligations sont rappelées par le décret du
14janvier1974, relatif auxrèglesdefonctionnement des centreshospitaliers,
qui indique que, dans tous les cas, « l’admission d’un mineur est prononcée,
sauf nécessité, à la demande des père et mère, du tuteur légal ou de l’autorité
judiciaire »
[31]
.
L’article 28 de ce même décret stipule que « lorsque la santé ou l’intégrité
corporelledumineurrisquentd’êtrecompromisesparlerefusdureprésentant
légaldu mineuroul’impossibilité derecueillir le consentementde celui-ci, le
médecin responsable du service peut saisir le ministère public, afin de
provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donner les
soins qui s’imposent ».
Les droits des parents sont donc, en la matière, non pas tant des droits sur leur
enfant que pour leur enfant. L’article 371-2 du Code civil (issu de la loi du 4
juin 1970 relative à l’autorité parentale) indique : « l’autorité appartient aux
pèreet mère pourprotégerl’enfant dans sasécurité,sa santé etsamoralité. Ils
ontà son égarddroitet devoir degarde,de surveillance etd’éducation.Même
si le consentement aux soins d’un mineur n’est pas juridiquement
indispensable, il est nécessaire de donner à celui-ci des explications à la
mesure de son aptitude à les comprendre ».
Les commentaires du CDM sont explicites sur ce point : « le médecin doit
informer l’enfant et, dans la mesure du possible, recueillir son consentement.
Cetteinformationestd’autantplusimportantechezlesadolescentsqu’ilssont
capablesdeparticiperaucolloquemalade-médecin.C’estlecasen particulier
des mineurs proches de la majorité (âgés de plus de quinze ans) »
[14]
.
Incapables majeurs
La situation de l’incapable majeur est, en théorie, proche de celle du mineur.
L’article42duCDMmetl’accentsurlanécessitéde tenir compte « dans toute
la mesure du possible » de l’avis de la personne protégée.
Lesmesuresinstituéesparlaloidu 31 janvier 1968établissentunegraduation
danslaprotectiondesincapablesmajeurs,leur laissant une partplusoumoins
grande de capacité civile, et donc leur reconnaissant des degrés divers de
compétence juridique
[31]
.
– La sauvegarde de justice conserve la capacité juridique de la personne
protégée ; placé sous ce régime, le patient exprime seul son consentement.
– Dans le cas des régimes de tutelle et curatelle, on distingue les actes
médicauxgravesetles actes courants. Lepatientsouscuratellepeutconsentir
seulauxactescourants,s’ilpeutexprimersesvolontés.Danslescasdetutelle,
riennes’opposeàcequelemajeurprotégéconsulte seul pour un acte courant.
Cependant, il peut être sage pour le médecin de recueillir le consentement du
tuteur dès lors que l’acte médical dépasse le cadre d’une simple visite de
routine.
Pourlesactesgraves,ethormislescasd’urgence,le médecin cherche toujours
un double consentement : celui du représentant légal et celui de la personne
majeure protégée.
Information du malade en psychiatrie
Principes
L’expression « consentement éclairé » met l’accent, comme le soulignent
Hoerny et Saury, sur le substantif, c’est-à-dire sur la conclusion de la
transactionentremédecinetmalade ;l’adjectif«éclairé»souligne cependant
lanécessitéd’untempsinitialetégalementimportantdeleurséchanges :celui
de l’information
[17]
.
L’article 35 du CDM est entièrement consacré à l’information du patient :
«Lemédecin doit àlapersonnequ’ilexamine, qu’il soigneouqu’ilconseille,
une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et
les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le
praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance
d’undiagnosticou d’unpronosticgraves,sauf dans lescasoùl’affectiondont
il est atteint expose le tiers à un risque de contamination.
Unpronosticfatalnedoitêtrerévéléqu’aveccirconspection,mais les proches
doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement
interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »
Définition juridique de l’information
Un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1961 précise les caractéristiques de
l’information due au patient : « simple, approximative, intelligible et loyale ».
– « Simple » signifie qu’elle doit s’en tenir à l’essentiel, sans exposé
scientifiquetropdétaillé,nivocabulaireincompréhensiblepour un non-initié.
– «Approximative » signifie non pas imprécise mais la plus proche possible
de la réalité (étymologie : ad - et proximus, signifiant proximité).
– « Intelligible » signifie formulée avec les mots usuels, adaptés à
l’entendement de l’intéressé.
– « Loyale », enfin, veut dire exempte de toute tromperie.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 35 du CDM apportent (cf supra) des réserves
liées au fait que la vérité peut être préjudiciable au malade, voire dangereuse.
Ces réserves ont été formulées de manière constante dans les versions
successives du CDM. On note cependant une évolution dans la formulation ;
« la plus extrême circonspection » du Code de 1979, devient une simple
« circonspection » en 1995.
On peut finalement dire que l’honnêteté et l’efficacité thérapeutique exigent
l’information du patient mais que le devoir d’humanité veut qu’elle soit
progressive et adaptée.
Pour Hoerni, « le médecin a la liberté de dire peu : mais que ce peu soit
vrai »
[17]
.
DÉONTOLOGIE ET PSYCHIATRIEPsychiatrie 37-061-A-10
page 3

Contenu de l’information
L’information présente plusieurs aspects. Elle doit porter sur :
– l’état du patient, son évolution prévisible et les investigations ou soins
nécessaires ;
– la nature et les conséquences de la thérapeutique proposée ;
– les alternatives thérapeutiques éventuelles ;
– les suites normales d’un traitement ou d’une intervention avec la réserve
des complications éventuelles pouvant entraîner un allongement de
l’hospitalisation ;
– les risques des investigations et des soins, ce qui pose la question d’une
distinction entre d’une part les risques graves, d’autre part les risques dits
exceptionnels mais aussi celle des limites de l’information.
Sargos, conseiller à la Cour de cassation, rappelle que la première chambre
civile de la Cour de cassation a rendu entre le 25 février 1997 et le 7 octobre
1998 différents arrêts touchant à la question de l’information du patient
[28]
.
Les principes posés par ces arrêts sont les suivants :
– le médecin doit donner à son patient une information loyale, claire et
appropriée sur les risques graves des investigations et des soins ;
– l’arrêt du 7 octobre 1998 précise que « hormis les cas d’urgence,
d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de
lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves
afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de
cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent
qu’exceptionnellement ».
Mais Sargos souligne que cet arrêt n’exclut pas l’existence d’une limitation
thérapeutique de l’information lorsque « il apparaît au médecin que
l’information est de nature à avoir une influence négative sur la réussite des
investigations ou des soins »
[28]
.
Charge de la preuve
Par l’arrêt Hedreul du 25 février 1997, la Cour de cassation a modifié
profondément la question de la charge de la preuve en matière d’information.
Cette preuve était auparavant dévolue au patient qui devait démontrer, en cas
de plaintes, que le médecin avait manqué à ses obligations contractuelles en
matière d’information.
Depuis l’arrêt Hedreul, c’est au médecin qu’il incombe d’apporter la preuve
qu’il a rempli son obligation d’informer son patient :
« Le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis
de son patient et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».
L’arrêt de la Cour de cassation ne se prononce pas sur les modalités de la
preuve de l’information. Pour Sargos, conseiller à la Cour de cassation, le
CDM (base légale de l’obligation d’information) impose une information
«appropriée », termequi, par sagénéralité, exclut toutdogmatismequant àla
forme de la preuve. On distingue en droit civil trois grands modes de preuve :
lapreuve littérale(écrit), lapreuve testimoniale etla preuvepar présomption.
La jurisprudence du 25 février 1997 n’introduit aucune obligation à l’écrit.
La forme orale de l’information reste le support d’une relation de confiance,
dans le contexte culturel, déontologique et juridique français.
Cependant,onrecommande,avecJonas,l’utilisationd’uneinformationécrite
lorsqu’il existe un risque grave et une compréhension du malade ou de ses
proches imparfaite
[18]
. C’est le cas en matière de traitement par
électroconvulsivothérapie (ECT) (cf infra), mais aussi à l’occasion de refus
de soins.
Il est alors utile de faire contresigner le refus de soins par le patient et, le cas
échéant, la famille qui l’accompagne.
Lorsque l’information est donnée sous forme orale, il importe d’en conserver
une trace écrite dans le dossier du patient : le compte rendu de chaque
consultation (que ce soit au cabinet médical ou à l’hôpital) peut permettre de
retracer les échanges entre médecin et patient.
Les notes transcrites dans le dossier rentrent dans le cadre de la preuve par
présomption au sens de l’article 1353 du Code civil, c’est-à-dire un ensemble
defaits, circonstances ouéléments« graves,préciset concordants »denature
à établir que l’information a été faite.
Information du malade hospitalisé
L’article L710-2 du CSP(loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière)
reconnaît le droit à l’information du malade accueilli dans un établissement
desanté publicou privé :« Dans lerespect desrègles déontologiquesqui leur
sont applicables, les praticiens des établissements assurent l’information des
personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette
information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs
propres règles professionnelles ».
La Charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire ministérielle du 6
mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés) reprend, dans un
chapitreintitulé «del’informationdupatientetdesesproches », les principes
de la déontologie médicale concernant l’information du malade.
Les établissements doivent veiller à ce que l’information médicale et sociale
des patients soit assurée et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux
éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des patients,
afin de garantir à tous l’égalité d’accès à l’information.
Le secret médical n’est pas opposable au patient.
Le médecin doit donner une information simple, accessible, intelligible et
loyaleàtousles patients. Il répondavectactetdefaçonadaptée aux questions
de ceux-ci.
Afin que le patient puisse participer pleinement, notamment aux choix
thérapeutiques qui le concernent et à leur mise en œuvre quotidienne, les
médecins et le personnel paramédical participent à l’information du malade,
chacun dans son domaine de compétences.
Comme le suggère l’article 4 de la Charte de l’enfant hospitalisé, les mineurs
sontinformésdesactesetexamensnécessairesàleurétatdesanté,enfonction
de leur âge et de leurs facultés de compréhension, dans la mesure du possible
et indépendamment de l’indispensable information de leurs représentants
légaux.
Les majeurs protégés bénéficient d’une information appropriée.
La famille et les proches doivent pouvoir disposer d’un temps suffisant pour
avoir un dialogue avec les médecins responsables.
Pour des raisons légitimes et qui doivent demeurer exceptionnelles, un
malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic ou d’un diagnostic
graves. Un pronostic fatal doit être révélé avec circonspection, mais, à moins
que le patient n’ait préalablement interdit, notamment au cours d’entretiens
avec le médecin, cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être
faite,lesprochesdoiventgénéralementenêtreprévenus.Demême, la volonté
du patient de ne pas être informé sur son état de santé doit être respectée.
Information en psychiatrie : particularités, bénéfices thérapeutiques
Dans un ouvrage intitulé Le Consentement - Information, autonomie et
décisions en médecine
[17]
, Hoerni et Saury soulignent que, dans tout exercice
médical, le principe du consentement éclairé rencontre des difficultés
d’application : « La simplicité du principe du consentement éclairé contraste
avec la variété et la complexité des situations que l’on rencontre en pratique.
Elles tiennent à l’extrême diversité des personnes malades, des états
pathologiques (type et stade d’évolution) et des relations entre patient et
praticien. Les difficultés observées tiennent aussi aux différents temps de la
démarche : information préalable, réflexion du patient, expression du
consentement ».
Enpsychiatrie,diversfacteurs contribuent à introduiredesdistorsionsdansla
circulation de l’information entre médecin et patient.
Cesfacteurstiennentauprocessuspathologiquelui-mêmequipeutcomporter
des troubles cognitifs ou délirants, à la nature même de l’information à
donner, à la place que la famille peut être amenée à occuper dans la démarche
thérapeutique.
– Dans certains cas, il existe une altération des processus cognitifs, qui
empêche le sujet de saisir la portée du traitement proposé. Cette altération
peut être transitoire mais s’inscrire dans un tableau pathologique nécessitant
une intervention thérapeutique rapide ; elle peut à l’inverse être durable et
interférer avec l’observance régulière d’un traitement au long cours.
– Dans d’autres cas, le sujet refuse tout soin parce qu’il est convaincu de
l’incurabilité de son état, ou parce qu’il est en proie à des préoccupations
délirantes qui altèrent profondément sa perception de la réalité.
– Certains diagnostics, certaines thérapeutiques conservent une valeur
stigmatisante qui va bien au-delà de la réalité concrète des pathologies
concernées. Sontag écrivait en 1979, à propos du cancer, : « le seul nom de
certaines maladies semble doté d’un pouvoir maléfique »
[30]
. Finzen et
Hoffmann-Richter soulignent la valeur stigmatisante du mot schizophrénie :
« le terme a développé une sorte d’existence individuelle qui ne correspond
en rien à la réalité actuelle de la schizophrénie en tant que maladie »
[10]
.
Les recommandations les plus récentes concernant le traitement des patients
atteints de schizophrénie insistent néanmoins sur la nécessité de délivrer aux
patients une information « didactique et interactive » concernant la maladie
et son traitement
[14]
.
En France, à l’initiative de la Société médico-psychologique, une réflexion
associant juristes et psychiatres s’est mise en place concernant l’information
du patient dans le domaine de la dépression
[15]
et des troubles
schizophréniques
[22]
.
La famille du malade joue un rôle très important et la place qu’il convient de
lui donner doit être mesurée avec soin. Elle doit être sollicitée chaque fois
qu’une intervention est nécessaire pour mettre en œuvre des soins : c’est le
cas lorsqu’un patient refuse une hospitalisation pourtant indispensable dans
son intérêt (cf infra, Hospitalisation sans consentement).
Danslesschizophrénies, de nombreuxtravauxdémontrentl’intérêt thérapeutique
des programmes d’information et de soutien des familles
[3, 20, 22, 29]
.
Il est cependant des cas où les intérêts de la famille ne coïncident pas avec
ceuxdumalade(casdemésententeoudedivorce,parexemple).Leséchanges
DÉONTOLOGIE ET PSYCHIATRIE Psychiatrie37-061-A-10
page 4

entre patient et psychothérapeute doivent être marqués du sceau de la
confidentialité et ne sauraient être révélés à la famille, fût-elle bienveillante.
Hospitalisation et consentement
Hospitalisation libre
Le consentement du malade à un traitement ou à une hospitalisation doit, en
principe, être « libre et éclairé ».
Pourtant, la possibilité même d’un consentement à une hospitalisation en
milieu psychiatrique a longtemps été niée puisque la loi du 30 juin 1938 ne
prévoyait que des modalités d’admission sous contrainte. Seuls des textes
réglementaires régissaient jusqu’à une époque récente l’admission en «
service libre » des malades qui demandaient leur admission dans un
établissement psychiatrique.
La situation a cependant considérablement évolué depuis la fin du XIX
e
siècle
et les admissions en placement volontaire ou placement d’office ne
constituaient, en 1985, que 11 % des entrées dans les services de psychiatrie.
La loi du 27 juin 1990 donne une existence juridique à l’hospitalisation libre.
Le texte de loi abandonne les termes de placement ou d’internement pour
retenir ceux d’hospitalisation libre ou sans consentement.
Cette mise à jour de la terminologie, qui peut paraître de pure forme (le
placement volontaire devenant hospitalisation sur demande d’un tiers, le
placement d’office devenant hospitalisation d’office) souligne cependant que
l’hospitalisation psychiatrique doit être replacée dans le cadre juridique et
déontologique général.
Les articles L 326-1 et L 326-2 du CSP stipulent :
– L326-1 : « Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans
celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation
dansunétablissementaccueillantdesmaladesmentaux,hormislescasprévus
par la loi » ;
– L 326-2 : « Toute personne librement hospitalisée pour des troubles
mentauxest diteen hospitalisation libre.Elle disposedesmêmes droits,liés à
l’exercice des libertés individuelles, que ceux qui sont reconnus aux malades
hospitalisés pour une autre cause ».
Les malades disposent donc des différents droits et libertés reconnus aux
malades hospitalisés dans un service de soins généraux. On leur applique le
décretdu 14janvier 1974, dontl’article 42prévoit, pourle malade, ledroit de
refuser un traitement.
Hospitalisations sans consentement
La législation de 1990 a voulu se mettre en conformité avec les
recommandations relatives à la « protection juridique des personnes atteintes
de troubles mentaux et placées comme patients involontaires » adoptées par
le comité des ministres du Conseil de l’Europe le 22 février 1983, ainsi
qu’avec le projet de résolution n° 1989-40 de la Commission des droits de
l’Homme de l’Organisation des Nations unies, relatif aux « principes et
garanties pour la protection des personnes détenues pour maladies mentales
et souffrant de troubles mentaux »
[31]
.
Laloidu27juin1990maintientlaséparationdespouvoirsetdescompétences
entre les autorités ou les personnes qui décident d’un placement et celles qui
le contrôlent, séparation nécessaire spécifiée par ces recommandations et
résolutions,maisquiétaitdéjàprévuepar la loi du30juin1938,dansunsouci
de respect de la liberté individuelle.
Elle prévoit, d’autre part, une révision périodique de la durée des
hospitalisations sans consentement, qu’il s’agisse de l’hospitalisation sur
demande d’un tiers ou de l’hospitalisation d’office.
Eneffet,danslatrèsgrandemajoritédescas,ilestpossible,aprèsavoirobtenu
une amélioration, de convaincre le malade du bien-fondé du traitement
entrepris et de le poursuivre avec son accord. Les procédures de révisions
périodiques des mesures d’hospitalisation viennent rappeler au médecin que
celui-ci doit rechercher à obtenir la collaboration du patient à ses soins dès
qu’elle est possible.
En effet, comme le souligne Durand, « la confiscation ou la limitation des
libertés du malade n’est pas une fin, elle est un moyen d’assurer les soins que
nécessite l’état psychopathologique du patient » et « le médecin qui prend en
charge un malade ne confisque pas sa liberté pour protéger la société » mais
pour « restituer au sujet le maximum de liberté possible »
[9]
.
Soins en urgence
On a vu que les deuxième et troisième alinéas de l’article 36 du CDM traitent
de la question du consentement en urgence : « Lorsque le malade, en état
d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le
médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses
conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin
ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf
urgence ou impossibilité. »
Sur le plan pratique, le problème peut se poser en ce qui concerne la conduite
à tenir vis-à-vis d’un malade admis pour une tentative de suicide. Devant un
coma profond, c’est bien sûr l’hospitalisation qui s’impose, en s’assurant de
conditions de transport adéquates. Cependant, l’attitude réticente, voire
opposante,d’unsujetencoreconscientpeutposerunproblèmedélicat.Iln’est
pas toujours possible de connaître la qualité et la quantité des produits
éventuellement ingérés et les circonstances de la rencontre ne permettent pas
une évaluation psychopathologique en profondeur.
On est en fait dans une situation de péril imminent qui impose d’intervenir,
comme l’indique l’article 9 du CDM : « Tout médecin qui se trouve en
présenced’un malade oud’un blessé enpéril, ou informéqu’unmalade ouun
blesséesten péril,doitluiporter assistance ous’assurerqu’ilperçoit les soins
nécessaires. » Hoerni et Saury évoquent à ce sujet la loi genevoise du
6 décembre 1987 : « dans le cas d’urgence, lorsque le patient n’est plus en
mesure de se prononcer et que l’intervention thérapeutique est vitale, le
consentement est présumé ».
Rester inactif sous le prétexte que le malade ne peut ou ne veut donner un
consentement éclairé serait de nature à justifier des poursuites pour non-
assistance à personne en péril.
Une telle situation impose de fait de manifester l’instance la plus pressante
auprès du patient et une attitude ferme vis-à-vis de l’entourage lorsque ce
dernier est tenté de minimiser le geste.
En revanche, le recours à de trop systématiques hospitalisations sans
consentement, selon les procédures prévues par la loi du 27 juin 1990, paraît
fort discutable ; ce n’est que dans le cas où, après réanimation, le tableau
psychopathologiquel’impose quela miseen œuvre deces procédurespeut se
justifier.
Électroconvulsivothérapie
La loi du 27 juin 1990 énonce, dans l’article L 326-3 du CSP, les droits et
libertésdumaladeadmissansconsentement.Le droit de refuseruntraitement
n’en fait pas partie. Ce droit reste mal codifié en France à l’heure actuelle,
mais il est évoqué dans d’autres législations européennes (en Grande-
Bretagne en particulier).
Auby rappelle que, selon la jurisprudence française, il convient de distinguer
le consentement aux actes médicaux courants, inclus dans le contrat médical
initial,du consentement quidoitêtre obtenu spécifiquementpourchaque acte
médical important. La jurisprudence énonce à cet égard que « avant
d’entreprendre un traitement ou de procéder à une intervention chirurgicale,
lemédecin esttenu, hors descas denécessité, d’obtenirle consentement libre
et éclairé du malade ou, dans le cas où il serait hors d’état de le donner, celui
des personnes investies à son égard d’une autorité légale »
[2]
.
Un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1955, concernant un
traitement par électroconvulsivothérapie (ECT) chez une malade déprimée,
constitue d’ailleurs l’une des bases de la jurisprudence sur le consentement
éclairé en pratique médicale.
Dans le cas d’une hospitalisation libre, la mise en œuvre d’un traitement par
ECT nécessite donc une information préalable du malade : les
Recommandations pour la pratique clinique publiées en avril 1997 par
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES)
indiquent : « Une information complète et adaptée sur l’ECT sera donnée au
patient et à son entourage (dont le tuteur s’il y a lieu) par le médecin
responsable de l’administration du traitement, l’équipe soignante et
l’anesthésiste qui donne une information spécifique à l’anesthésie.
Comme pour toute intervention médicale importante le consentement du
patient (et/ou de l’entourage) est recherché. À l’issue de ces entretiens, un
document reprenant les informations énoncées pourra être remis au patient
et/ou à l’entourage ».
L’ANAES propose un modèle de document d’information utilisable dans les
hôpitaux ou cliniques qui pratiquent ce traitement
[26]
. Lorsque le refus est
sous-tenduparun désir demortmélancolique,oupar un étatconfusionnel,on
peut estimer, en conscience, qu’il est légitime de passer outre. Cette décision
est prise, bien entendu, en fonction du bénéfice prévisible pour le patient, en
tenantcompte des indicationsspécifiquesde ce traitement.Ondemande alors
l’accord écrit du plus proche parent pour cette thérapeutique après l’avoir
informé selon les modalités décrites (cf supra). Il est alors nécessaire que le
traitement se déroule dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement.
Consentement et obligations de soins judiciaires
Le problème est ici de savoir si le principe du consentement aux soins peut
être modifié au prétexte que le patient s’est rendu coupable d’une infraction,
qu’ilprésentedestroubles psychiques, que cestroublesconstituentundanger
pour autrui et que ce danger peut être supprimé ou diminué par des soins
appropriés et prodigués de manière obligatoire. Le problème est plus aigu
lorsque la volonté du patient n’est pas de se soigner mais d’échapper à une
peine en respectant une obligation de soins. Il a été souvent débattu pour les
toxicomanes et plus récemment pour les auteurs d’infractions sexuelles. À
DÉONTOLOGIE ET PSYCHIATRIEPsychiatrie 37-061-A-10
page 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%