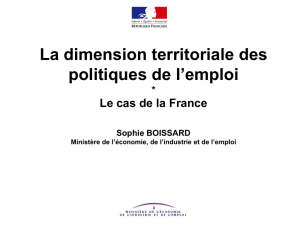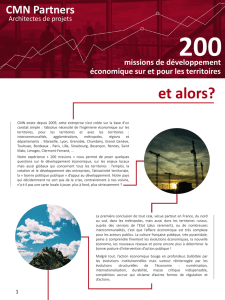Évaluer l`organisation territoriale en Algérie et identifier ses

Évaluer l’organisation territoriale en Algérie et identifier
ses impacts sur l’optimisation de l’action collective
Djamal SI-MOHAMMED, Maître de Conférences A - HDR,
Maître de Conférences HDR en sciences économiques,
Responsable du Groupe de Recherches sur la Ville
Algérienne
Faculté des sciences économiques et des sciences de
gestion
Université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, Algérie
E_mail :[email protected]

Résumé de la communication / conférence :
La question de l’organisation territoriale et des problèmes que cette dernière soulève –
ou résout -, va de pair avec la recherche d’un quasi-mythique « optimum territorial », lequel
façonnerait de manière parfaite les règles régissant la hiérarchie, la coopération/partenariat
ainsi que la distribution spatiale des sous espaces concernés. Plus prosaïquement, il s’agit
d’assurer, sur un espace de type macro-économique représenté par l’Etat, une sorte de bonne
intelligence entre tous les espaces de niveau inférieur qui y gravitent, l’objectif étant qu’ils
s’inscrivent dans un partenariat gagnant-gagnant profitable à tous.
En Algérie, se pose la problématique des verrous institutionnels qui enchaînent les
initiatives territoriales, verrous qui ont pour noms wilayas, daïras, ou même communes dans
la mesure où ce cadre se révèle souvent trop étroit pour se prévaloir de la moindre pertinence
économique.
La question est donc de savoir si, dans cet espace référentiel qu’est l’Algérie, ces entités
de type wilaya – daïra et commune, nonobstant les différences institutionnelles et structurelles
qui les caractérisent, peuvent, sous réserve que l’organisation territoriale dans laquelle elles
s’insèrent soit « pertinente », ne pas s’opposer entre elles mais au contraire, vont tendre à
maximiser leurs complémentarités et à dépasser leurs différences…
Mots-clés : Territoires – action publique – gouvernance – organisation – économie
Bibliographie
Bailly (A) : « Territoires et territorialités », in Encyclopédie d’économie spatiale, Ed.
Economica, Paris, 1994.
Becattini : « Le district marshallien : une notion socio- économique », in Benko et Lipietz :
« Les régions qui gagnent, district et réseaux », Ed. PUF, Paris, 1992.
Benko (G) et Lipietz (A) : « Les régions qui gagnent, district et réseaux », Ed. PUF, Paris,
1992.
Guigou (J.L.) : « Coopération intercommunale et nouveau modèle de croissance », in RERU
n°4, 1978.
Lacour (C) : « La tectonique des territoires » in B. Pecqueur, « Dynamiques territoriales et
mutations économiques », Ed. L’Harmattan, Paris, 1996.
Leberre (M) : « Territoires », in Encyclopédie d’économie spatiale, Ed. Economica, Paris,
1992.
Lipietz (A) : « Le capital et son espace », Ed. Maspero, Paris, 1977.
Pecqueur (B) : « Dynamiques territoriales et mutations économiques », Ed. L’Harmattan,
Paris, 1996.

Les territoires semblent être devenus des acteurs du changement c’est-à-dire qu’ils
interviennent en tant qu’opérateurs, vecteurs ou encore opportunités de changement. Ils ne
sont plus pensés comme seulement des résultats politiques, des objets issus des processus
historiques, des réalités sociales et culturelles ou des héritages plus ou moins administrés.
Les territoires deviennent de plus en plus dépendants des processus qui les ont vu naitre (la
territorialisation) et semblent tendre vers le souhait de permettre l’avènement de nouvelles
territorialités. En cela, les territoires mobilisent de plus en plus de ressources, d’énergies, de
potentialités de toute sorte. Et ils représentent, alors, des formes nouvelles et des
configurations de plus en plus diversifiées…
Les questions territoriales sont au cœur d’un grand nombre des questions de
l’actualité sociale, politique, culturelle et économique, comme elles sont de plus en plus au
centre de travaux scientifiques multidisciplinaires Il convient par conséquent de se pencher
sur les problèmes divers ainsi soulevés par cette montée en puissance de la dimension
territoriale…
Le processus qui sous-tendrait la construction de territorialités de plus en plus
différenciées étant appelé « territorialisation », il s’agira alors de cerner cette nouvelle
approche, d’en définir les référents théoriques et conceptuels et de voir de quelle manière
et dans quelle mesure, ce champ théorique actuellement si défriché s’arrime aux notions et
pratiques plus classiques et usuelles que sont l’analyse économique et le développement
régional et local…
Ainsi, l’un des principaux questionnements portés par cette recherche consiste à
s’interroger – et à tenter de répondre - sur ces concepts qui prennent les « territoires »
comme objet d’étude, afin de permettre de mieux comprendre les dynamiques qui les
traversent. Les questions sont alors de savoir si les territoires peuvent être eux-mêmes et en
eux-mêmes source de changements, s’ils peuvent contribuer effectivement et efficacement
au changement et non pas seulement être des forces d’adaptation aux changements qui
seraient imposés par ailleurs, comme il s ’agit aussi de déterminer les mécanismes par
lesquels les territoires entrent en compétition, les uns par rapport aux autres, les uns contre
les autres, à travers des formes, des configurations et des processus sans cesse changeants,
mais toujours mus par les mêmes leitmotivs, ceux de l’indispensable compétitivité et de son
corollaire impératif, une organisation territoriale optimale consacrant une efficience et une
efficacité économique qui ne seraient plus, dès lors, l’apanage des seules entreprises …
La question de l’organisation territoriale et des problèmes que cette dernière soulève – ou
résout -, va de pair avec la recherche d’un quasi-mythique « optimum territorial », lequel
façonnerait de manière parfaite les règles régissant la hiérarchie, la coopération/partenariat
ainsi que la distribution spatiale des sous espaces concernés. Plus prosaïquement, il s’agit
d’assurer, sur un espace de type macro-économique représenté par l’Etat, une sorte de

bonne intelligence entre tous les espaces de niveau inférieur qui y gravitent, l’objectif étant
qu’ils s’inscrivent dans un partenariat gagnant-gagnant profitable à tous.
Cela revient à considérer, sur l’espace référentiel qu’est l’Algérie, que des entités de
type wilaya – daïra et commune, nonobstant les différences institutionnelles et structurelles
qui les caractérisent, peuvent, sous réserve que l’organisation territoriale dans laquelle elles
s’insèrent soit « pertinente », ne pas s’opposer entre elles mais au contraire, vont tendre à
maximiser leurs complémentarités et à dépasser leurs différences…
Tout le problème vient cependant du fait que, une fois acquis l’idéal démocratique qui
libère les énergies et les initiatives citoyennes, bonifie l’entrepreneuriat et propulse l’esprit de
compétition au rang de moyen d’atteindre des objectifs sans cesse plus ambitieux, les
territoires vont dès lors, non plus rechercher le confort d’une fausse entente dans laquelle,
forcément, les plus dotés n’auront d’autre ambition – fort naturelle par ailleurs - que de
soumettre les espaces les moins bien lotis à leur propre logique territoriale, et à arrimer leur
propre dynamique à l’inertie qu’elles imposeront aux seconds…, mais au contraire, vont
s’inscrire de manière assumée dans une logique de compétition et de concurrence
économique.
Cette dimension de « compétiteurs », les territoires la devront, quelque soit le niveau
socio-économique qui sera le leur, aux différents potentiels dont chacun, à son niveau, est
porteur, et dont ils sont conscients que l’opportunité historique leur commandera de
l’exploiter de manière productive, parfois seuls, le plus souvent dans l’association,
conjoncturelle, avec d’autres territoires, et sur des créneaux particuliers, changeants,
durables ou éphémères…
L’histoire économique et territoriale récente nous offre, sous différentes latitudes, des
exemples de ce type de « collaboration » territoriale matérialisée par ces concepts – devenus
cultes -, que sont les SPL ou systèmes productifs locaux, les districts ou encore les
clusters…tous ayant en commun le fait qu’ils se réalisent peu ou prou sous le régime de
l’intercommunalité. Dans ce sens et se rapportant à notre pays, les expériences menées sur la
base de regroupements territoriaux ont eu pour nom pépinières ou encore incubateurs
d’entreprise et les résultats de ces initiatives s’apprécient différemment même si elles ont le
grand mérite d’exister.

Regroupements territoriaux sur la base de projets communs et précis, et mise des
territoires en compétition économique peut sembler antinomique de prime abord. Il n’en est
rien bien évidemment d’abord parce que deux ou plusieurs territoires – comme deux ou
plusieurs entreprises – peuvent ressentir la nécessité impérieuse de s’unir lorsque leur intérêt
le leur commande – intérêt « positif » / profit ou intérêt « négatif » / instinct de survie -, puis,
lorsque il n’ya plus ni « danger », ni « affinités », décider, non de se déclarer la guerre, mais
de s’affronter en compétition loyale, pour attirer les investisseurs et les entrepreneurs, pour
bénéficier de projets structurants financés sur concours de l’Etat, pour faire venir la main
d’œuvre ou l’encadrement le plus qualifié qui soit…etc.
Parlant de l’Etat, il est utile de dire que ce dernier, en tout cas dans un pays comme
l’Algérie ou plus généralement dans ces économies de seconde zone non encore développées
ni même émergentes, mais plus « sous développées » au sens où l’entend l’histoire
économique, détient les clés de l’organisation territoriale et qu’il peut l’orienter aussi bien
dans le sens de la liberté économique et d’entreprendre que dans celui du dirigisme le plus
rétrograde et de l’inertie la plus poussée.
Il est un lieu commun de dire que l’Etat est enclin, en période de vaches maigres, à
libérer l’initiative y compris territoriale, afin que les sous espaces qu’il contrôle puissent
générer les ressources qu’il n’est plus capable – ou qu’il ne veut plus – fournir, tandis qu’il
reprend ses travers autoritaires et centralisateurs à partir du moment où les revenus dont ils
disposent lui permettent de redevenir l’Etat-Providence qu’il affectionne.
Il s’agit alors de retourner durablement cette problématique en faisant en sorte que
les pouvoirs publics s’insèrent dans cette dynamique dite du gagnant-gagnant en laissant aux
territoires locaux le soin de s’affronter sur le terrain de la compétition socio-économique, leur
rôle en tant que puissance publique se limitant à assurer l’équité et l’arbitrage loyal qui sied à
une telle concurrence. C’est à cette condition, et à celle là seulement, que pourra s’installer
un esprit d’émulation pouvant faire boule de neige et entraîner les territoires laissés en reste
sur le mêmes dynamiques de croissance et de développement socio-économique.
Bien entendu, l’Etat devra faire preuve d’imagination et d’audace lorsque les cadres
administratifs au sein desquels se déroule cette compétition, et qu’il aura lui-même contribué
activement à mettre en place, constituent autant de carcans qui entravent la liberté d’agir et
de faire et qui menacent de faire perdre au territoire tout le potentiel de compétitivité,
d’efficience ou d’efficacité dont il pourrait être éventuellement porteur.
 6
6
1
/
6
100%
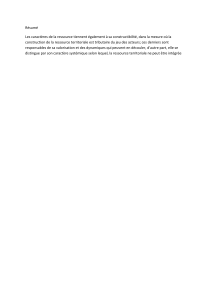

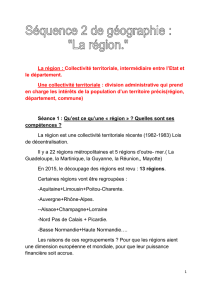
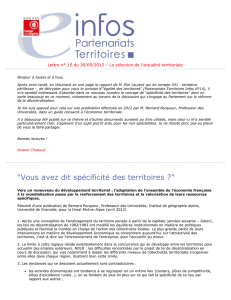
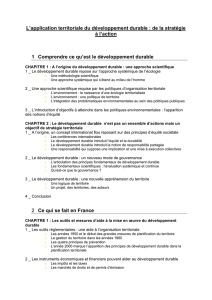
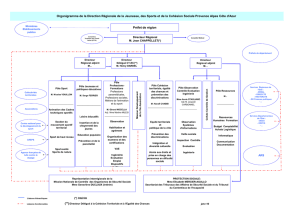

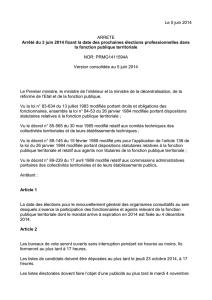
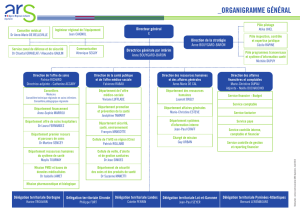
![NBI : Attribution [ARRETE]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001610458_1-03d1189cab4882a75f83f5046f8d33d1-300x300.png)