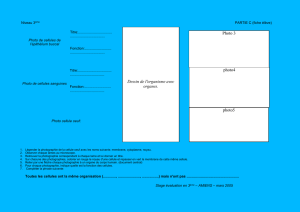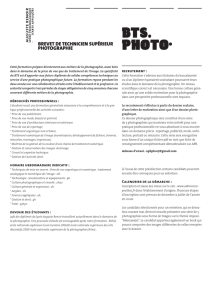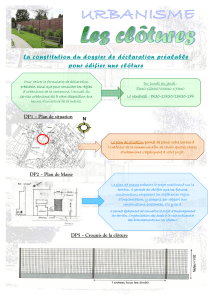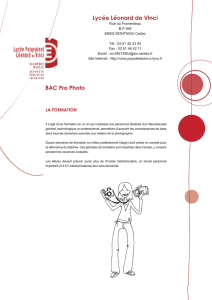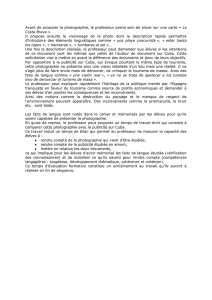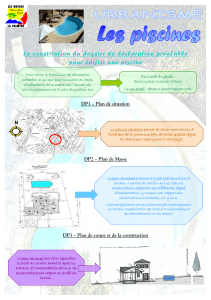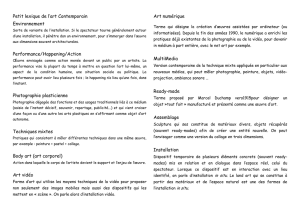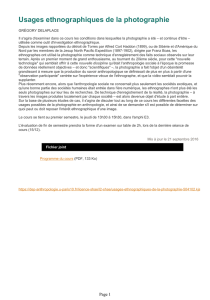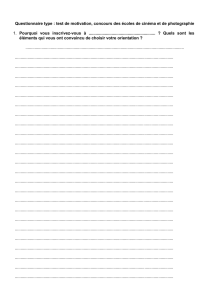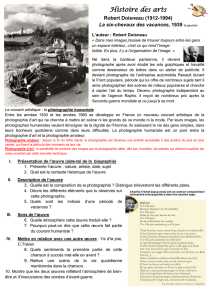Philosophie de la photographie

1/82
Philosophie de la Photographie Henri Van Lier
in Les Cahiers de la Photographie, 1983
PHILOSOPHIE DE LA PHOTOGRAPHIE
LA PHILOSOPHIE OÙ CONDUIT LA PHOTOGRAPHIE
Première Partie: TEXTURE ET STRUCTURE DE LA PHOTOGRAPHIE
Ch. 1 - L'EMPREINTE ABSTRACTIVE
1. L'empreinte photonique : l'apesanteur.
2. L'empreinte à distance : la minceur de champ.
3. L'empreinte cadrée.
4. L'empreinte isomorphique.
5. L'empreinte synchrone.
6. L'empreinte positive-négative : le battement.
7. L'empreinte analogique et digitale.
8. L'empreinte surchargée et sous-chargée.
Ch. 2 - LES INDICES ET LES INDEX
Ch. 3 - LES EFFETS DE CHAMP AVANT LES DÉNOTATIONS ET CONNOTATIONS
Ch. 4 - LA NON-SCÈNE : DE L'OBSCÈNE AUX STIMULI-SIGNES ET AUX FIGURES
Ch. 5 - REPRODUCTION ET TRANSMUTABILITÉ : PROCESSUS ET RELAIS
Ch. 6 - LA RÉALITÉ ET LE RÉEL LE COSMOS-MONDE ET L'UNIVERS L'ÉVENTUEL ET
LA BOITE NOIRE
Ch. 7 - LE DÉCLENCHEMENT DES SCHÈMES MENTAUX
Ch. 8 - LES AUTRES TYPES QUE LE NOIR ET BLANC
1. La photo couleur : la symbiose.
2. La diapositive : la transfiguration.
3. Le polaroïd SX 70 : le retour du corps.
Deuxième Partie: LES INITIATIVES PHOTOGRAPHIQUES
Ch. 9 - L'INITIATIVE DE LA TECHNIQUE INDUSTRIELLE
Ch. 10 - L'INITIATIVE DE LA NATURE
1. La constante c.
2. La constante h.
Ch. 11 - L'INITIATIVE DU SPECTACLE : LES PHOTOGÉNIES
Ch. 12 - L'INITIATIVE DU PHOTOGRAPHE : TRAPPE ET AIGUILLAGE LA MÉDIUMNITÉ
Troisième Partie: LES CONDUITES PHOTOGRAPHIQUES
Ch. 13 - LES CONDUITES PRAGMATIQUES
1. Le voyeurisme modéré.
2. Le positionnement publicitaire.
3. Le jeu mortel de la mode.
4. Le saint-sacrement sentimental.
Ch. 14 - LES CONDUITES ARTISTIQUES
1. L'art quotidien : élucidation et confirmation des codes.
2. L'art extrême.
Ch. 15 - LA CONDUITE SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE, TESTIMONIALE
Conclusion : LA PHOTOGRAPHIE ET LES OPÉRATEURS CONTEMPORAINS
Postface : NOUVELLES PERSPECTIVES THÉORIQUES
1. Photographie et ontologie intelligible
2. Photographie et vision de primate
3. Photographie et anthropogénie
Appendice: PIERCE ET LA PHOTOGRAPHIE

2/82
Philosophie de la Photographie Henri Van Lier
in Les Cahiers de la Photographie, 1983
Thierry Zeno : Thaïlande. 1977

3/82
Philosophie de la Photographie Henri Van Lier
in Les Cahiers de la Photographie, 1983
LA PHILOSOPHIE OÙ CONDUIT LA PHOTOGRAPHIE
Une fois que les virtualités d'un grand agent primitif sont ainsi complètement
maîtrisées, on devine combien largement il nous aidera à débrouiller d'autres
secrets dans les sciences de la nature.
ELISABETH EASTLAKE, Photography, 1857.
Philosophie de la photo peut signifier qu'on philosophe sur elle. C'est-à-dire qu'on
l'interroge à partir de notions que les philosophes ont accumulées depuis deux mille cinq cents
ans. On lui demande alors quels sont ses rapports avec la perception, l'imagination, la nature, la
substance, l'essence, la liberté, la conscience. Le danger de cette approche est qu'elle applique à la
photo des Concepts qui ont été créés longtemps avant son apparition, et qui risquent donc de lui
convenir mal. Et en effet beaucoup de philosophes honorables ayant suivi ce chemin ont conclu
que la photographie était de la peinture ou de la littérature amoindries. Ce jugement était
prévisible, puisque les concepts de la philosophie occidentale expriment justement une vision
picturale, sculpturale, architecturale et littéraire des choses.
Mais philosophie de la photo peut désigner aussi la philosophie que propose la photo
elle-même, celle qu'elle suggère et diffuse en vertu de ses caractéristiques. Tout matériau, tout
instrument, tout processus disposent autour d'eux, par leur texture et leur structure, une certaine
façon de construire l'espace et le temps. Ils activent davantage telle portion de nos systèmes
nerveux. Ils invitent à des gestes ou des opérations, ils en excluent d'autres. Pour autant, ils
instituent un style d'existence chez ceux qui les utilisent. Il n'y a pas de raison que les pellicules,
les appareils, les papiers photographiques soient dépourvus de ce genre d'action. Sans doute
suggèrent-ils un espace et un temps imprévus, une façon autre de saisir la réalité et le réel, l'action
et l'acte, l'événement et l'éventuel, l'objet et le processus, la présence et l'absence, bref une
certaine philosophie.
Il va de soi que philosophie est pris ici au sens vulgaire. Psychologie de la photo,
sociologie ou anthropologie de la photo auraient également convenu. Et pourquoi pas
épistémologie, sémiologie, indiciologie de la photo ? En voyant seulement qu'il s'agit toujours de
ce que la photo impose ou distille, non de ce que nous lui demandons. L'entreprise n'en est pas
facile pour autant. Car ce ne sont pas que nos philosophies, ce sont nos langues qui ont été
forgées dès l'origine pour parler peinture, architecture, littérature. Dieu était peintre, sculpteur,
architecte ou poète, selon les cas, puisque l'homme l'était. Nous n'avons donc pas de mots pour
bien décrire une photo. Mais les termes de spécialistes seraient encore plus trompeurs, car seul le
langage courant a le pouvoir, en se bricolant, de se recoder lui-même pour aborder des objets
neufs. Qu'on veuille donc bien ici oublier les jargons, et en particulier celui de la linguistique.
Pour parler du désignant et du désigné, de la réalité et du réel, de l'indice et de l'index, de
percevoir et d'apercevoir, d'acte et d'action, nous devrons demander au lecteur l'effort de
retrouver un français naïf, qui se définira et redéfinira au fur et à mesure des besoins.

4/82
Philosophie de la Photographie Henri Van Lier
in Les Cahiers de la Photographie, 1983
PREMIÈRE PARTIE
TEXTURE ET STRUCTURE DE LA PHOTOGRAPHIE
Théoriquement, on peut supposer qu'un certain nombre de photographies n'ont
pas d'autre propos que de saisir la lumière sans préméditation.
MAX KOZLOFF, Photography and Fascination, 1979.
Disposons dans un fourré un appareil photographique qui se déclenche
automatiquement toutes les minutes. Nous obtiendrons sur nos clichés un gris-noir homogène,
des taches plus ou moins chaotiques, d'autres taches ayant peut-être des formes de plantes,
d'animaux partiels ou entiers. Ce sont toutes des photos. On en prend ainsi des millions chaque
jour. Tout le monde s'ait que beaucoup sont intéressantes scientifiquement, sociologiquement,
voire esthétiquement. Cette situation n'a rien d'exceptionnel. Des photographes patentés se
plaisent à déclencher leur appareil sans regarder dans leur viseur, et le journaliste qui attrape sa
vedette par-dessus la tête ou entre les jambes du reporter voisin n'est pas loin de cette façon de
faire, d'autant plus que son appareil se déclenche par rafales. Nous prendrons donc les photos
aléatoires comme cas minimum de la photographie.
Qu'apprenons-nous ainsi ? Que, dans une photo, il y a toujours des empreintes
lumineuses, c'est-à-dire que des photons sont venus de l'extérieur et ont impressionné une
pellicule sensible. Il y a donc eu un événement, l'événement photographique : la rencontre de ces
photons et de cette pellicule. Cela a certainement été. Quant à savoir si à cet événement physico-
chimique en a correspondu un autre, un spectacle d'objets et d'actions, dont les photons
empreints seraient les signaux en tant qu'émis par eux, c'est beaucoup plus problématique et
demande à être soigneusement précisé. Vois-je là la réalité de choses et d'actions passées ? Ou
seulement un certain nombre de photons émis par elles selon un système de sélection sévère et
artificiel ?
Toutes les inexactitudes dans les théories de la photographie viennent de ce que l'on est
passé un peu précipitamment sur le statut bizarre des empreintes lumineuses, empreintes très
directes et très assurées de photons-, mais empreintes très indirectes et très abstraites d'objets.
Nous allons donc essayer d'en dénombrer et décrire les caractères aussi scrupuleusement que
possible, en sachant que c'est là que tout se joue.

5/82
Philosophie de la Photographie Henri Van Lier
in Les Cahiers de la Photographie, 1983
Cartier-Bresson : Leningrad
Ch. 1 - L'EMPREINTE ABSTRACTIVE
M. Biot pense avec M. Arago que la préparation de M. Daguerre fournira des
moyens aussi nouveaux que désirables pour étudier les propriétés d'un des agents
naturels qu'il nous importe le plus de connaître et que jusqu'ici nous avions si peu de
moyens de soumettre à des épreuves indépendantes de nos sensations.
Compte rendu de l'Académie des sciences, séance du 7 janvier 1839.
1. L'empreinte photonique : l'apesanteur.
La plupart des empreintes auxquelles nous avons affaire sont le résultat d'un impact,
comme le coup de sabot du sanglier dans la boue, ou d'un contact matériel plus ou moins
prolongé avec une substance, comme dans des taches marquant un tissu. Le photon qui traverse
les lentilles de l'objectif et altère les halogénures de la pellicule n'est pas vraiment une substance et
il ne produit pas d'impact. Il a une énergie, mais pas de masse. Nous connaissons cela par ailleurs,
puisque nous prenons des bains de soleil et portons des marques de maillot qui nous
transforment en photogrammes. L'apesanteur des photons donne à leurs inscriptions une
apesanteur saisissante, et presque une immatérialité. Le brunissage n'est pas un maquillage.
2. L'empreinte à distance : la minceur de champ.
Les photons qui imprègnent la pellicule sensible proviennent de sources lumineuses
situées dans un certain volume (la profondeur de champ) distant de l'appareil, ce qui crée une
première abstraction. Ce volume distant se définit à partir d'un plan où les photons réfléchis ou
émis ont la meilleure différenciation sur la pellicule : c'est le plan de mise au point, repéré
statistiquement dans le résultat, et qui crée une deuxième abstraction. Les photons de la
profondeur de champ qui n'appartiennent pas à ce plan privilégié sont localisés par rapport à lui
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
1
/
82
100%