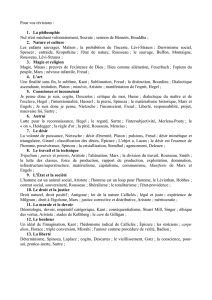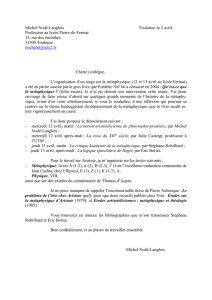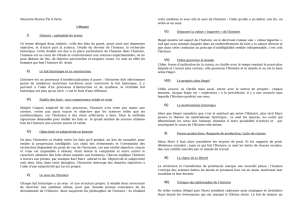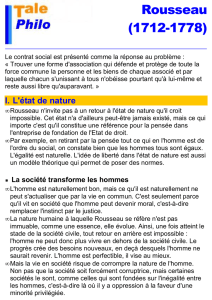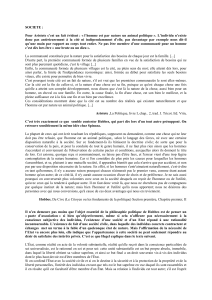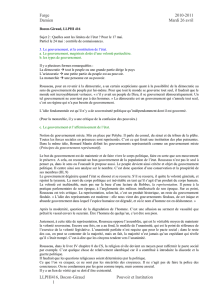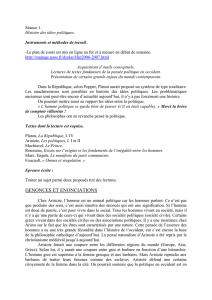La fin de l`Etat

La politique La fin de l'Etat Michel Nodé-Langlois.doc
© Michel Nodé-Langlois – Philopsis 2007 1
La p olitique
La fin de l’Etat
Michel Nodé-Langlois
Philopsis : Revue numérique
http://www.philopsis.fr
Les articles publiés sur Philopsis sont protégés par le droit d'auteur.
Toute reproduction intégrale ou partielle doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation auprès des éditeurs et des auteurs. Vous pouvez citer librement
cet article en en mentionnant l’auteur et la provenance.
Dans son Traité théologico-politique, Spinoza écrit que « la fin de
l’État est en réalité la liberté »1. La pensée politique de Spinoza s’inscrit
dans la postérité de la théorie de Hobbes, qui fonde l’État sur un pacte, c'est-
à-dire une institution volontaire. Hobbes opposait explicitement sa propre
doctrine au naturalisme aristotélicien. La formule de Spinoza rend toutefois
cette opposition assez insignifiante puisque c’est Aristote qui a le premier
défini l’État « une communauté d’hommes libres »2. Elle s’explique dans la
mesure où la conception de Hobbes servait à justifier un absolutisme
politique dans lequel la « réalité » de la liberté prend une apparence qui
semble lui être exactement contraire, celle d’une obéissance soumise à la
puissance coercitive des pouvoirs publics. Aussi bien Nietzsche – pour qui
au demeurant la notion de liberté était une illusion majeure – a-t-il pu décrire
l’État moderne, issu des théories bourgeoises, comme « le plus froid de tous
les monstres froids »3. C’est à ce monstre que s’en prend la critique
anarchiste, selon laquelle la liberté ne saurait être considérée comme la fin
qui donnerait à l’État sa raison d’être, mais bien plutôt comme ce dont la
réalisation suppose la disparition de celui-ci : la fin de l’État est alors
supposée être le moyen de ce qu’une idéologie fallacieuse fait passer pour sa
véritable justification.
1 Spinoza, Traité théologico-politique, ch. XX , trad. Appuhn, éd. GF, p.329.
2 Aristote, Politique, III, 6, 1279a 21.
3 Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, De la nouvelle idole.

La politique La fin de l'Etat Michel Nodé-Langlois.doc
© Michel Nodé-Langlois – Philopsis 2007 2
Il paraît clair que l’obéissance volontaire aux lois de l’État pourra
difficilement être motivée si elle est simplement contraire à la liberté qui est
son principe. Il s’agit dès lors de savoir si celle-ci peut donner à l’État une
finalité essentielle et permanente, qui justifie sa pérennité historique, ou s’il
y a là une contradiction qui doit conduire à ce que Marx dénomme son
dépérissement.
*
La définition héritée d’Aristote signifiait que la communauté politique
– sous la forme grecque de la polis – est une réunion d’hommes qui exercent
ensemble leur pouvoir de délibération et de décision, exercice qui caractérise
le citoyen en tant que tel. Cette définition exprimait une essence, c'est-à-dire
tout aussi bien, pour Aristote, une norme. Elle signifiait en effet qu’il n’est
pas d’organisation politique qui ne fonctionne par une coopération
volontaire, fût-ce celle d’un tyran et de ses complices, car le pouvoir n’est
jamais d’un seul. Reste que précisément tous les pouvoirs de fait ne
reviennent pas au même. Car il ne saurait y avoir de communauté sans qu’il
y ait un bien commun, c'est-à-dire sans que l’appartenance à la communauté
soit un bien pour ses membres. Mais il est possible que le fonctionnement de
la communauté soit au bénéfice de certains plutôt que de tous, et c’est ce qui
pour Aristote caractérise la forme corrompue des régimes conformes à la
vocation essentielle de l’État, la tyrannie par rapport à la monarchie,
l’oligarchie par rapport à l’aristocratie, et le gouvernement populaire
(dèmokratia en grec) par rapport à la république. La corruption politique
consiste ici en un détournement de finalité, lorsque l’obéissance commune
est mise au service d’un intérêt partiel. La rectitude du régime ne tient pas au
nombre de ceux qui se voient attribuer les charges publiques, mais Aristote
n’en souligne pas moins que c’est dans le régime républicain que l’essence
du citoyen trouve à se réaliser le plus parfaitement4, du fait que tous peuvent
y être appelés tour à tour à commander et à obéir, ce qui est l’exercice
proprement politique de la liberté. Le citoyen est un homme libre
(éleuthéros) au sens grec du terme, c'est-à-dire au sens où, par opposition à
l’esclave, qui a sa fin dans la volonté d’un autre, il est à lui-même sa propre
fin. Aristote avait vu dans cette liberté la raison d’être de la communauté
politique, par-delà ces communautés naturelles que sont la famille (oïkia) et
le bourg (komos). Et, alors même qu’il ne songeait pas à remettre en
question la restriction de cette liberté à un petit nombre d’individus de sexe
masculin, il avait posé la thèse que l’État est fondé en nature parce que la
nature humaine est spécifiée par le logos, et que c’est dans l’État que
deviennent objets de logos, c'est-à-dire de décision délibérée, « l’utile et le
nuisible, le juste et l’injuste, (...) le bien et le mal »5. À certains égards,
l’humanisme politique moderne n’a fait que rendre effective la conséquence
virtuelle de la fondation aristotélicienne de l’État, en étendant la qualité de
4 Voir : Aristote, Politique, III, 1.
5 Op.cit., I, 2, 1253a 14.

La politique La fin de l'Etat Michel Nodé-Langlois.doc
© Michel Nodé-Langlois – Philopsis 2007 3
citoyen à toutes les personnes, moyennant la seule fixation arbitraire d’un
âge de la majorité civile.
L’humanisme moderne a toutefois commencé par rompre avec l’af-
firmation que l’homme serait « politique par nature »6, du fait d’une
dissociation entre deux éléments qu’Aristote distinguait sans les opposer : le
naturel et le volontaire. Penser l’État comme lieu d’exercice des volontés
humaines, c’est pour Hobbes le penser comme réalité instituée (nomôi ou
théseï), plutôt que naturelle (phuseï). Il s’agit de donner de l’État une
explication qui soit de l’ordre de la motivation volontaire, et non pas de la
seule causalité naturelle. Or la volonté est le pouvoir de se déterminer en
fonction d’une fin que l’on se représente. Il s’agit donc de savoir à quelle fin
répond l’institution de la communauté politique, avec sa structuration
hiérarchique pour l’exercice du pouvoir ; et pour cela, il faut commencer par
faire abstraction de ce dont les individus bénéficient lorsqu'ils sont membres
d’une communauté politiquement organisée. Cette méthode de réflexion
conduit Hobbes à emprunter au théologien philosophe Suarez la définition
du concept moderne de l’état de nature, entendu par hypothèse comme état
d’indépendance naturelle dans lequel les rapports entre les individus ne sont
régis par aucune loi, ni contrôlés par aucun pouvoir. L’expérience montre ce
que sont les rapports entre les individus lorsqu’ils réussissent à se soustraire
à ces derniers. Hobbes en conclut que l’état naturel d’anarchie doit être une
« guerre de chacun contre chacun »7 : la communauté de nature ne saurait
selon lui fonder la coopération en vue d’un bien commun, puisque les
besoins naturels, communs à tous les hommes, mettent chacun d’eux en
concurrence avec les autres dans la poursuite des moyens de les satisfaire.
Or « il n’est personne qui ne désire vivre à l’abri de la crainte autant qu’il se
peut »8. C'est pourquoi « l’État est institué (...) pour libérer l’individu de la
crainte, pour qu’il vive autant que possible en sécurité, c'est-à-dire conserve,
aussi bien qu’il se pourra, sans dommage pour autrui, son droit naturel
d’exister et d’agir »9. Or cette institution suppose deux choses. Il faut d’une
part que la volonté vienne suppléer la nature pour remédier au caractère
invivable de celle-ci : c’est ce qu’opère le pacte social par lequel « l’individu
transfère à la société toute la puissance qui lui appartient, de façon qu’elle
soit seule à avoir sur toutes choses un droit souverain de nature, c'est-à-dire
une souveraineté de commandement »10. Mais d’un autre côté, la volonté n’a
à sa disposition que les moyens que lui procure la nature, laquelle met les
individus seulement dans un rapport de force et de menace réciproque. Dès
lors la logique du pacte social est que tous se soumettent à celui ou ceux qui
ont la capacité d’exercer une puissance coercitive suffisante pour empêcher
les agressions entre individus. C'est pourquoi Spinoza tirait la conséquence
logique du point de vue de Hobbes, en écrivant à Jarig Jelles : « je n’accorde
6 Ibid., 1253a 2.
7 Hobbes, Léviathan, ch. XIII.
8 Spinoza, Traité théologico-politique, ch. XVI, GF p.263.
9 Op.cit., ch. XX, GF p.329.
10 Op.cit., ch. XVI, GF p.266.

La politique La fin de l'Etat Michel Nodé-Langlois.doc
© Michel Nodé-Langlois – Philopsis 2007 4
dans une cité quelconque de droit au souverain que dans la mesure où, par la
puissance, il l’emporte sur eux ; c’est la continuation de l’état de nature »11.
La conception sécuritaire de l’État a ainsi pour conséquence que « le
souverain n’est tenu par aucune loi et que tous lui doivent obéissance pour
tout »12.
Rousseau a vu que par là se trouvait « réellement établi en principe »
un « droit du plus fort (...) pris ironiquement en apparence »13, qui lui
apparaissait comme une contradiction dans les termes, et ne pourrait de ce
fait aucunement constituer la motivation d’une institution et d’une
obéissance volontaires : car « céder à la force est un acte de nécessité, non de
volonté »14. Rousseau trouvait chez Hobbes et Spinoza une absurdité déjà
dénoncée par Aristote15, qui revient à fonder la légitimité de l’État en général
sur ce qui est le principe du plus arbitraire des régimes : la tyrannie. Or cette
contradiction provient en fait de ce que Hobbes a été infidèle à sa propre
méthode. Comme tous « les philosophes qui ont examiné les fondements de
la société », il a « senti la nécessité de remonter jusqu’à l’état de nature »,
mais il a commis la même faute qu’eux : « ils parlaient de l’homme sauvage,
et ils peignaient l’homme civil »16. L’état supposé d’indépendance naturelle
ne saurait suffire à mettre les hommes en concurrence, que seule la
comparaison mutuelle, résultant de la vie sociale, induit. Pour trouver une
nécessité à l’État civil à partir de l’état de nature, il faut admettre que celui-
ci est devenu invivable à la suite de transformations accidentelles qui ont
contraint les hommes à s’unir pour vaincre les résistances de la nature17. La
fin reconnue à l’État est alors plutôt économique que sécuritaire, la nécessité
de juguler les violences mutuelles ne devant apparaître qu’une fois que la
« société commencée »18 a produit les premières formes de corruption
culturelle de la nature humaine. Ce changement de finalité explique que
Rousseau substitue au pacte unilatéral de soumission de la théorie
hobbésienne, un contrat réciproque d’association, par lequel un peuple
s’institue en tant que peuple avant de pouvoir par là-même attribuer à
certains la charge d’exercer le pouvoir exécutif ou coercitif au sein de la
communauté, ce qu’Aristote appelait : les magistratures. Rousseau pense
ainsi accomplir l’effort de la pensée politique moderne pour fonder l’État sur
la liberté : il ne s’agit plus pour lui seulement que chacun puisse vivre libéré
de toute crainte, mais avant tout de concevoir que l’institution de la
communauté politique soit fondée sur la volonté individuelle, le
consentement personnel de ses membres. Alors seulement l’on peut parler
d’une communauté volontaire, organisée suivant une « volonté générale »
11 Id., Lettre L, GF p.283.
12 Spinoza, Traité théologico-politique, ch. XVI, GF p.266.
13 Rousseau, Du Contrat social, Livre I, ch. 3.
14 Ibid.
15 Voir : Aristote, Politique, III, 10.
16 Rousseau, Discours sur l'Inégalité, Introduction (in Œuvres complètes, éd. de la
Pléiade, t. III, p.132).
17 Voir : Id., Du Contrat social, Livre I, ch. 6.
18 Id., Discours sur l'Inégalité, 2ème partie, Pléiade p.170.

La politique La fin de l'Etat Michel Nodé-Langlois.doc
© Michel Nodé-Langlois – Philopsis 2007 5
qui subordonne « l’intérêt privé » à « l’intérêt commun »19. Cela signifie
qu’un État ne peut être conforme à sa fin qu’à reposer sur la souveraineté
populaire, ce qui implique une responsabilité du pouvoir institué devant ses
sujets, que niait le spinozisme. La formule rousseauiste du contrat n’en est
pas moins aussi totalitaire que ce dernier, puisqu’elle exige « l’aliénation
totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté »20.
C’est que, pour Rousseau, « l’ordre social est un droit sacré, qui sert de base
à tous les autres »21, en ce sens qu’aucun exercice de la liberté ne peut être
reconnu comme un droit si ce n’est par une sanction publique, qui
présuppose l’institution de l’État civil.
*
Rousseau n’ignorait pas ce que peut avoir de choquant ce renverse-
ment d’une liberté de principe en aliénation totale, et ceci d’autant plus qu’il
s’agit pour lui de démontrer que « la souveraineté est inaliénable », parce
que « le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté »22. Son
embarras est visible : car d’un côté, « on convient que tout ce que chacun
aliène par le pacte social de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c’est
seulement la partie de tout cela dont l’usage importe à la communauté » ;
mais d’un autre côté, « il faut convenir aussi que le Souverain seul » – c'est-
à-dire le peuple lui-même – « est juge de cette importance »23. La difficulté
est ici « de bien distinguer les droits respectifs des Citoyens et du
Souverain », c'est-à-dire de distinguer « les devoirs qu’ont à remplir les
premiers en qualité de sujets, du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité
d’hommes »24. Ce problème n’a rien d’une difficulté technique, car il est lié
en profondeur à la logique même du contractualisme moderne, que Rousseau
reprend à son compte. Si la relation de droit présuppose l’institution civile, et
que celle-ci n’est pas fondée sur la nature mais sur la convention, alors les
hommes n’ont pas d’autre droit que ceux que leur communauté leur accorde.
C’était clair chez Hobbes et Spinoza, pour qui le droit de l’État-Léviathan
n’a d’autres bornes que celles de sa puissance. Mais chez Rousseau, le
conventionnalisme aboutit à identifier la volonté générale avec l’opinion ma-
joritaire : « hors [le] contrat primitif, la voix du plus grand nombre oblige
toujours tous les autres ; c’est une suite du contrat même »25. Or on peut voir
dans la supériorité purement quantitative du nombre une autre forme de la
loi du plus fort, une fois de plus convertie en droit : « on demande comment
un homme peut être libre, et forcé de se conformer à des volontés qui ne sont
pas les siennes. Comment les opposants sont-ils libres et soumis à des lois
19 Id., Du Contrat social, Livre II, ch. 3.
20 Op.cit., Livre I, ch. 6.
21 Op.cit., Livre I, ch. 1.
22 Op.cit., Livre II, ch. 1.
23 Op.cit., Livre II, ch. 4.
24 Ibid.
25 Op.cit., Livre IV, ch. 2.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%