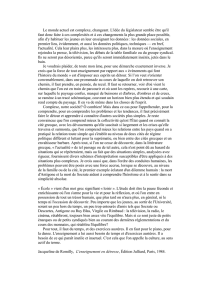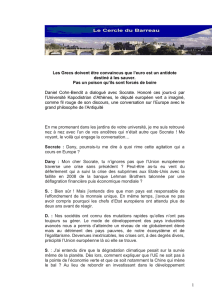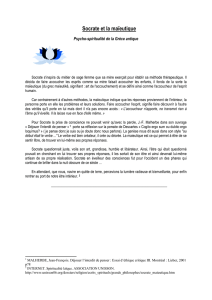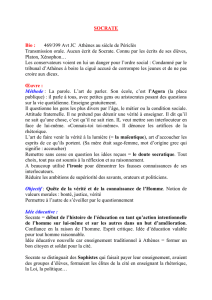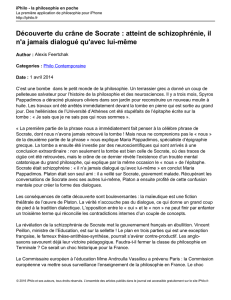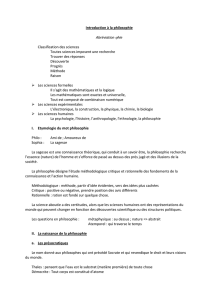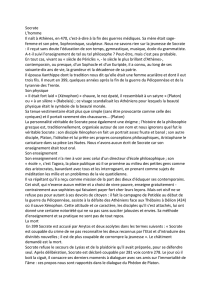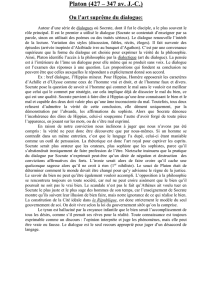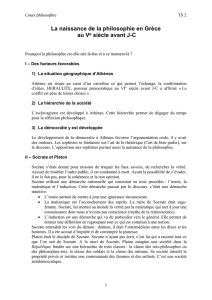Exposés M._ Fédou Inoï 2011

Michel Fédou, interventions données durant la session d’Inoï 2011
L’Esprit souffle…… : les VIe-Ve siècles avant J-C
(Inoï, 31 juillet 2011)
La période des VIIe-Ve siècles avant l’ère chrétienne fut marquée, en plusieurs lieux,
par des événements de grande portée spirituelle. Pour la Grèce, on pense avant tout à Socrate ;
mais quatre autres figures très marquantes peuvent être identifiées, à des dates assez proches
les unes des autres : Confucius, Gautama le Bouddha, Zarathustra, Jérémie.
Je voudrais réfléchir sur cette coïncidence et sur la portée que nous pouvons lui
reconnaître aujourd’hui. Je le ferai en quatre temps :
- Je partirai de la réflexion d’un philosophe du XXe siècle, Karl Jaspers, sur cette
époque majeure des VIe-Ve siècles ;
- Je dirai ensuite quelques mots des quatre grandes figures spirituelles que j’ai ici
retenues (sans parler de Socrate)
- Je réfléchirai en troisième lieu sur la question des liens entre les peuples
concernés : ces liens ont-ils existé, ou non ? qu’en a-t-il été, plus précisément, des
liens entre Grecs et Juifs ?
- Enfin je reviendrai sur la thèse de Karl Jaspers et j’apporterai quelques réflexions
conclusives.
I) La réflexion de Karl Jaspers sur « l’époque axiale »
Je partirai d’une réflexion de Karl Jaspers (psychâtre et philosophe allemand, 1883-
1969 ; il fut professeur de philosophie à l’Université de Heidelberg, mais, ayant épousé une
femme juive, il fut privé de chaire à l’avènement du nazisme ; il retrouva son poste après la
guerre). Depuis son ouvrage Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, (L’origine et le sens de
l’histoire) qui parut en 1949, il est devenu courant de parler de l’ « Achsenzeit », c’est-à-dire
de l’ « époque axiale » qui fut celle de la Chine de Confucius et de Laozi, de l’Inde de
Bouddha, de l’Iran de Zoroastre, de la Palestine des prophètes et de la Grèce des philosophes,
poètes tragiques et historiens. Selon Jaspers, 1) il y a eu une première grande étape (naissance
du langage, invention des outils, art d’allumer et d’utiliser le feu) ; 2) puis une deuxième

étape : entre 5000 et 3000 se formèrent les hautes civilisations de l’Egypte, de la
Mésopotamie et de l’Inde, et un peu plus tard de la Chine : « ce sont de petites îles de lumière
dans la large masse de l’humanité qui peuplait déjà toute la planète » ; 3) ensuite : « Autour de
500 avant Jésus-Christ – dans la période qui s’étend de 800 à 200 – furent posés les
fondements spirituels de l’humanité, ceux où elle puise encore aujourd’hui sa substance, et
cela simultanément et de façon indépendante, en Chine, aux Indes, en Perse, en Palestine, en
Grèce » ; 4) Depuis lors, il s’est produit un seul événement tout à fait nouveau : l’avènement
de l’âge scientifico-technique. Jaspers appelle la troisième période « la période axiale » : il y a
là, en effet, un axe de l’histoire qui ne vaut pas seulement pour les chrétiens mais pour tous
les hommes, un cadre commun permettant à chacun, en Occident comme en Asie, de mieux
comprendre sa situation historique :
« Appelons brièvement cette époque « la période axiale ». Il s’y passe simultanément
des choses extraordinaires. En Chine vivent Confucius et Lao-tsé, on voit naître toutes les
tendances de la philosophie chinoise… Aux Indes, on compose les Upanishads ; c’est le
temps de Bouddha… En Perse, Zarathoustra développe son âpre vision du monde où l’univers
apparaît déchiré par le combat du bien et du mal ; en Palestine se dressent les prophètes… En
Grèce, il y avait Homère, les philosophes, Parménide, Héraclite, Platon, les Tragiques,
Thucydide et Archimède. Tout ce que de tels noms ne peuvent qu’évoquer a grandi au cours
de ces quelques siècles, à peu près en même temps en Grèce, aux Indes et en Occident, sans
que ces hommes aient rien su les uns des autres.
La nouveauté de cette époque, c’est que partout l’homme prend conscience de l’être
dans sa totalité, de lui-même et de ses limites. Il fait l’expérience du monde redoutable et de
sa propre impuissance. Il pose des questions essentielles et décisives et, devant l’abîme
ouvert, il aspire à sa libération et à son salut. Tout en prenant conscience de ses limites, il se
propose les buts les plus élevés. Il rencontre l’absolu dans la profondeur du sujet conscient et
dans la clarté de la transcendance… »
(Voir H. Arendt, « Karl Jaspers. Citoyen du monde ? », dans Vies politiques, trad. de
Men in Dark Times, Gallimard, 1974, p. 102-103).
A. Momigliano perçoit là quelque chose de très vrai :
« Il y a quelque chose de profondément vrai dans cette façon de présenter les choses.
Toutes ces civilisations usent de l’écriture, possèdent des organisations complexes combinant
un gouvernement central avec des pouvoirs locaux, un organisme développé, une technologie
avancée des métaux et la pratique de la diplomatie internationale. Dans toutes ces

civilisations, il y une tension profonde entre les pouvoirs politiques et les mouvements
spirituels. Partout, on remarque des tentatives pour introduire plus de pureté, plus de justice,
plus de perfection et une explication plus universelle de l’ordre des choses. Des
représentations neuves de la réalité, conçues soit par la voie prophétique, soit par la voie
mystique ou rationnelle, sont proposées à titre de critique ou pour remplacer les modèles
dominants. Nous sommes à l’âge de la critique, et la critique sociale apparaît même à travers
l’imagerie compliquée des Gathas de Zoroastre. La personnalité des critiques doit
nécessairement apparaître : ce sont les maîtres dont les pensées comptent toujours aujourd’hui
et dont nous conservons les noms » (Sagesses barbares. Les limites de l’hellénisation, trad. de
l’anglais, Maspero, Paris, 1976, p. 20).
Il apparaît en tout cas que, dans cette période des VIIe-Ve siècles, des « événements
spirituels » se sont produits au sein de plusieurs traditions. On peut donc se demander, à la
lumière de la foi chrétienne, ce que chacun de ces événements a apporté. A-t-il fait avancer
l’humanité ? A-t-il même, par certains aspects, préparé la voie au christianisme ? A-t-il au
contraire engagé des humains qui ne seraient pas compatibles avec la Révélation chrétienne ?
II) Grandes figures de « l’époque axiale »
(Pour Socrate, voir l’exposé spécifique qui lui est consacré)
Confucius
Confucius (env. 551-479) vivait dans une période d’anarchie et d’injustice ; or il
comprit que la seule issue était une réforme radicale du gouvernement. Il eut de nombreux
disciples ; 250 ans après sa mort, les souverains de la Dynastie Han (env. 206 – 220 ap. J-C)
décidèrent de charger les confucéens de l’administration de l’Empire.
Au sens strict, Confucius n’est pas un chef religieux, et le confucianisme n’est pas une
religion, même si les religions de la Chine en ont été fort influencées. Mais la source de sa
réforme morale et politique est religieuse. Il ne rejette aucune des croyances traditionnelles
importantes : ni le tao, ni le dieu du Ciel, ni le culte des ancêtres ; il exalte et revalorise la
fonction religieuse des rites et coutumes.
Confucius déclare que l’on doit accomplir les sacrifices et les autres rituels
traditionnels ; le Ciel, en effet, aime recevoir des sacrifices. Mais le Ciel aime aussi une

conduite morale, et surtout un bon gouvernement. L’« homme supérieur » doit se préoccuper
d’abord de l’existence humaine concrète. Il s’agit pour l’homme d’opérer la « transmutation »
des gestes et conduites en rituels, tout en leur conservant leur spontanéité, cela dans une
société complexe et hautement hiérarchisée.
La plus haute satisfaction réside, pour chacun, dans le développement de ses propres
vertus. Mais la vraie carrière, pour un « gentilhomme », est de gouverner ; pour Confucius
(comme pour Platon), l’art de gouverner est le seul moyen d’assurer la paix et le bonheur du
plus grand nombre.
Gautama le Bouddha
La plupart admettent que Siddharta, le futur Bouddha est né en avril-mai 558 (ou en
567 environ), à Kapilavastu. Fils d’un petit roi, il se maria à 16 ans, quitta le palais à 29 ans,
connue le « suprême Eveil » en 523 (ou en 532 environ), et après avoir prêché tout le reste de
sa vie il s’éteignit en 478 (ou 487 environ), à l’âge de 80 ans. Une fois son identité
d’« Eveillé » reconnue par ses disciples, sa vie fut transfigurée : il y eut un processus de
« mythologisation » (qui commença de son vivant).
La tradition rapporte que, devenu à un certain moment ascète itinérant sous le nom de
Gautama, il fréquenta des maîtres brahmaniques, mais ne fut pas satisfait par leurs
enseignements ; suivi par cinq disciples, il se dirigea vers Gaya, s’établit dans un site paisible
où il se livra pendant six ans à de sévères mortifications. Il découvrit finalement les « quatre
nobles vérités » et finit par obtenir « l’Eveil » ; mais il n’entra pas tout de suite dans le
nirvana, car il lui fut révélé qu’un certain nombre d’êtres humains pouvaient être sauvés.
Les « quatre nobles vérités » sont : a) tout est souffrance ; b) l’origine de la souffrance
est dans le désir, l’appétit ou la soif qui provoquent les réincarnations ; c) la délivrance de la
douleur consiste dans l’abolition des appétits, elle équivaut au nirvana ; d) ce qui mène à la
cessation de la souffrance, c’est « l’octuple chemin ».
Zarathustra
Du côté de la Perse, nous rencontrons la religion mazdéenne, avec sa conception d’un
conflit entre le Bien et le Mal, son clergé (les « mages »), et ses différents rites. Or, vers les
VIIe-VIe siècles avant J-C, apparut dans cette tradition un homme qui devait être un prophète
réformateur de sa religion : Zarathustra.

Selon la tradition mazdéenne, on peut fixer sa vie entre 628 et 551 av. JC. On pense
qu’il a vécu dans l’est de l’Iran. Selon la tradition, il était prêtre sacrificateur. Il se fit le porte-
parole d’une révélation. L’essentiel de sa réforme, ce fut d’inviter à imiter le dieu suprême,
Ahura Mazda, qui est à l’origine de tout, et à qui appartiennent la toute-puissance, la bonté et
la sainteté ; il souligna que tout mazdéen devait lutter contre le mal et choisir le bien.
Il opérait un dépassement du « dualisme » hérité de sa tradition. Pour lui, Ahura
Mazda n’est pas confronté à un « anti-dieu » (il y a bien une opposition entre l’esprit du bien
et l’esprit du mal, mais l’un et l’autre ont été engendrés par Ahura Mazda, et c’est par choix,
non par nature, que l’un est resté bon et que l’autre est devenu mauvais). Et puisque les dieux
de la religion traditionnelle iranienne (les daevas) ont choisi le mal, Zarathustra demande à
ses fidèles de ne plus leur rendre culte. Il est convaincu qu’au terme les daevas seront anéantis
et que les justes l’emporteront sur les méchants. On trouve ici une représentation de l’histoire
orientée vers une fin, et la doctrine zoroastrienne fait place à la perspective d’une résurrection
des morts.
H. de Lubac a réfléchi sur la doctrine du mazdéisme, du fait de sa proximité apparente
avec le judaïsme sur un point capital : selon les Gâthâs, le monde va vers sa fin, il y aura un
jugement, les fidèles se préparent à ce jour et hâtent sa venue ; ils sont qualifiés à ce titre de
bienfaiteurs (saosyant), appellation qu’on peut comparer à celle de messie, et il y a un
Saosyant par excellence qui, à la fin, fera disparaître la Puissance mauvaise. Il y a là une
analogie évidente avec le messianisme juif.
Cependant, à l’origine de cela, il y avait un mythe iranien de l’embrasement du
monde ; c’est de ce mythe que Zoroastre s’est emparé, il en a fait le but de l’évolution du
monde et de la race humaine, et les traditions anciennes ont été peu à peu recouvertes comme
d’un vêtement par des préoccupations d’ordre « historique ». « En Israël, le processus est
inverse. C’est toujours l’homme et sa destinée qui font l’objet de la Bible, et tout s’y passe,
pour ainsi dire, entre deux personnages : Israël et Iahvé. Les rapports entre eux deux ne
découlent pas simplement de la nature des choses… A l’origine d’Israël il y a un fait
historique, une élection par Iahvé, suivie d’une alliance… Le point de départ de l’eschatologie
juive est pareillement la foi en Iahvé et en ses promesses. C’est l’attente du Jour où Il
manifestera toute sa puissance et sa fidélité. Ce n’est pas la prévision d’un phénomène
“naturel”, mais l’espoir – ou la crainte – d’un événement encore “historique”… » (H. de
Lubac, Catholicisme, p. 128-129).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
1
/
50
100%