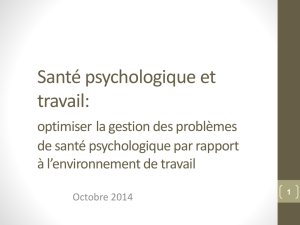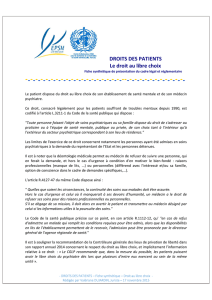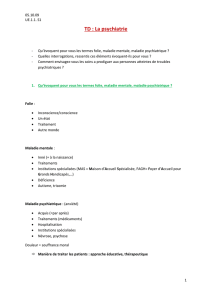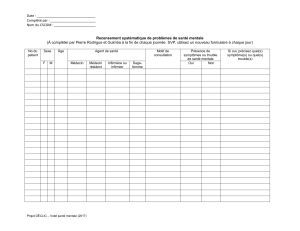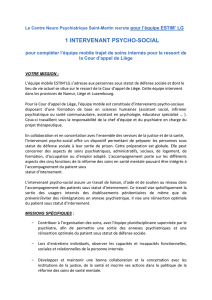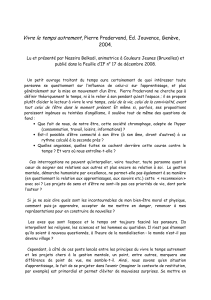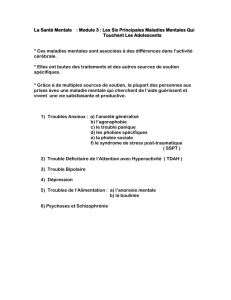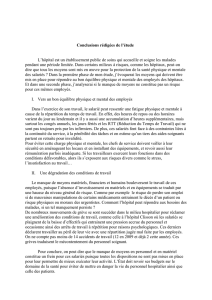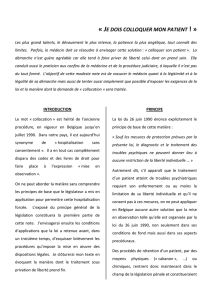Mental`idées n°17 - mars 2012 - Ligue Bruxelloise Francophone

«Malades Mentaux, Justice et
liberté. renverser l’entonnoir?»
Mental’idées
n° 17
L
igue
B
ruxelloise
F
rancophone pour la
S
anté
M
entale
53, Rue du Président - 1050 Bruxelles
Tél : 02/511 55 43
email : [email protected]
Editeur responsable : Eric Messens - Directeur
Site web : www.lbfsm.be
Service agréé par la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale
Belgique - België
P.P.
1050 Bruxelles 5
1/7371

é
dito...
2Mental’idées n°17
La publication du Mental’idées reprend après un temps d’interruption. Nous voulions d’une
part repenser sa forme et son contenu après seize numéros et sept années de publication.
D’autre part, nous devions remplacer notre collègue, Françoise Herrygers, partie pour d’autres
horizons après dix-huit ans de travail à la Ligue. C’est elle qui s’était depuis le début chargée
de la réalisation de la revue. Mental’idées est entièrement conçu en interne, tant sur le plan
graphique que rédactionnel. L’engagement récent de notre nouvelle collègue, Mirella Ghisu, a
permis de reprendre notre travail éditorial et de vous présenter ce numéro 17.
Vous constaterez que la nouvelle formule se concentre sur des contenus de fond. Toutes les annonces
d’évènements, d’activités, de formations, ou de publication se feront désormais sur notre site
www.lbfsm.be et via notre lettre d’information qui reprendra aussi très prochainement.
Ce numéro est essentiellement consacré à la diffusion des actes du colloque organisé aux
Facultés Universitaires Saint-Louis en septembre 2010 « Malades mentaux, Justice et Liberté ».
Vous aurez également l’occasion d’y lire le texte rédigé par la Fédération des Services de Santé
Mentale Bruxellois (FSSMB) dans le cadre de la Réforme des soins en santé mentale.
Toute l’équipe de la Ligue vous souhaite une bonne lecture et vous invite à lui faire parvenir vos
textes sur des questions cliniques, institutionnelles, ou politiques. Le numéro 18 de Mental’idées
sortira au mois de mai et sera entièrement dédié à vos contributions écrites.
Eric Messens
Edito __________________________________________________ 2
Eric Messens
La minute Philo _________________________________________ 4
Mirella Ghisu
«MALADES MENTAUX, JUSTICE ET LIBERTÉS, RENVERSER
L’ENTONNOIR?»
En guise d’introduction ____________________________________ 5
Mise en perspective historique de la prise en charge
judiciaire des malades mentaux ____________________________ 6
Michel Van de KERCHOVE
La décision sur l’irresponsabilité pénale et l’internement en défense sociale
Juges et psychiatres : je t’aime moi non plus… _________________ 11
Yves Cartuyvels
L’expertise psychiatrique dans le
champ du savoir judiciaire __________________________________ 13
Dr. Jean-Paul Beine
Sur la nef de l’instruction : l’inculpé, son juge
et son expert-psy _________________________________________ 16
Marie-Geneviève TASSIN

L’expertise et ses faiblesses ________________________________ 20
Marc Nève
La décision sur la mise en observation et le maintien en observation au civil
La mise en observation et son maintien : état des lieux ___________ 22
Thierry Marchandise
La mise en observation et son maintien :
la procédure d’urgence à Bruxelles ___________________________ 24
Véronique Sevens
La mise en œuvre pratique de la loi du 26 juin 1990 et la question des
délais:difcultésconcrètes ________________________________ 25
François-Joseph Warlet
Le travail d’expertise de la procédure de mise en observation :
un instantané ? __________________________________________ 28
Gérald Deschietere
La mise en observation et son maintien: le soin, entre milieu fermé et
ambulatoire
Soigner les malades mentaux : quelques enjeux concrets ________ 31
Dr Edith Stillemans
L’éthique du soin à Saint-Bernard, entre paternalisme bienveillant et
autonomie du patient _____________________________________ 36
Sébastien Jacmin et Jean-Louis Feys
De la mesure de maintien de l’hospitalisation contrainte à la postcure 38
Dr François Georges
« Les droits du patient à l’épreuve de l’hospitalisation contrainte » __ 42
Marie-Françoise Meurisse
L’internement en défense sociale: entre soin et sécurité
Internement et soin : quelques questions de départ ______________ 45
Anne Wyvekens
L’internement en défense sociale ____________________________ 48
Patrick Leblanc
Spécicitéd’unepratiquecliniqueenmilieucarcéral _____________ 51
Monique Lefebvre
L’internement en Défense Sociale : entre soins et sécurité ________ 55
Geoffroy Huez
L’administration provisoire des biens des malades mentaux
L’administration provisoire et son contrôle : propos introductifs ____ 56
Frédéric Ureel
L’administration provisoire :
point de vue d’un avocat et d’un administrateur _________________ 61
Isabelle de Viron et Frédéric Ureel
L’administration provisoire des biens:
« Mesure à prendre avec Mesure » __________________________ 62
Corinne Josson
Administration provisoire, malades mentaux et internés : de la théorie à la
pratique ________________________________________________ 64
Damien Chevalier
La libération de l’interné
La libération de l’interné : remarques introductives ______________ 66
Brice Champetier et Yves Cartuyvels
Libérer... pour réintégrer __________________________________ 67
Annie Philippart
La libération de l’interné ___________________________________ 70
Jean-Christophe Van den Steen
Conclusions ____________________________________________ 74
Dan Kaminski
Bibliographie Psycendoc sur la Justice et la Santé Mentale _______ 81
LES SERVICES DE SANTE MENTALE BRUXELLOIS FRANCOPHONES
ET LA REFORME DES SOINS EN SANTE MENTALE ____________ 83

4Mental’idées n°17
Folie, maladie mentale, souffrance mentale, décience men-
tale… autant de concepts qui demandent des éclaircisse-
ments. Nietzsche a passé les dix dernières années de sa vie
enfermédanssafolie.Al’heureoùseslivrestrouvaientennune
reconnaissance, où des étudiants étaient désireux de le rencon-
trer, notre philosophe, lui ne se rendait plus compte de rien. Cette
folie s’est-elle installée petit à petit ? A- t’-elle été foudroyante ?
Aurait-on avec les moyens de l’époque pu, la prévenir, la guérir ?
Une rencontre hypothétique avec le Dr Freud aurait-elle changé
le cours de son existence ?
Nous ne pouvons hélas répondre à ces questions, peut-être pou-
vons-nous émettre quelques suppositions, des éléments de ré-
ponses ? Mais Nietzsche n’est plus. Aujourd’hui, en effet nous
admirons l’œuvre remarquable d’un philosophe peu commun, d’un
génie, d’un fou.
C’est à Turin en 1889 que Nietzsche bascule dans la folie qui va
empêcher « l’éternel retour » pris d’hallucinations, il se prenait
tour à tour pour Dyonisos, Voltaire, Napoléon et tant d’autres, les
siècles se confondaient dès lors dans son esprit. Pensant se rendre
à Jérusalem, il se retrouve dans une clinique psychiatrique à Bâle.
Un an plus tard, sa mère le ramène à Naumburg, on commençait
alors à le lire dans toute l’Europe, lui à qui son éditeur ne faisait pas
conance, lui qui donnait cours dans un auditoire vide, et ironie du
sort, son génie était enn reconnu sans que Nietzsche puisse en
être conscient. Sa mère s’éteint en 1897, elle n’avait cessé de s’oc-
cuper de lui pendant ces nombreuses années d’enferment dans sa
folie, enfermement qu’elle partagea. Il sera dès lors sous la coupe
d’une sœur avide et perde qui deviendra plus tard l’amie d’Adolph
Hitler. L’appât du gain et son idéologie personnelle l’amèneront à
pervertir l’œuvre de son frère. Le 25 août 1900, Nieztsche s’éteint
toujours sans conscience, il sera trahi une nouvelle fois « promets
moi que si je meurs, il n’y aura autour de mon cercueil que des amis pas
de curieux et qu’on m’enterre sans mensonge en honnête païen que je
suis – 1879 » .
Je ne sais pas si Nietzsche était prédisposé à la folie, ni même si sa
conscience était altérée lorsqu’il rédigea ses nombreux ouvrages.
Ai-je lu l’œuvre d’un homme encore sain d’esprit ou celle d’un fou.
Peu m’importe, du moins la folie n’empêche pas le génie, et le génie
se trouve peut-être dans une dose de folie.
« Ce n’est pas le doute, mais la certitude qui nous rend fou »
Friedrich Nietzsche
Mirella Ghisu
La minute philo

PUBLICATION DES ACTES DU COLLOQUE ORGANISÉ PAR:
LE SYNDICAT DES AVOCATS POUR LA DÉMOCRATIE SAD
L’INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINARITÉ ET SOCIÉTÉ DES FUSL (IRSI)
LE CENTRE DE RECHERCHES CRIMINOLOGIQUES DE L’ULB (CRC)
AVEC LA COLLABORATION DE LA LIGUE BRUXELLOISE FRANCOPHONE POUR LA SANTÉ
MENTALE (LBFSM)) ET DE LA PLATE-FORME DE CONCERTATION POUR LA SANTÉ MENTALE
EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE (PFCSM-BRUXELLES)
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE:
YVES CARTUYVELS, PROFESSEUR AUX FUSL
ISABELLE de VIRON, MEMBRE DU SAD
«Malades Mentaux, Justice et libertés,
renverser l’entonnoir?»
5
Mental’idées n°17
En guise d’introduction
Depuis le XIXe siècle, les « aliénés ordinaires » comme
les « aliénés criminels » ont fait l’objet d’une politique
de mise à l’écart et d’enfermement au nom de leur vulnéra-
bilité mentale et de leur dangerosité sociale. Unis dans un
même dispositif de prise en charge au départ, les malades
mentaux ont progressivement fait l’objet de régimes dis-
tincts : selon qu’ils ont commis une infraction pénale ou
non, les malades mentaux se confrontent soit à la justice
pénale (et à un dispositif d’internement), soit à la justice
civile (et à un dispositif de mise en observation). Dans les
deux cas, il s’agit le plus souvent de les priver de liberté
au nom de la sécurité publique et de les contraindre à se
soigner.
Quels sont les points de convergence et de divergence entre
lesdeuxlières,civileetpénale,danslapriseenchargedes
malades mentaux, qui sont bien souvent aussi des margi-
naux sociaux ? Comment se prend, au civil et au pénal, la
décision d’orienter une personne « atteinte de déséquilibre
mental » vers une trajectoire d’enfermement ? A quelles
réalités correspondent les pratiques d’enfermement, en
défense sociale d’une part, en régime de mise en observa-
tion de l’autre ? Comment, dans les deux cas, aborde-t-on
la privation de liberté et la contrainte des soins, le respect
des droits du patient et la gestion de ses biens durant le
séjoureninstitution?Quelsortennestréservéàlalibé-
ration de ceux qui, en principe, sont destinés à se réinsérer
dans la société après un parcours à vocation curative ?
Pour aborder ces questions, le colloque « Malades men-
taux, Justice et libertés », organisé par Le Syndicat des
Avocats pour la Démocratie (SAD), l’Institut de Recherches
Interdisciplinarité et Société des Facultés universitaires
Saint-Louis (IRSI) et le Centre de Recherches Criminolo-
giques de l’ULB (CRC), avec la collaboration de la Ligue
Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM)
et de la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Men-
tale en Région de Bruxelles-Capitale (PFCSM-Bxl) a fait
le choix d’une réexion transversale et interdisciplinaire.
Pour chaque question, place a été faite à des regards pro-
fessionnels multiples, portant sur les pratiques médicales
et judiciaires relatives aux malades mentaux. A partir d’un
exposé introductif, la parole fût donnée aux acteurs de ter-
rain pour éclairer, à partir de leur point ce vue, la réalité
des pratiques vécues, les ambiguïtés et les contradictions
d’undoublerégimequisesitueaucroisementdeladifcile
articulation entre sécurité et libertés.
C’est du contenu de ces deux journées que ce numéro se
fait l’écho. On y trouvera l’ensemble des interventions ré-
parties selon les différents thèmes abordés, telles qu’elles
se sont succédées les 17 et 18 septembre 2010 aux Facul-
tés Universitaires Saint-Louis. La Ligue Bruxelloise Fran-
cophone pour la Santé Mentale est heureuse de prêter
icisacollaborationàladiffusiondesréexionsricheset
variées sur une thématique qui reste trop mal connue.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
1
/
100
100%