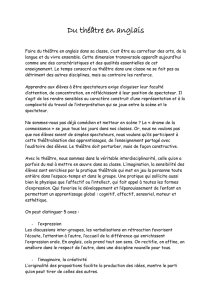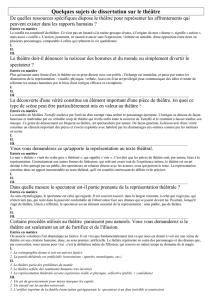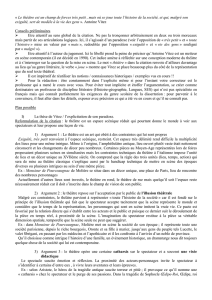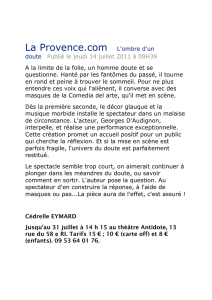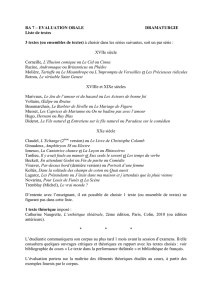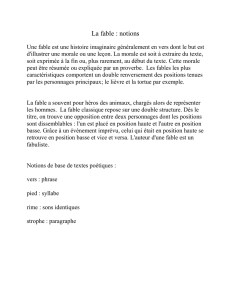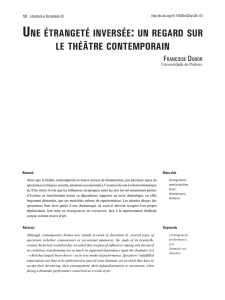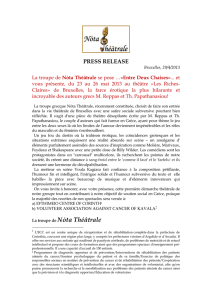la métaphore théâtrale - Savoirs, Textes, Langage

L’infigurable
[Article publié au printemps 1993 dans le n 1 de La Métaphore (revue), dir. Daniel Mesguich et André
Guittier, Editions de la Différence]
La (Métaphore) procède, de temps à autre, à d’étranges mises en scène où
les acteurs cèdent obligeamment leur place aux critiques, aux dramaturges et parfois
même aux philosophes. Redoutable exercice que cette théâtralisation de la parole où le
philosophe, assistant à la mise en scène de son propre discours, apprend qu’on ne
quitte pas impunément la place du spectateur.
A quoi, concernant le théâtre, une pensée philosophique pourrait-elle bien
donner accès et passage, sans de nouveau se prendre aux pièges de la représentation ?
Des hommes de théâtre écrivent. Des philosophes tiennent momentanément la scène.
Rien de tout cela n’abolit, bien sûr, l’écart du discours et de la représentation. Ecart
qu’il eût fallu creuser et que tout concourait à réduire.
Saisissant la chance qui nous est offerte d’en reprendre l’essai après coup,
nous continuerons malgré tout de donner à ce propos une dimension de théâtre. Que
l’on sache donc que ce qui suit est un faux. Répétition décalée d’un discours qui ne fut
pas tenu, qui s’amuse à rejouer la scène où il se savait par avance en défaut.
Il nous semble évident que le théâtre est d’abord lieu de regard. Un lieu où
l’on vient voir. Tout le vocabulaire à travers lequel nous tendons spontanément à
décrire la machine théâtrale la désigne comme un grand appareil de visibilité. Mettre en
scène, c’est donner à voir, c’est mettre en tableaux. Aussi vient-on au théâtre comme on
va au spectacle. Son principal ressort et son essentiel mystère résideraient dans cette
entière captation du regard.
On retrouve ce privilège du regard et du voir dans la plupart des
métaphorisations auxquelles donne lieu le théâtre, lorsqu’il sert à dire ce qui n’est pas
lui. Le monde, c’est bien connu, est une scène, entendons : une manière de décor.
Toutes métaphores qui privilégient le paraître – jusque dans la variante du trompe l’oeil
– comme si le théâtre n’était qu’artifice destiné à prendre le regard au piège des
apparences, lui offrant de jouir d’un effet de leurre ou d’une échappée vers le
merveilleux.
Il semble donc légitime qu’une esthétique théâtralement conséquente fasse
droit à cette prérogative du regard et que, dans le travail croisé de la fiction et de la
démystification, elle ne fasse jamais qu’ordonner les leurres à travers lesquels le sujet
regardant se sait et se découvre à son tour vu et voyant. Car la vision n’est pas
nécessairement captation : quelque chose est au travail dans tout regard, et c’est aussi
ce travail que le théâtre donne à voir. En quoi le théâtre est jeu : jeu de regards ; jeu

avec le regard. Consonnant avec la peinture, il organise l’illusion de la profondeur. On
sait qu’il en invente concurremment la perspective : le théâtre est une fenêtre.
La distance qu’introduit le théâtre à l’intérieur même du regard se
développerait donc selon une topologie baroque. Le théâtre proposerait des images
douées de profondeur. Il contribuerait à donner au tableau cet effet de spirale qui n’est
que la forme développée d’un effet de miroir, le situant dans une sorte de réflexivité
perspective, de retour sur soi de la profondeur, comme l’enroulement sur soi-même
d’un regard intré par sa propre mise en scène. Dans cette invention d’une réflexivité
proprement théâtrale, le regard instruit retrouverait le regard de l’enfant, du même
mouvement où le spectacle déploie sa profondeur.
C’est dans ce doublement du regard lui-même que nous voulons, nous,
modernes, loger à son tour l’œil critique. Mais puisqu’il est question de théâtre et de
philosophie 1, il convient d’interroger à son tour la scène de nos discours. Il est
troublant de constater que la plupart des pensées qui s’efforcent de fictionner
philosophiquement le théâtre commencent par amplifier le thème de son essentielle
visibilité. Certes, on y traque l’invisible au cœur du visible, l’irreprésentable qui habite
et qui hante toute représentation. On sait que donner à voir, ce n’est pas seulement
montrer, que c’est aussi cacher. Que cette occultation, ce jeu de cache ruinent déjà le
privilège du vu, ouvrent le chemin qui mène du non vu à l’insu. Que le théâtre est donc
toujours plus qu’art de montrer : tout autant art de taire. Manière de savoir mais aussi
d’ignorer. Mais dans ce doublement du voir et du ne pas voir, c’est le dispositif
optique de la scène qui demeure au foyer. Simplement, nous savons – nous qui sommes
devenus si savants – que mettre en scène, c’est tout à la fois mettre au jour et ouvrir sur
les profondeurs de la nuit. Que mettre en scène, c’est déployer un discours et machiner
quelque secret. Que mettre en scène, c’est faire croire au spectateur qu’il en sait long et
lui montrer que cette reconnaissance est simultanément forclusion. « La nuit, le secret,
le forclos » : dans la série même des termes qui se proposent à notre jugement, se
vérifie le doublement du voir par le savoir, et du vu par le su ou par l’insu. Il s’agirait
avant tout, au théâtre, d’exhiber ce que l’on ne veut pas voir, ce dont le sujet regardant,
pris au leurre de la scène, ne veut d’ordinaire rien savoir. Irruption de l’obscène 2 dans
les mirages de la profondeur. On sort donc difficilement d’une dialectique du vu et du
non vu, du visible et de l’invisible, de la représentation et de l’irreprésentable.
Cette conjonction entre un discours critique et une esthétique n’est pas de
pur hasard. Elle tient à ce que le philosophe abandonne difficilement la place du
spectateur et que le dramaturge lui-même machine le théâtre, sinon du point de vue, au
moins en fonction du spectateur. Nous manquons assurément de philosophes
dramaturges mais plus encore : de philosophes acteurs. C’est pourquoi nous continuons
de penser le théâtre comme la peinture : dans le champ de la représentation, comme
déroulement d’une scène pour un regard. Certes, le philosophe n’est pas un spectateur
ordinaire : il s’y entend à voir, qu’il traque la part obscure, l’énigme, le refoulé, ou qu’il
interroge le dispositif de la scène, les conventions d’écriture qui sont celles du théâtre et
que celui-ci, d’ordinaire, ne montre pas. Jusqu’à céder parfois à cette tentation
pathétique de chercher à voir les conditions mêmes de la visibilité.
1 Rappelons que l’après-midi, organisée par (La Métaphore), où des bribes de cette analyse furent
esquissées, s’intitulait : « Théâtre et philosophie ». Avec pour sous-titre : « L’irreprésentable ? Le secret,
la nuit, le forclos ».
2 Cf. l’étymologie du mot : littéralement, ce qui est « sur le devant de la scène », « devant les yeux », bref
ce qui crève les yeux, qu’on ne peut pas ne pas voir. Notons que, pensé non plus dans l’espace mais dans
le temps, obscenus signifie : « de mauvais augure ».

Etrange rencontre d’un discours critique et d’une esthétique de la scène
dans le partage d’une mise en abîme qui reconduit – à travers le privilège non pas
ininterrogé mais suranalysé du regard – une métaphysique de la profondeur. Le théâtre
est ce lieu de la représentation où s’abîme le texte, où ce qui est narratif se découvre
une deuxième scène, tandis que la métaphore se figure elle-même sur le mode de la
mise en abîme, ou comme anamorphose. Qu’il y ait là le principe d’une possible
esthétique, assurément. Mais qu’il faille y voir l’essence même du théâtre, je veux dire
ce qui en épouse ou en épuise par avance toutes les virtualités, c’est moins sûr. Le
théâtre ne saurait égaler ses pensées – mêmes réflexives – à ses virtualités. Et la
nécessité du geste critique est tout entière dans cet écart.
D’où, aujourd’hui, notre question : comment inscrire la critique théâtrale
ailleurs que dans une analytique du regard et/ou de la représentation ?
On ne saurait sous-estimer ce que la réponse à une telle question implique
de déplacements, voire de torsions. Déplacements : peut-être faudrait-il commencer par
véritablement prendre pied sur la scène 3 pour penser le théâtre non plus du point de
vue du regard – ni du point de vue de l’effet – mais bien du point de vue de l’acteur.
Seul l’acteur peut déconcerter la connivence du metteur en scène, du spectateur et du
critique. Lui seul sait que le théâtre ne saurait céder à l’illusion qu’il peut se clore
entièrement sur lui-même, qu’il est une scène à soi seul. Car l’acteur sait que le théâtre
commence avec la mort de la représentation. Quant au critique ? A défaut d’être acteur,
au moins peut-il faire un premier pas ... et se tenir dans la coulisse. Puisque le critique,
fût-il philosophe, ne saurait à son tour céder à l’illusion de croire que, de la chose
théâtrale, il peut prendre une vue totalisante ou intégrale. Il ne s’agit pas tant de penser
le théâtre – comme un objet ou une scène dont ou pourrait faire le tour, appréhender la
face cachée ou même déceler ce qu’elle cache – que de le prendre de biais, d’avoir pour
lui une pensée oblique.
*
C’est connu, tout discours renvoie à une autre scène. Ce qu’on sait moins,
c’est que cette autre scène n’est pas une scène et qu’aucune pensée et aucune esthétique
ne peut prétendre la faire venir sous le regard. C’est dans cette impossibilité, cet
irréversible écart que travaille le théâtre, même à son insu. Aussi faut-il commencer par
suspecter toutes les métaphores de la mise en abîme, de l’enroulement du regard
(regardant et regardé), de la scène dans la scène. Suspicion qu’il faudrait diriger dès
l’abord sur l’étrange parenthésage où semble s’inscrire toute métaphore. Le procès de
métaphorisation se donne à première vue comme un doublement, comme le jeu illimité
d’un renvoi et d’une inclusion : toute scène est prise dans une autre scène, que l’on
pourrait parenthéser à son tour, à l’infini. A l’inverse, il suffirait de lever la parenthèse
pour dé-celer ce que la scène cache, ce point d’obscurcissement où elle referme sur
elle-même sa propre visibilité. Certes une subversion est constamment possible de ce
jeu de cache par l’exhibition même de ce qu’il cache et l’expérience faite, sur cette
exhibition elle-même, que le jeu du signifiant, de fait, se joue ailleurs. Mais déjà cette
expérience indique un autre régime de la signification : il ne s’agirait pas tant, pour le
théâtre, de produire des échappées sur ce qui demeure proprement invisible – la part
obscure, ce qui est simultanément montré et tu – que d’ouvrir sur une autre façon de
3 Mettre le philosophe sur la scène et l’obliger à dialoguer avec les autres dramaturgiquement, telle est la
tentative aujourd’hui encore exemplaire de Brecht dans L’Achat du cuivre.

penser le renvoi, comme différence et non plus comme inclusion. Toute scène est un
morceau d’une scène qui ne renvoie pas tant à une part obscure qu’à une part
manquante.
Le théâtre, sauf à se vouloir pur jeu de miroirs ou à s’installer dans une
esthétique de l’effet, ne peut donc déployer sa mimesis selon la seule optique de la mise
en abîme. Art du redoublement, il est tout autant art du suspens et de l’ellipse. La
métaphore y est toujours doublée, travaillée par une métonymie. C’est dire que la scène
théâtrale ne saurait être lue dans la seule mise en perspective qui lui assigne une
profondeur. Or c’est dans cette lecture de la scène « en profondeur » – selon un axe
perpendiculaire au tableau – que se joue la connivence entre le spectateur, le critique et
le metteur en scène, dans une triple souveraineté du regard. On peut dédoubler,
enrouler, leurrer ce regard, lui apprendre qu’il n’est jamais dupe, le faire jouir d’un
plus-de-voir et du plaisir de n’être pas dupe de cette jouissance, on ne sort pas d’une
appréhension spectaculaire de la chose théâtrale, d’une captation par la scène. Il nous
faut donc d’abord interroger ce qu’occulte une telle captation.
La profondeur au théâtre ne masque pas l’envers du décor (nul spectateur
n’est dupe de la machinerie qu’implique la machination visuelle de la fiction). Pas plus
qu’elle ne masque les dessous de la scène (dessous dont on s’entend à faire sortir à
l’occasion toutes sortes de personnages). Ce que la profondeur occulte en revanche, ce
sont les coulisses, les à côtés. Absorbé par la profondeur, croyant que le spectacle est
une surface qu’il suffirait de redoubler, de replier ou de creuser, pris dans cette étrange
topologie, le spectateur comme le critique finissent par oublier que si le théâtre est une
fenêtre, c’est une fenêtre ouverte simultanément sur l’espace et sur le temps. Qu’un
acteur traverse la scène de part en part et voici que se figure un temps sans
profondeur 4, une autre façon d’informer l’espace à partir du mouvement. Or la règle du
temps, c’est la métonymie, cette façon qu’a la partie de renvoyer à sa part manquante,
de différer. Si le théâtre est fiction, ce n’est pas uniquement parce qu’il met en scène,
ou parce qu’il met une intrigue en tableaux. Le théâtre est fiction pour cette autre raison
que tout n’y est pas dit, que tout n’y a pas lieu, que des temps sont supposés que le
spectacle laisse hors de son champ : on a beau élargir l’écran, jamais on n’y intègre les
coulisses, ce qui s’est machiné avant et qui se dénouera plus tard. Ce non dit n’est pas
de refoulement mais d’ellipse. Le sens absent ne se localise pas dans quelque
profondeur, il n’est pas caché : il est la pièce manquante du discours, celle que le
spectateur doit éventuellement suppléer, d’un autre imaginaire que celui que courtise et
que comble le spectacle. Il est significatif que la (métaphore) se figure entre des
parenthèses qui l’enclosent. Le style de parenthésage qu’appellerait la )métonymie( est
moins aisément figurable. On n’y dirait pas l’inclusion mais l’élision. C’est dans la
substitution de cet art d’ellipse à une topologie de la profondeur que peut se figurer
véritablement l’autre scène, qui n’est pas tant « scène dans la scène » (selon une
logique de l’anamnèse entendue comme dé-cèlement) que suspens, différer – qui seul
peuvent faire entendre ce qui manque. Où le théâtre se déploierait figurativement
comme un art d’écoute. Inversement, penser la métaphore sans la métonymie, c’est
revenir du langage vers l’image. Comme si l’image ne tirait son pouvoir de captation
que d’une étrange défaite de langage et que, pour contourner ce leurre et cette défaite, il
suffît d’exhiber l’insu. Or la mise en scène est mise en œuvre, d’un œuvrer qui n’est
jamais pur spectacle : quelque chose en lui excède le jeu du vu et de l’insu. Tout théâtre
porte en soi, même lorsqu’il la raréfie jusqu’à la rendre imperceptible, une dimension
de fable (l’autre côté de la fiction). Or la fable, au théâtre, n’est pas faite seulement
4 Il y aurait beaucoup à dire sur cette latéralisation du spectacle où l’exploration de l’espace ne cherche
plus à mimer la profondeur et propose une polytopie non imaginaire ou, si l’on veut, ordonnée à un tout
autre imaginaire. En ayant en vue ce que le théâtre pourrait emprunter aujourd’hui à la danse.

pour être vue mais pour être lue. Le vu, le su et le lu, troisième terme qui fait du théâtre
un art de déchiffrement. Car le théâtre parle, même lorsque rien ne s’y dit. Toute
monstration au théâtre (c’est le fondement même de la mimesis) décolle le représentant
du représenté, libère le signifiant – même non verbal – pour une autre écoute. On va au
théâtre pour entendre.
Que faut-il réintroduire dans le théâtre pour faire droit à ses deux
dimensions ? Le texte d’abord, en tant qu’il est support de la fable. L’acteur ensuite, en
tant que sa présence, sa parole, son corps démentent sans cesse la spécularité du
spectacle. Mais il faut penser surtout un autre régime de métaphorisation. La mimesis
théâtrale est une mimesis de fable et non de tableau. Elle est fondamentalement non
représentative. C’est ce que disait déjà Aristote, et que l’histoire occidentale du théâtre
n’aura cessé de méconnaître. Mais avant de nous ouvrir à cette pensée non
représentative de la mimesis, il faut achever de nous convaincre que cette non
représentativité n’est ni exclusivement, ni essentiellement celle qui naît de la
conjonction de ces trois signifiants : « la nuit », « le secret », « le forclos ».
Le théâtre, nous avons essayé de le montrer, ne s’éclaire pas de sa seule face
nocturne. Reste à dire un mot du secret et du forclos. Du secret, peu de chose à dire en
vérité, sinon qu’il ne se confond pas nécessairement avec le caché. On connaît l’étrange
affirmation d’Henri James : « Le secret du secret, c’est qu’il n’y a pas de secret ».
Dissocier le secret du mystère, c’est le ramener vers l’énigme, le lester de cette
dimension d’écriture que toute théâtralité s’incorpore et qui vient doubler le mystère.
Le secret, dans notre langue, renvoie à une double étymologie. Par le biais du neutre
secretum, il désigne la chose cachée, que seuls quelques initiés ont en partage, chose
qu’on peut s’approprier ou dont on sait, inversement, que l’on ne pourra jamais la
détenir. Mais l’adjectif secretus signifie plus primitivement « séparé », « à part », « à
l’écart », tous mots où se pense un retrait sans exclusion. Deux formes de manque,
donc : selon que l’on fantasme l’objet manquant ou que l’on va jusqu’à ignorer même
ce qui fait défaut.
Quant à la forclusion ? Mot étrange en vérité et dont la récente fortune ne
dissipe en rien l’effet d’énigme. Ce mot, dont chacun sait qu’il fut mis en circulation
par la critique analytique, apparaît aujourd’hui comme un signifiant flottant, désignant
un de ces sens en plus que personne ne sait trop définir et qui n’en seraient pas moins
requis pour penser. Qu’est-ce donc qui est en jeu, au théâtre, vers quoi la forclusion
ferait signe sans parvenir à le désigner ? Méfions nous d’abord des simplifications qui
ramènent insidieusement la forclusion vers la clôture et le refoulement. C’est cette
forclusion là qui serait levée par l’obscène ou fabulée dans le mystère. En vérité, la
forclusion n’est ni le refoulement, ni la dénégation. Plus proche du déni, elle désigne ce
bord, ce revers du geste ou de la parole par quoi, nouant une alliance, on délimite du
même coup une extériorité. De quel type d’extériorité le « for » de forclusion est-il
l’indice 5 ? Le forclos est ce bord infigurable de la limite. Non pas ce qui est enclos
mais ce qui, par cette clôture même, se trouve annulé : forme de déni du réel. Le forclos
est donc à proprement parler l’infigurable, puisque toute figure est de contours. Le
risque est de le confondre avec l’énigme, cette forme de l’altérité qui peut encore
5 L’origine de ce « for » – mimant le ver de la Verwerfung – est, paraît-il allemande : de fer, fir, qui
donneront ver : barrer, empêcher, cacher mais aussi fort : parti, absent. Mais le préfixe nous est parvenu
via l’attraction du latin foris, d’où nous viennent aussi forlignage, forfaiture et, pourquoi pas, forban – de
for-bannir. Or foris, c’est encore le dehors, voire cet « étranger » où l’on sait que, pour certain roi, tout
fut perdu ... for l’honneur.
Quant à la Verwerfung , traduite ainsi par Lacan, elle désigne – il n’est pas inutile de la rappeler – le
retour de fragments détachés du réel sous une forme hallucinatoire, effet différé d’un processus
d’« abolition symbolique» où ce qui a été aboli à l’intérieur revient de l’extérieur (Vocabulaire de la
psychanalyse, Laplanche et Pontalis).
 6
6
 7
7
1
/
7
100%