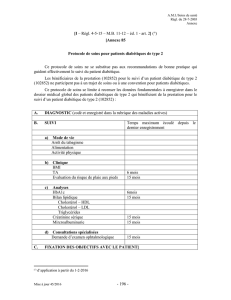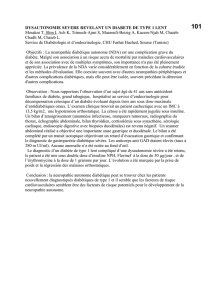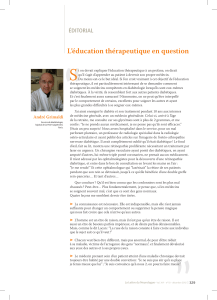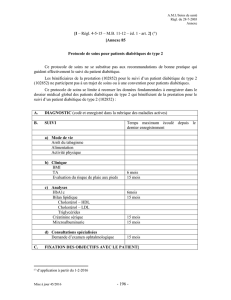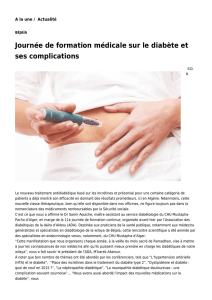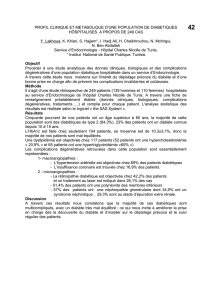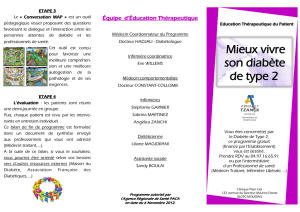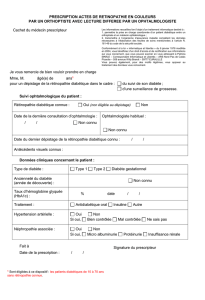XI - MACROANGIOPATHIE

XI - MACROANGIOPATHIE
La macroangiopathie est définie comme l'atteinte des artères de moyen et gros calibre. Elle
regroupe les atteintes des artères coronaires, des artères à destinée cervicale et des artères des
membres inférieurs. Elle représente la principale cause de mortalité dans le diabète, qu'il s'agisse
du diabète de type 1 ou 2. L’athérosclérose est beaucoup plus fréquente et sévère chez le
diabétique que dans la population générale. Les lésions touchent non seulement les gros troncs,
mais aussi, et ceci est particulier au diabète, les artères plus distales. Ces atteintes distales et
souvent diffuses rendent plus difficiles les perspectives de traitement chirurgical tant en ce qui
concerne les coronaires que les membres inférieurs
1 - ANATOMIE PATHOLOGIQUE :
On distingue 2 grands types de lésions :
-l’athérosclérose : remaniements de l’intima et de la média des grosses et moyennes
artères par l’accumulation de lipides, glucides complexes, de produits sanguins, de tissu fibreux et
de calcium.
-la médiacalcose : calcifications de la média et de la limitante élastique interne des
artères de moyen et petit calibre.
Ces lésions ne sont pas spécifiques de la maladie diabétique, mais surviennent plus tôt et avec
une fréquence accrue chez les patients en hyperglycémie chronique.
2 - ÉPIDÉMIOLOGIE :
Le diabète est un facteur de risque indépendant des maladies cardio-vasculaires :
De nombreuses études épidémiologiques prospectives ou rétrospectives soulignent la gravité de
la macroangiopathie et plus particulièrement de l'atteinte coronarienne. Les infarctus du myocarde
sont plus fréquents chez les diabétiques, mais aussi plus graves. Le diabète est responsable d'une
surmortalité d'origine cardio-vasculaire quelle que soit la population étudiée, aussi bien chez les
hommes que chez les femmes et 65 à 80 % des patients diabétiques meurent d’une pathologie
cardio-vasculaire. On estime que les maladies cardio-vasculaires sont responsables d’une
diminution de l’espérance de vie de 8 ans pour les patients entre 55 et 64 ans. Le diabète fait aussi
disparaître la relative protection qu'ont les femmes avant la ménopause vis à vis du risque
coronarien.
Il est très important de noter que si les diabétiques paient un lourd tribut aux complications
cardiovasculaires, une meilleure prise en charge des différents facteurs de risque (PA, lipides,
prescription d’anti-aggrégants plaquettaires..) est à l’origine d’une moindre mortalité dans les
dernières études lorsqu’on compare l’incidence des complications à celle observée il y a 15 ans.
Ces complications ne sont pas inéluctables et il est donc possible d’intervenir de manière efficace
pour les prévenir.
Il semble que, dans le diabète de type 1, l'incidence de la coronaropathie dépende de l’équilibre
glycémique (étude DCCT- EDIC) et de la durée d'évolution du diabète. L'étude anglo-saxonne de
la Joslin Clinic montre qu'après au moins 35 ans d'évolution du D1, 60 % des patients sont
décédés, dont 25 % par infarctus. Les diabétiques de type 1 les plus à risque sont ceux atteints
d'une néphropathie protéinurique (microalbuminurie > 300 mg/j) : le risque de voir un événement
coronarien est 6 fois plus important que chez le DT1 normoalbuminurique.
Le DT2 est un facteur de risque indépendant de maladie coronaire, d'accident vasculaire cérébral
et d'artériopathie des membres inférieurs. Les complications cardio-vasculaires représentent aussi
la principale cause de mortalité et de morbidité dans le diabète de type 2 : 20 % des D2 de
découverte récente qui avaient accepté de participer à l'étude anglaise UKPDS (étude comparant
différentes possibilités thérapeutiques) ont présenté un accident cardio-vasculaire durant les 9
premières années de l'étude. 18 % des patients inclus dans cette même étude présentaient déjà une
anomalie de l'ECG au moment du diagnostic de diabète.

Un travail épidémiologique a même suggéré que le risque cardiovasculaire d'un D2 en prévention
primaire était au moins égal à celui d'un patient non diabétique en prévention secondaire. Des
données plus récentes sont toutefois moins pessimistes.
L'incidence de l'atteinte coronarienne ne dépend pas de la longueur d'évolution du D2, mais de
l’équilibre glycémique, des marqueurs et des facteurs de risque qui lui sont associés. Il a été
montré (Étude de Mac Léod) qu’une élévation modérée de la microalbuminurie (> 15 mg/j) est un
marqueur du risque vasculaire puisque associé à une augmentation significative de la mortalité
cardio-vasculaire. La microalbuminurie serait le marqueur d’une souffrance endothéliale diffuse.
Ce risque cardiovasculaire accru apparaît dès le stade de l'intolérance au glucose. L'Étude
Prospective Parisienne note que le risque de mortalité coronaire double dès que la glycémie à jeun
est entre 1,25 g/l et 1,4 g/l et triple quand elle est > à 1,4 g/l.
Le débat selon lequel la glycémie est un facteur de risque cardiovasculaire dans le diabète de type
2 reste ouvert. De nombreuses données épidémiologiques vont dans ce sens. Les résultats des
dernières études d’intervention (PROACTIVE, ADVANCE, ACCORD…) sont plus discutables. Il
faut retenir qu’en 2008, aucune étude n’a réussi à montrer qu’une intervention spécifique jouant
seulement et exclusivement sur la glycémie améliore le risque cardiovasculaire. Il n’en est pas de
même dans le DT1 où les patients randomisés dans le groupe « ttt intensifié » du DCCT présentent
à long terme moins de complications cardiovasculaires que ceux du groupe standard.
3 - PHYSIOPATHOLOGIE :
La physiopathologie de la macroangiopathie n’est pas encore connue avec certitude du fait de sa
complexité et des multiples facteurs en cause.
Même si son rôle a longtemps été sous-estimé, l’hyperglycémie par elle même est un facteur de
risque de la macroangiopathie. Plusieurs études cliniques ont démontré que la glycémie et/ou
l’HbA1c sont des marqueurs indépendants de mortalité cardio-vasculaire. Ainsi, dans l’étude
DIGAMI 2, dans une population de DT2 suivis après un infarctus du myocarde, une augmentation
de 2% de l’HbA1c conduit à une augmentation de la mortalité de 20 %. Les DT1 dont l’équilibre
glycémique est satisfaisant font moins d’évènements cardiovasculaires que ceux dont l’HbA1c est
chroniquement élevée. Les données épidémiologiques sont aussi en faveur de cette hypothèse.
L'hyperglycémie interviendrait en :
- favorisant la prolifération des cellules musculaires lisses sur la paroi artérielle,
- favorisant la glycation des lipoprotéines, du collagène...
- favorisant la thrombose,
- en augmentant le stress oxydatif
- en aggravant la dysfonction endothéliale.
La question restant en suspens en 2008 est celle de savoir jusqu’où baisser la glycémie et l’HbA1c.
Viser une HbA1c autour de 7 % semble être un objectif prudent, même s’il est souvent difficile à
atteindre en pratique courante.
Dans le DT2 la responsabilité de l’hyperinsulinisme dans la genèse de l’athérosclérose n’est pas
certaine. Plusieurs études effectuées dans les années 1970-80 avaient suggéré que
l’hyperinsulinisme était un facteur de risque de la macroangiopathie, mais ces études utilisaient des
kits de dosage dosant en même temps l’insuline “native” et ses précurseurs (notamment la pro-
insuline) qui seraient athérogènes. Plusieurs études récentes ne retrouvent pas de lien entre
l'insulinémie "vraie" et la mortalité cardio-vasculaire chez les diabétiques.
Par ailleurs, tous les facteurs de risque classiques de la maladie coronaire sont retrouvés avec une
fréquence accrue chez le diabétique et leur pouvoir pathogène est supérieur dans cette population à
celui qu’ils possèdent dans la population générale.
Plus de la moitié des D2 sont hypertendus et les données de l’étude MRFIT montre le pouvoir
délétère de cette hypertension : la mortalité cardio-vasculaire est supérieure chez un diabétique
ayant une TA systolique entre 140 et 159 mm Hg que chez un non diabétique ayant une TA
systolique entre 180 et 199 mm Hg.
L'étude UKPDS, a bien montré l'importance d'un contrôle strict de la pression artérielle chez les
diabétiques de type 2. Dans cette étude le contrôle strict de la TA permet, après 9 années de suivi, une

diminution significative de la mortalité, des AVC et des complications microvasculaires. Chaque diminution
de 10 mmHg de la PA entraîne :
- une diminution de 10 % des évènements liés au diabète
- une diminution de 17 % de la mortalité liée au diabète
- une diminution de 13 % des infarctus du myocarde
- une diminution de 20 % des AVC.
Ces effets sont additifs à ceux du bon équilibre glycémique.
Cette étude a également montré les difficultés du traitement anti-hypertenseur puisque pour obtenir un
contrôle "correct" de la pression artérielle, plus de 30 % des patients devaient prendre au moins 3
traitements anti-hypertenseurs.
On comprend donc l’intérêt d’un strict contrôle de la tension artérielle et on propose, en 2008,
d'essayer d'atteindre chez tout diabétique les objectifs d’une TA systolique < 130 mm Hg et d’une
TA diastolique < 80 mm Hg.
Les anomalies du métabolisme des lipides sont également plus fréquentes dans la population
diabétique, si on excepte les diabétiques de type 1 bien équilibrés qui présentent les mêmes
dyslipémies que la population générale. L’hypercholestérolémie de type IIa n’est pas plus
fréquente chez le diabétique. Le HDL cholestérol a même tendance à être plus élevé chez les DT1
que dans la population générale. Le déséquilibre du DT1 s’accompagne, par contre, fréquemment
d’une hypertriglycéridémie.
Le diabète de type 2 s’accompagne fréquemment d’un HDL bas et d’une élévation des
triglycérides. L'Étude Prospective Parisienne a montré que l'élévation des triglycérides était un
facteur de risque indépendant de la maladie coronarienne dans le DT2. Dans cette étude, le pouvoir
athérogène des triglycérides est supérieur à celui du cholestérol.
La concentration de LDL-cholestérol est en général normale, mais la taille et la densité de ces
particules est modifiée dans un sens athérogène : les LDL sont plus denses, plus petites et infiltrent
plus facilement la paroi artérielle. Par ailleurs elles sont plus facilement glyquées et oxydées et
sont alors reconnues par un récepteur particulier à la surface des macrophages dit “scavenger”
donnant ainsi naissance à la cellule spumeuse, lésion initiale de la plaque d’athérome.
Les traitements de l'HTA et des dyslipémies chez le diabétique sont abordés dans un autre
chapitre.
Les diabétiques présentent aussi des anomalies favorisant la thrombose :
- augmentation de l’aggrégabilité plaquettaire,
- augmentation du facteur Willebrand
- augmentation de certains facteurs de la coagulation : facteur VII, facteur X, fibrinogène.
- anomalies de la fibrinolyse : augmentation du PAI-1.
On a aussi décrit dans le diabète une augmentation de la production de certains facteurs de
croissance qui favoriseraient l’athérosclérose en favorisant la prolifération cellulaire au niveau de
la paroi artérielle.
De manière parallèle à cette macroangiopathie, il a été aussi montré des troubles de la micro-
ciculation, favorisés par la dysfonction endothéliale et les anomalies pro-thrombotiques.
4 - L'ISCHÉMIE CORONARIENNE
4-1 : -Particularités de l'ischémie coronarienne chez le diabétique :
L'atteinte coronarienne peut être découverte à l'occasion d'une symptomatologie d'angor d'effort
typique, mais ceci est rare. Il s'agit le plus souvent d'un angor atypique, atténué et il faut savoir
interroger le patient longuement en recherchant des petits signes comme une dyspnée pour des
efforts de plus en plus faibles... du fait de la neuropathie autonome cardiaque, l'ischémie est le plus
souvent SILENCIEUSE ce qui impose la mise en oeuvre d'un dépistage chez les diabétiques à
risque. La réalisation d'un électrocardiogramme tous les ans doit être systématique chez le
diabétique.

L'infarctus du myocarde n'est qu'exceptionnellement diagnostiqué à l'occasion d'une crise
douloureuse hyperalgique ; les formes les plus fréquentes sont indolores. Le diagnostic sera porté
ultérieurement devant une séquelle électrocardiographique. Il est encore trop souvent fréquent de
découvrir le diabète lors de l'accident cardiaque, mais il faut aussi, dans ces conditions, se méfier
des troubles transitoires de la glycorégulation induits par cette pathologie, susceptibles de faire
porter le diagnostic de diabète par excès. Le dosage de l'HBA1C renseignera sur d'éventuels
troubles de la glycorégulation antérieurs.
L'ischémie coronarienne est grave : les lésions sont souvent diffuses, étagées et on note une
fréquence accrue des lésions tritronculaires. On comprend donc que le pronostic après un infarctus
soit plus mauvais chez les diabétiques que dans la population générale avec une augmentation de la
mortalité précoce ou tardive (en général multipliée par 2). Ceci serait du à une plus grande
fréquence du choc cardiogénique, des troubles du rythme, de l’insuffisance cardiaque autonome et
à la neuropathie autonome cardiaque.
4-2 : Définitions de l’ischémie coronarienne silencieuse :
L’IMS de type 1 se définit comme une anomalie électrographique (et/ou scintigraphique et/ou
échographique), silencieuse et transitoire observée à l’occasion d’un stress chez un sujet dont
l’ECG de repos est strictement normal. Elle est plus fréquente chez le diabétique que chez le non
diabétique et sa prévalence est élevée quand d’autres FdR CV sont associés au diabète. Elle
toucherait 10 à 30 % des DT2 selon les séries et les méthodes utilisées pour la dépister. Elle est
associée au risque de survenue d’un accident CV majeur.
4-3 : Le dépistage de l'ischémie coronarienne :
4-3-1 : Moyens :
L'électrocardiogramme au repos n'a aucune valeur diagnostique quand il est normal. Il doit
néanmoins être réalisé systématiquement au moins une fois par an afin de déceler un infarctus
passé inaperçu. Un ECG de repos anormal doit, par contre, conduire à approfondir le bilan.
L'épreuve d'effort est un test de dépistage non invasif, fiable et peu onéreux ( 76.8 euros) Elle
peut s'effectuer sur tapis roulant ou sur bicyclette ergométrique. Le patient doit atteindre au moins
85 % de la fréquence cardiaque maximale (soit 220 - l'âge) pour qu'elle soit interprétable. Elle doit
également être "démaquillée", en l'absence de contre-indication à l'arrêt des traitements anti-
ischémiques. Les béta-bloquants doivent être arrêtés progressivement au minimum 48 heures avant
l'examen. Les inhibiteurs calciques de longue durée d'action seront également stoppés 48 heures
avant l'examen. Les inhibiteurs calciques de durée d'action plus brève et les dérivés nitrés seront
arrêtés la veille de l'examen. La sensibilité de l'examen serait de 75 % et sa spécificité de 77 %
dans la population diabétique.
La scintigraphie myocardique de perfusion au thallium ou au MIBI est beaucoup plus onéreuse
(520 euros). Elle doit être couplée à un test de provocation : effort ou injection de persantine.
L'examen doit être également démaquillé et les mêmes précautions que précédemment seront
prises. L'asthme est une contre-indication formelle à la réalisation d'une scintigraphie myocardique
à la persantine.
L'interprétation de l'examen se fait en comparant les clichés obtenus après effort ou injection de
persantine et ceux au repos. Une ischémie se traduira par un défect réversible, une nécrose par un
défect persistant. On se méfiera des déficits dans le territoire inférieur qui sont souvent de faux
positifs quand ils sont isolés, du fait d'une hypertrophie mammaire ou d'un foie de stéatose,
fréquents dans le D2. Chez le diabétique, on estime la sensibilité de l'examen à 80 % et sa
spécificité à 87 %.
L'échographie de stress est en cours d'évaluation. Son principal intérêt tient à son coût modéré,
mais l'examen est long et demande un opérateur entraîné pour être interprétable. Il s'agit d'un
examen non invasif. La sensibilité de la méthode est de 81 % pour une spécificité à 85%.
Le scanner coronaire est lui aussi en cours d’évaluation. Il a l’inconvénient de nécessiter une
injection de produit iodé, et l’injection d’iode doit être entourée des mêmes précautions que celles
de la coronarographie.

L'enregistrement holter ECG des 24 heures n'a aucun intérêt chez le diabétique, du fait de sa faible
sensibilité (30 %).
La coronarographie reste l'examen de référence pour affirmer le diagnostic de coronaropathie.
Elle permet de visualiser le nombre et le siège des sténoses, mais également d'apprécier le lit
d'aval, et la fonction ventriculaire gauche (fraction d'éjection).
L'examen est invasif et comporte un risque vital ou d'accident grave de 1 %. Chez le patient
fragile et souvent atteint de néphropathie, l'injection d'iode doit être entourée d'un certain nombre
de précautions : les biguanides doivent être arrêtés 48 heures avant l'examen, les sulfamides la
veille de l'examen et ces traitements ne seront repris que 48 heures après, après avoir vérifié
l'absence d'insuffisance rénale (dosage de la créatininémie à la 24 ème puis la 48 ème heure). Une
insulinothérapie transitoire peut se discuter en cas d'équilibre glycémique précaire. Il est
indispensable d'assurer, dans tous les cas, une hydratation correcte, per os sous forme de
l'absorption d'un litre de Vichy les jours précédant l'examen, puis IV le jour même en perfusant 500
cc de BiNa sur 8 heures.
4-3-2 : Chez qui dépister une ischémie silencieuse ?
En terme de Santé Publique et de coût de la santé, ce serait une erreur de dépister une ischémie
silencieuse chez tous les diabétiques. Les Recommandations conjointes SFC/Alfédiam (Société
française de Cardiologie / Association des Diabétologues de langue Française (ALFEDIAM)
proposent depuis 2004 le dépistage chez tout diabétique asymptomatique:
-de type 1 :
- âge > 45 ans
- et DT1 depuis au moins 15 ans
- et présence d’au moins 2 autres facteurs de risque
- de type 2 :
- de plus de 60 ans ou atteint d’un DT2 depuis au moins 10 ans avec au moins 2 FdR
associés :
o dyslipémie avec CT > 2.5 g/l et/ou LDL > 1.6 g/l, HDL < 0.35 g/l, TG > 2 g/l et
/ou ttt hypolipémiant
o PA > 140/90 mmHg ou ttt hypotenseur
o Tabagisme actif et /ou stoppé depuis moins de 3 ans.
o Accident cardiovasculaire majeur avant 60 ans chez les apparentés au 1
er
degré
- de type 1 ou 2 :
- avec une artériopathie des membres inférieurs et/ou un athérome carotidien
- ou avec une protéinurie
- de type 1 ou 2 :
- quelque soit l’âge avec une microalbuminurie et 2 autres FdR
- reprise d’une activité sportive par un sujet sédentaire de plus de 45 ans.
4-3-3 : Stratégie de dépistage et de suivi
- Bilan annuel du diabétique asymptomatique :
o examen clinique
o ECG de repos
o Biologie : lipides, évaluation de la fonction rénale
o Patient à faible risque CV :
Pas d’investigation autre
Refaire le bilan à 1 an
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%