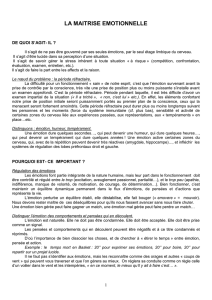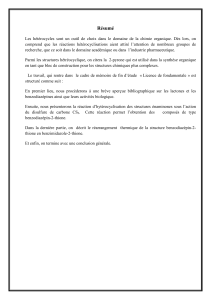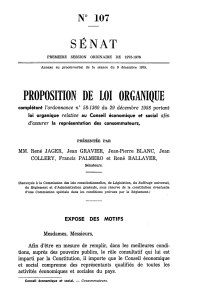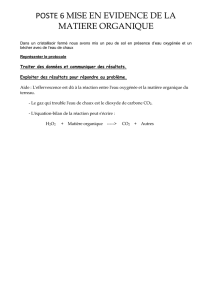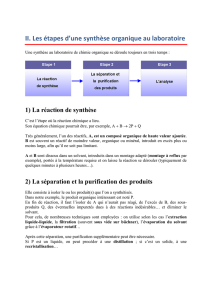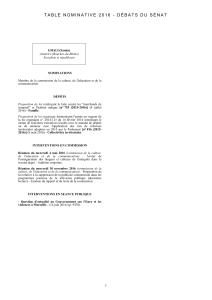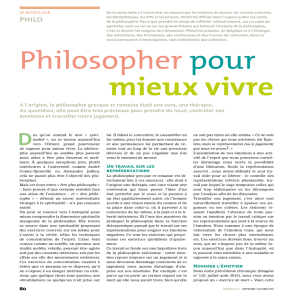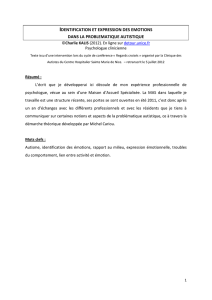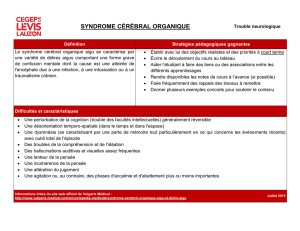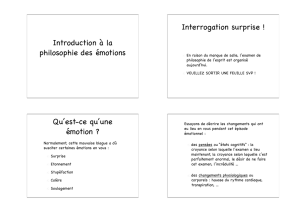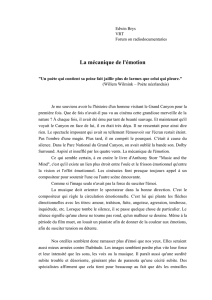Quand la peur nous prend, qu`est-ce qu`elle nous prend? Vivre la

1
Quand la peur nous prend, qu’est-ce qu’elle nous prend?
Vivre la crainte, l’inquiétude, la panique, l’affolement ou la terreur; la peur est
une émotion à la fois si commune et si unique que la langue française regorge de termes
pour révéler son existence. Avoir une peur bleue, une peur panique, une peur sourde;
mille autres adjectifs pour en enrichir la description, pour la nuancer. Avoir les sens en
éveil ou s’évanouir, sentir l’air nous manquer ou hyper ventiler, le cœur qui arrête de
battre ou qui s’emballe, figer ou fuir; les effets que la peur a le pouvoir d’engendrer sur
nous sont infinis. Et pourtant, toutes ces déclinaisons de la peur se rapportent à cette seule
émotion qui est vécue par tous et qui est à l’origine déclenchée par une cause unique : la
perception d’un danger, ou d’un événement que nous percevons comme tel, et qui
provoque en nous une réaction physiologique et psychologique. Comment l’homme
détermine-t-il le niveau de dangerosité d’une situation? La peur est-elle une émotion
dépendante d’un jugement, ou est-elle universelle? Et, surtout, provoque-elle une réaction
souhaitable, protectrice, ou au contraire nous arrache-t-elle quelque chose de
fondamental?
Étudions d’abord la peur en tant que simple représentante des émotions. Les
émotions «primaires» selon la théorie des émotions de base de Paul Ekman1 sont la joie,
la tristesse, le dégoût, la peur, la colère, la surprise et le mépris. Elles sont communes à
tous les hommes, et les réactions physiques qu’elles provoquent sont également
semblables dans toutes les cultures, ce qu’il a prouvé en montrant que des membres d’une
1 Paul Ekman, théorie des émotions de base (1972), Web

2
peuplade Papou pouvaient reconnaître les expressions faciales d’hommes appartenant à
d’autres cultures. Elles sont donc biologiquement déterminée, directement créées par les
stimuli associées et provoquent tout aussi directement les réactions somatiques adaptées,
soit par exemple le sourire dû à la joie ou le haut le cœur dû au dégoût. Or, la perception
des réactions physiques, dans le cas du dégoût par exemple, qui nous saisit sans que l’on
puisse immédiatement en identifier la cause se fait même avant la compréhension de la
cause de cette réaction par la raison, ce qui signifie que l’émotion naît en fait de notre
perception du changement physique plutôt que de notre perception de la sensation
initiale, comme l’affirme la théorie périphérique2 (selon laquelle c'est l'activation
physiologique qui va déterminer l'émotion). Les changements physiologiques qui
précèdent notre perception de l’émotion montrent bien que l’évaluation cognitive de
l’environnement suit la réaction physique et émotionnelle au stimulus, et l’on peut en
conclure que la raison humaine, soit la capacité de juger de façon logique, ne joue aucun
rôle dans la création des émotions.
La théorie des émotions de base est ardemment défendue par les évolutionnistes,
qui ont comme représentant éminent le biologiste Charles Darwin, auteur de la théorie de
la sélection naturelle qui dit que seuls les plus aptes ont survécu et ont pu produire une
descendance3. La rapidité de réaction à un danger potentiel était alors un facteur
déterminant pour la survie, alors au fil des générations ces réactions, ce qui était au départ
le fruit d’une évaluation cognitive d’une situation jugée dangereuse, est devenu un
2 Théorie de William James & Carl Lange Choquart (1887) , Web
3 Sur l'Origine des Espèces au moyen de la Sélection Naturelle, ou la Préservation des Races les meilleures
dans la Lutte pour la Vie, Charles Darwin

3
réflexe, une action ne sollicitant pas la capacité de raisonnement de l’individu, et ce
réflexe a été associé par les humains à l’émotion de «peur».
La peur est probablement l’archétype de l’émotion de base, de la prise de
conscience du danger par la prise de conscience de l’état d’alerte du corps. Qui n’a jamais
vu son pouls accélérer et son attention décupler à cause de la perception d’un mouvement
à la limite de son champ de vision, mouvement si subtil que sa perception n’est même pas
consciente ? Qui n’a jamais tressailli et ne s’est jamais raidi en sentant contre sa peau le
contact inattendu d’une autre personne, d’un autre objet, alors que la nature inconnue de
cette intrusion ne permet pas de conclure en elle-même à un danger? La chair devient dès
lors autonome, entièrement régie par des réflexes. La survie de l’homme est menacée par
l’inconnu, qui est dans la nature synonyme de danger.
La peur «organique» est donc une confrontation entre une situation et l’instinct de
survie de l’homme.
Une fois l’instinct organique contrôlé, l’événement vécu comparé aux expériences
passées et mis en contexte de la culture de l’individu, il reste la peur créée et entretenue
par le jugement que l’on se fait de la dangerosité d’une situation. Si la peur «organique»
est en effet universelle et dérivée de l’évolution, la peur «culturelle», quant à elle, est
déterminée par le jugement. Il n’y a aucun stimulus justifiant la peur de se rendre à un
rendez-vous, ou celle de décevoir quelqu’un. La peur culturelle est l’émotion provoquée
par l’interprétation de la réalité. Elle est vécue quand nous craignons de perdre quelque
chose qui nous est utile, ou qu’un danger plus subtil nous guette; quand nous vivons une
confrontation entre une situation et notre morale, soit notre conception de l’idéal.

4
Maintenant armés d’une définition claire et complète de la peur, il ne reste plus
qu’une question à laquelle répondre avant de pouvoir déterminer les effets de la peur sur
l’homme : qu’est-ce que l’homme lui-même.
Définir l’homme est probablement la question philosophique la plus abordée, celle
qui a soulevé le plus de débats; il y a pratiquement autant de définitions de l’homme que
de philosophes. Poser une définition exhaustive serait d’ailleurs absurde : comme l’écrit
Sartre, «s'il doit y avoir plus tard un concept rigoureux d'homme — et cela même est
douteux — ce concept ne peut être envisagé que comme couronnement d'une science
faite, c'est-à-dire qu'il est renvoyé à l'infini.»4 L’homme est en constante évolution, d’où
l’infini, et la psychologie ne pourra jamais être considérée comme une science purement
empirique. Les définitions proposées tentent donc de déterminer la présence ou non de
l’âme humaine, l’existence de la rationalité, la possibilité d’être libre et le sens de la vie
humaine.
Platon, Aristote et Descartes et Kant sont de ceux qui attribuent à l’homme la
raison, ce qui donne à l’homme l’objectif de se développer de façon rationnelle;
Nietzsche lui donne le désir, les passions et la démesure comme buts premiers, ce qui le
pousse à se développer de façon individuelle et égoïste. Marx et Fromm le définissent
comme être social, donc vivant dans le but de développer la société, Freud et les
déterministes comme étant un être déterminé par son environnement, et Sartre comme un
être défini par ses choix, qui eux sont influencés par le regard des autres. Toutes ces
définitions sont évidemment extrêmement condensées et incomplètes, mais donnent un
4 Méthode psychologique et méthode phénoménologique (1938), p.8, Sartre

5
bref aperçu de la perception de l’homme par l’homme à travers l’histoire de la
philosophie.
Quand la peur organique nous prend, que nous prend-elle? Puisque la peur
organique est purement sensorielle et ne fait appel à aucune logique, toute philosophie
plaçant la rationalité au cœur de la nature de l’homme se doit de conclure que face à la
peur, l’homme perd son humanité. «L’animal rationnel» qu’est Aristote ne devient qu’un
animal, la dualité âme pensante et rationnelle – corps mécanique centré sur les sens qui
définit l’homme selon Descarte n’en est plus une, et cela le rabaisse encore une fois au
simple niveau du règne animal. L’existence de l’être se résume alors, pendant un cours
laps de temps, à la confrontation entre la situation vécue et l’instinct de survie, ce qui
n’est absolument pas une mauvaise chose. L’émotion de la peur court-circuite la
rationalité et ne laisse à l’homme que ce que des siècles d’expérience lui ont transmis : la
capacité de survivre face à un danger grâce à des réflexes innés. La peur organique est
donc l’outil qui permet à l’homme de réagir immédiatement face à un danger, sans
prendre le temps de le comprendre comme le pousserait à le faire la rationalité, ce qui
peut lui permettre d’avoir la vie sauve.
Quant à la peur culturelle, quand elle nous prend, elle nous prend la sérénité. La
sérénité peut être définie comme un état de bien-être intérieur que l’homme vit lorsqu’il
est en harmonie avec sa morale et son environnement. Cela le rend passif, car puisque
« tout va bien », il a tendance à ne plus fournir d’efforts, à ne plus vouloir travailler ni sur
soi-même, ni sur son milieu. Lorsque survient un dérèglement, une confrontation entre la
réalité et notre idéal de réalité, l’homme perd sa sérénité. Ce dérèglement peut avoir été
occasionné par la crainte de perdre quelque chose que nous jugeons utile, bonne pour
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%