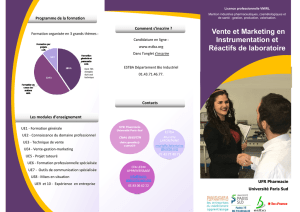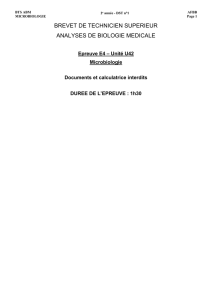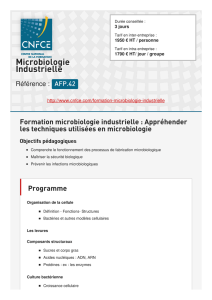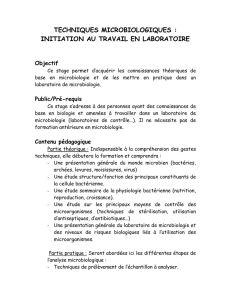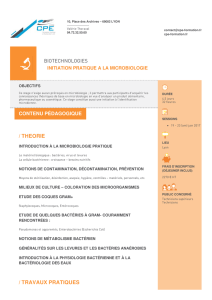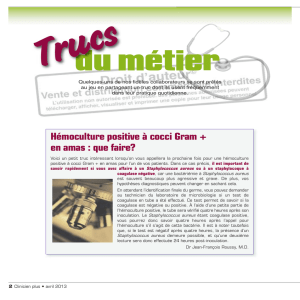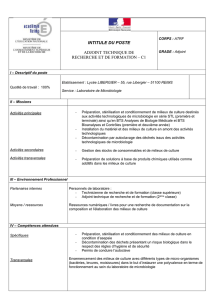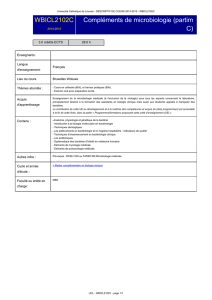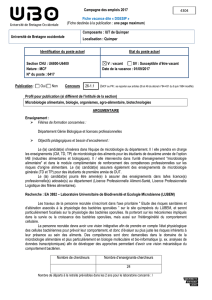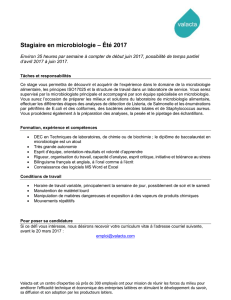La présence des agents pathogènes dans le sang

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage
PAGE 1 SUR 8
E4 - U42 : MICROBIOLOGIE
Calculatrice, téléphone portable et documents interdits
Durée : 3 heures
La présence des agents pathogènes dans le sang
1. La pénétration des micro-organismes dans le sang – 6 points
1.1. Les agents infectieux peuvent accéder à la circulation sanguine par voie indirecte
« passive » ou « active ». Définir ces deux voies et illustrer chacune d'entre-elles par un
exemple.
1.2. Cependant, les micro-organismes passent généralement dans le sang suite à une
primo-infection localisée. Présenter les étapes d'une telle colonisation en prenant
l'exemple de Staphylococcus aureus infectant une plaie.
1.3. Citer les autres voies de pénétration des agents pathogènes dans l'organisme humain et
les moyens de défense naturels s'y opposant.
2. Le prélèvement sanguin destiné à l'analyse bactériologique – 5 points
2.1. Citer un signe clinique pouvant justifier la prescription d'une hémoculture.
2.2. Quelles sont les différentes étapes et les règles à respecter lors de la réalisation d'une
hémoculture, du prélèvement à l’incubation ?
2.3. Quels sont les signes visibles à l’œil nu d'une hémoculture positive ?
2.4. A l'aide de l'annexe 1, présenter les modalités d'utilisation du « système signal ».
2.5. Quel est le principe de détection généralement utilisé par les automates d'hémoculture ?
3. Les bactéries responsables d'infections symptomatiques – 20 points
3.1. Les données épidémiologiques montrent que Staphylococcus aureus et Klebsiella
pneumoniae sont deux espèces souvent isolées en situation de pathogénicité. Expliquer
la démarche d'identification complète de ces deux espèces à partir d'un flacon
d’hémoculture positif.
3.2. Lors de la réalisation de l'antibiogramme de S. aureus, on effectue un test de sensibilité à
la cefoxitine (annexe 2). Cette recherche peut également être effectuée par isolement sur
milieu chromogène ChromID
TM
MRSA, présenté en annexe 3. En cas de doute, la
présence du gène mecA peut être recherchée par méthode moléculaire (annexe 4).
3.2.1. Exposer le principe du test de sensibilité à la cefoxitine à l’aide de l’annexe 2. Que
doit-on conclure quand une souche de S. aureus est résistante à la céfoxitine ?
3.2.2. Qu’est-ce qu’un milieu chromogène ? Quel est l’intérêt d’un tel milieu ?
3.2.3. Indiquer les différentes étapes ayant permis d’obtenir la photographie fournie en
annexe 4 puis interpréter les résultats obtenus pour chacune des 4 souches testées.

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage
PAGE 2 SUR 8
3.3. Klebsiella pneumoniae est naturellement résistante aux amino-pénicillines et à la
ticarcilline. Mais certaines souches s’avèrent multirésistantes, notamment aux
béta-lactamines par production de « BLSE ».
3.3.1. Quel est le mode d’action des béta-lactamines ?
3.3.2. Donner une classification succincte des béta-lactamines.
3.3.3. Définir la résistance naturelle à un antibiotique.
3.3.4. Quel est généralement le support génétique des multirésistances ? Quels sont les
phénomènes à l’origine de la propagation des résistances dans les populations
bactériennes ?
3.3.5. Préciser la signification de « BLSE » et expliquer la conséquence de la production
de cette molécule sur l’antibiothérapie.
3.3.6. Interpréter l’antibiogramme fourni en annexe 5.
3.4. En cas d'endocardite, les hémocultures peuvent révéler la présence de Streptococcus non
groupables ou d'Enterococcus. Les Enterococcus peuvent être isolés sur milieu B.E.A.
Ces germes sont naturellement résistants aux aminosides (résistance de bas niveau).
3.4.1. Définir le terme « endocardite ».
3.4.2. Pourquoi certaines espèces de Streptococcus sont dites « non groupables » ?
3.4.3. Que signifie l'abbréviation B.E.A. ? Préciser l'aspect des colonies d'Enterococcus
sur ce milieu.
3.4.4. Quel est le mode d'action des aminosides ?
3.4.5. Expliquer la mise en évidence de la résistance acquise de haut niveau aux
aminosides sur un antibiogramme par diffusion.
3.5. Lorsque Clostridium perfringens infecte une plaie profonde, le risque de septicémie est
élevé.
3.5.1. Quels sont les facteurs de virulence de cette bactérie ?
3.5.2. Sous forme de diagramme, présenter la démarche d'identification de Clostridium
perfringens à partir d'une hémoculture.
3.6. En cas de tuberculose pulmonaire, le passage des germes dans la circulation sanguine
est possible.
3.6.1. Citer le nom d'espèce de la bactérie responsable de la tuberculose.
3.6.2. Quelles sont les particularités structurales et culturales de ces bactéries ? Quelles
sont les conséquences de ces particularités sur le diagnostic ?

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage
PAGE 3 SUR 8
4. Les virémies – 14 points
4.1. Le virus de l’immunodéficience humaine (HIV) se réplique dans certains lymphocytes et
dans les monocytes. Les caractéristiques du HIV sont fournies dans le tableau
ci-dessous :
4.1.1. Quelles sont les principales caractéristiques structurales des virus (distinguer les
éléments constants et les éléments facultatifs) ?
4.1.2. Donner les légendes sur le schéma de la structure du VIH, fourni en annexe 6.
4.1.3. Quels sont les critères de classification utilisés pour justifier l’appartenance du VIH
au Retroviridae ?
4.1.4. Expliquer le mécanisme d’entrée du HIV dans une cellule sensible. Préciser le type
de lymphocyte infecté.
4.1.5. Quelles sont les différentes activités enzymatiques permettant l’intégration des
gènes viraux dans le génome de la cellule hôte ?
4.1.6. L’annexe 7 montre le mode de production des particules virales par une cellule
infectée. Indiquer le nom de l’appareil ayant permis d’obtenir cette image et nommer le
phénomène observé.
4.2. Le cytomégalovirus (CMV ou HHV-5) se multiplie également dans les leucocytes. La
culture in vitro permet la production de virus infectieux à partir de cellules infectées.
L’inoculation du virus entraîne l’apparition d’un « ECP » sur les cellules après quelques
heures d’incubation.
4.2.1. A quelle famille appartient le CMV ? Citer trois autres virus appartenant à cette
famille et préciser la (ou les) pathologie(s) dont ils sont respectivement responsables.
4.2.2. Les virus de cette famille sont parfois responsables d’infections latentes ou de
transformations tumorales. Expliquer les expressions « infection latente » et
« transformation tumorale ».
4.2.3. La culture virale utilise différents types de lignées cellulaires : primaires,
secondaires ou continues. Définir ces trois types.
4.2.4. Donner la signification de l’abréviation « ECP » et expliciter cette notion.
5. Les infections par les levures – 6 points
Les infections fongiques chez le patient immuno-déficient sont surtout des cryptococcoses et
des candidoses.
5.1. Donner le principe de deux tests simples d’identification de Cryptococcus neoformans :
mise en évidence de la capsule et uréase « rapide ».
5.2. L’annexe 8 fournit les résultats de deux tests d’identification de Candida albicans.

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage
PAGE 4 SUR 8
5.2.1. - Nommer chacun de ces deux tests.
5.2.2. - Donner les légendes 1 à 5 de l’annexe 8.
5.3. Un antifongigramme est réalisé sur une souche de Candida albicans selon le protocole
présenté en annexe 9.
5.3.1. A quoi correspondent les valeurs 2 mg.L
-1
et 32 mg.L
-1
pour la 5-Fluorocytosine ?
5.3.2. Interpréter les résultats obtenus (annexe 9).
6. Les parasitoses (à rédiger sur une copie différente) – 9 points
6.1. Le paludisme est une parasitose due à des sporozoaires (= hématozoaires) du genre
Plasmodium et transmise par des moustiques du genre Anopheles. Le diagnostic repose
sur la découverte dans le sang des différentes formes de Plasmodium.
6.1.1. Donner les caractères d’identification de Plasmodium falciparum à partir d’un frottis
sanguin coloré au MGG.
6.1.2. Citer un test de diagnostic indirect du paludisme.
6.2. L'onchocercose est une filariose cutanéo-dermique, strictement humaine due à un ver
nématode vivipare : Onchocerca volvulus. Les vers adultes émettent des microfilaires qui
peuvent se retrouver dans le sang.
6.2.1. Quelle est la localisation des vers adultes chez l'homme ?
6.2.2. Quelle est la principale complication ?
6.2.3. Comment reconnaît-on une microfilaire dans le sang ? (un schéma pourra
accompagner la réponse)
6.3. D'autres nématodes peuvent induire des pathologies chez l'homme. Parmi ceux-ci on peut
citer l'Ascaris, le Trichocéphale et l'Oxyure.
Pour ces trois nématodes indiquer :
- le nom du genre et de l'espèce ;
- sous quelle(s) forme(s) les œufs sont retrouvés dans les selles.

BTS BLANC 2011 MICROBIOLOGIE ESTBA / TS2ABM apprentissage
PAGE 5 SUR 8
Annexe 1
Système Signal
®
Oxoïd
TM
Annexe 2
Annexe 3
L’identification directe des souches de SARM est basée sur la coloration verte des colonies
productrices d’α-glucosidase, et la présence d’un antibiotique, la céfoxitine.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%