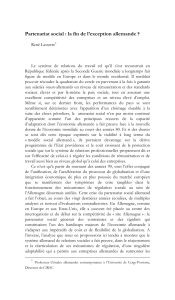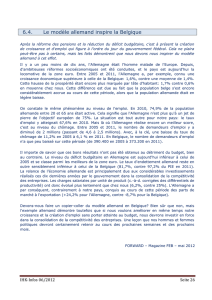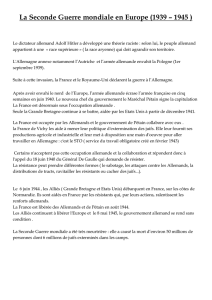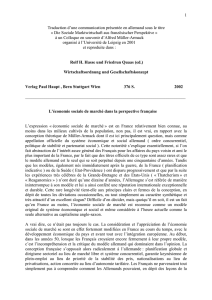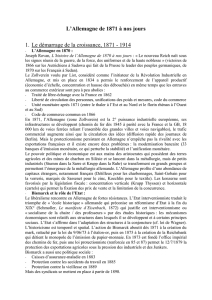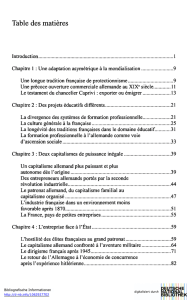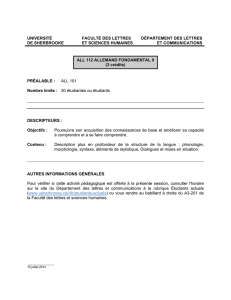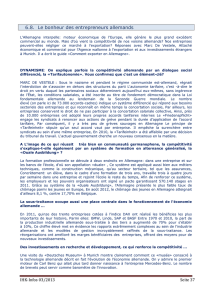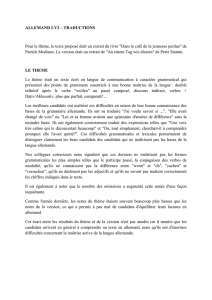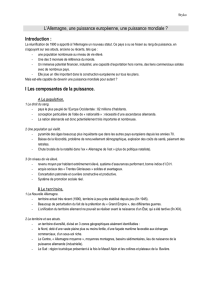OÙ EN EST LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ALLEMAND ?

OÙ EN EST LE MODÈLE
ÉCONOMIQUE ALLEMAND ?
n cette année 1996, l'économie allemande envoie des signaux contra-
dictoires : forte d'avoir réussi, en cinq ans, à « digérer » la réunification
en maintenant son système, elle affiche cependant deux mauvaises
performances : le non-respect en 1995 et 1996 des critères budgétaires de
convergence définis par le traité de Maastricht et le franchissement, au début
de 1996, du seuil des quatre millions de chômeurs officiels (4.270.000 en
février, soit plus de 400.000 chômeurs supplémentaires en un an) et des 11%
de chômeurs au sein de la population active (9,6 % à l'Ouest et 17,5 % à l'Est
en février). D'autres signes d'une détérioration de la situation économique de
l'Allemagne depuis quelques mois s'accumulent : l'investissement des entre-
prises stagne, les perspectives de croissance demeurent médiocres, le mar-
ché obligataire voit ses taux à long terme remonter, affichant ainsi une méfian-
ce persistante à l'égard des performances économiques allemandes.
Depuis 1993, date de la pire récession allemande depuis la dernière guerre
(croissance négative de -1,2 %, dont -1,8 % à l'Ouest), l'on voit s'amplifier en
Allemagne un débat sur la compétitivité structurelle de son économie, la
fameuse Standortdebatte. La question est maintenant posée de savoir si le
« modèle » allemand est menacé dans ses fondements mêmes.
Les composantes du « modèle » allemand
Le terme de « modèle » sera compris ici, non pas dans le sens d'un exemple,
dans la mesure où il n'est guère transposable à d'autres pays, mais dans son
acceptation neutre de système. Plus que d'un système économique, mieux
vaudrait parler de système économique et social, tant les paramètres sociaux
et culturels sont indissociables du fonctionnement de l'économie.
Ce système repose pour l'essentiel sur trois éléments : monétaire, social et
industriel.
En premier lieu, une culture de stabilité monétaire, née de la hantise de
l'hyperinflation de 1923, qui a permis depuis près de cinquante ans le main-
tien de l'inflation à un bas niveau. Grâce aux efforts ininterrompus de la Bun-
desbank, le pouvoir d'achat du Deutsche Mark a pu être préservé et même
considérablement amélioré, par des réévaluations successives. Au lieu d'un
long discours, rappelons que la parité franc-mark est passée de 1 pour 1 en
1959 à 3,42 francs pour 1 DM aujourd'hui.
15
CHRISTINE DE MAZIÈRES
E
DOCUMENTS
MODÈLE
ALLEMAND

En second lieu, la gestion concertée du marché du travail ou cogestion a
fait la preuve jusqu'ici de sa remarquable efficacité (rareté des conflits sociaux).
La cogestion repose sur trois fondements : existence d'un syndicalisme uni-
taire (le DGB, quoique en diminution sensible, a toujours dix millions d'adhé-
rents) et puissant, parité légale de représentation des salariés et dirigeants au
sein des conseils de surveillance des entreprises de plus de 2.000 salariés,
enfin l'« autonomie tarifaire », c'est-à-dire l'indépendance légale des parte-
naires sociaux par rapport aux pouvoirs publics dans les négociations sala-
riales et sur les conditions de travail.
Troisième élément, une spécialisation industrielle sur des secteurs à haute
valeur ajoutée et des produits de grande qualité, qui permet de dégager
d'importants excédents commerciaux, tout en maintenant une monnaie
surévaluée et des salaires très élevés, corollaires de hautes qualifications.
Cet avantage compétitif fondé sur la qualité et non sur les prix est l'originalité
allemande. L'économie allemande est à la fois très industrielle et extravertie :
la culture industrielle est l'un des fondements de l'identité allemande (le pre-
mier salon industriel du monde, l'Industriemesse de Hanovre, n'attire pas que
des professionnels, mais aussi des familles entières), et la tradition exporta-
trice allemande est ancienne (cf. la Hanse).
Or, depuis le milieu des années quatre-vingt et surtout le début des années
quatre-vingt-dix, c'est cette dernière composante du système qui subit un lent
dérèglement.
Double mise à l'épreuve du modèle économique allemand
Deux évolutions affectent depuis quelques années la compétitivité allemande :
– Une évolution lente, ce qu'il est convenu d'appeler la globalisation de l'éco-
nomie mondiale. L'internationalisation des marchés du travail et des capitaux
entraîne une « dérégulation » de ceux-ci, c'est-à-dire une remise en cause de
leur organisation au niveau national. En ce qui concerne les marchés finan-
ciers, l'on assiste ainsi à une remise en cause progressive des Hausbanken,
les banques-maisons qui illustrent l'imbrication étroite entre l'industrie et les
banques allemandes. Désormais, des entreprises allemandes veulent faire
jouer la concurrence avec des banques étrangères et certains établissements
financiers, comme les caisses d'épargne, adoptent des mentalités plus inter-
nationales concernant le placement de leurs fonds. Pour ce qui est du marché
du travail, les délocalisations croissantes d'emplois vers des pays jugés plus
compétitifs sont source d'inquiétudes croissantes (cf. infra).
– Un événement spécifiquement allemand, la réunification. La politique éco-
nomique du gouvernement de Bonn dans cette affaire majeure s'est au départ
fondée sur une illusion, celle de ne pas devoir planifier le passage de l'économie
planifiée (ou plus précisément d'une économie bureaucratique autoritaire) à
l'économie de marché : le marché par ses seules vertus devait apporter un nou-
veau miracle économique. Une illustration de cette idée se retrouvait dans la
16
DOCUMENTS

croyance selon laquelle la privatisation des entreprises est-allemandes auto-
financerait leur assainissement et leur mise aux normes occidentales, en
d'autres termes que la Treuhandanstalt équilibrerait ses comptes. L'on sait qu'il
n'en fut rien. L'Office fiduciaire, au terme de sa mission fin 1994, a laissé un
passif de 270 milliards de DM, représentant un service de la dette de 20 mil-
liards de DM par an pendant quarante ans pour le budget fédéral. L'erreur
conceptuelle initiale de croire en l'existence d'une « main invisible » consub-
stantiellement inhérente à l'économie de marché a conduit in fine à un finan-
cement de l'unification par l'emprunt, qui d'une part entraîne une tension sur
les taux d'intérêt et un effet d'éviction des investissements privés et reporte
d'autre part la charge financière sur les générations futures. Néanmoins, cette
«gestion de crise sans stratégie d'ensemble » du début (ainsi que l'ont écrit
J. Priewe et R. Hickel dans « Der Preis der Einheit » (Le prix de l'unité , Fischer,
1991) n'a pas empêché un succès d'ensemble de la politique économique de
l'unification : seules 20 % des firmes prises en charge initialement par la Treu-
hand ont totalement disparu, 80 % ont pu être assainies en tout ou partie. Sim-
plement, le modèle de l'économie sociale de marché a fonctionné, dans les nou-
veaux Länder, beaucoup plus dans sa composante sociale qu'à travers la
logique du marché. La politique économique de l'unification s'est en effet carac-
térisée par un extraordinaire volontarisme étatique : volontarisme des transferts
financiers d'Ouest en Est et volontarisme d'une véritable politique industrielle
qui n'ose dire son nom (ce terme étant tabou outre-Rhin). En 1994, les transferts
publics vers l'Est se sont élevés à 200 milliards de DM, soit 6 % du PIB ouest-
allemand et… 60 % du PIB est-allemand ! Quant à la politique industrielle, son
existence ne peut plus être niée lorsqu'il en coûte 25 milliards de DM au total
aux finances publiques du pays pour assainir le secteur de la chimie est-alle-
mande, par exemple.
Au total, la transformation de l'économie est-allemande a dû être beaucoup
plus profonde et brutale qu'il n'avait été prévu à l'origine. Il faudra que les his-
toriens se penchent sur les raisons pour lesquelles l'Occident avait donné foi
à la propagande du « pays du socialisme réel », qui se donnait comme dixième
nation industrielle du monde. En réalité, cette économie était déjà en faillite
plus ou moins bien dissimulée au moment de l'unification : une économie qui
ne pratique plus d'investissements et consomme l'ensemble de sa production
intérieure signe son arrêt de mort. L'effondrement fut en conséquence brutal
(- 45 % du PIB en 1989-90) et relativement long : la Talfahrt (descente rapide )
ne s'arrêta qu'au début de 1994. Depuis, l'économie est-allemande connaît
une croissance « à l'asiatique », de l'ordre de 9 % par an. Mais ce taux n'a
pas jusqu'à présent suffi à retrouver le niveau de production antérieur, et ne
signifie surtout pas un rattrapage rapide des anciens Länder, lorsque le PIB
est-allemand ne représente encore que 10 % du PIB ouest-allemand. C'est
une évidence mathématique : 10 % de 10 constitue moins que 2 % de 100.
Quoi qu'il en soit, le PIB par habitant de l'ex-RDA est passé de 31 % du niveau
de l'Ouest en 1991 à 52 % en 1995. Il dépasse désormais les niveaux du Por-
tugal et de la Grèce, pays membres de l'Union Européenne. Grâce aux trans-
ferts venant de Bonn, le revenu disponible par habitant atteignait même à cette
17
DOCUMENTS

date 68 % de celui de l'Ouest. Les deux points noirs de l'économie est-alle-
mande demeurent, d'une part les coûts salariaux unitaires qui sont encore
supérieurs à un tiers de ceux de l'Ouest en raison du rattrapage des salaires
plus rapide que l'ajustement des productivités entre l'Est et l'Ouest, et d'autre
part la quasi-disparition des marchés d'Europe de l'Est. C'est l'industrie qui a
le plus souffert : l'ex-RDA est passée d'une surindustrialisation à une sous-
industrialisation. Au sein de l'Allemagne réunifiée, les nouveaux Länder
représentent 20 % de la population, mais seulement 10 % du PIB, 5 % de
l'industrie et 1,8 % des exportations. Au total, le modèle de l'économie
sociale de marché a fait ses preuves face à la réunification, mais au prix d'un
coût reporté vers l'avenir considérable. En tout cas, il n'y a plus une, mais deux
économies allemandes distinctes.
Les remises en cause du « modèle » allemand
Sous l'effet conjugué de ces deux facteurs, globalisation et réunification, l'Al-
lemagne assiste, inquiète, à la résorption de son avantage compétitif : des
concurrents sérieux sont apparus sur les marchés des produits de qualité
(pays asiatiques, voire certains pays occidentaux comme l'Italie), marchés
eux-mêmes saturés pouvant plus difficilement absorber la production d'une
Allemagne élargie à plus de 80 millions d'habitants.
Cette érosion de la compétitivité rend plus difficile à supporter les hauts coûts
salariaux et la surévaluation du taux de change du mark, et ce d'autant plus
que ce déplacement de l'équilibre économique s'accompagne de deux autres
tendances préoccupantes : la hausse des prélèvements obligatoires et l'aug-
mentation des délocalisations de productions et d'emplois vers des pays tiers.
- Le coût horaire de la main-d'œuvre allemande est le plus élevé du monde :
en 1994, il atteignait 44 DM en Allemagne de l'Ouest, contre 36 DM au Japon,
29 en France et 28 aux États-Unis. Alors que ce coût horaire augmentait de
21 % en France entre 1988 et 1994, il a crû de 35 % sur la même période en
Allemagne de l'Ouest. Un ouvrier coûtant 100 en Bade-Würtemberg ne coûte
que 80 en Bavière, 75 au Japon, 60 en France et aux États-Unis. (1) Et Lothar
Späth et Herbert Henzler de dénoncer dans la foulée le mythe de l'Allemand
grand travailleur (der fleissige Deutsche) : en fait, il ne travaillait que 1.519
heures par an en 1992, contre 1.857 aux Etats-Unis et 2.007 au Japon (2).
- Le taux de change du mark, qui continue à s'apprécier continuellement, appa-
raît comme surévalué dès lors que la compétitivité structurelle (qualité des pro-
duits) joue un rôle moins grand dans les échanges que la compétitivité-prix. Les
coûts salariaux unitaires relatifs (pondérés par l'évolution des taux de change)
sont ainsi passés, sur la base 100 en 1991, à 122 en 1995 pour l'Allemagne,
se sont maintenus au même niveau en France, ont diminué à 90 pour les États-
18
DOCUMENTS
(1) Selon Rémi Lallement, « L'unification sans miracle », CIRAC, 1995.
(2) Henzler et Späth, Sind die Deutschen noch zu retten ? Von der Krise in den Aufbruch (Peut-on encore sauver
les Allemands ? De la crise vers le redémarrage), Bertelsmann, 1993.

Unis et le Royaume-Uni, et même à 67 en Italie (source OCDE). L'on notera
qu'au sein de l'Union Européenne, ces deux derniers pays, qui ont quitté le sys-
tème monétaire européen, ont vu leur monnaie se déprécier et leur compétiti-
vité-prix s'améliorer en conséquence. C'est pourquoi l'Allemagne a tout intérêt
à une monnaie unique et une zone de stabilité monétaire la plus large possible
dans une Europe qui continue à absorber 60 % de ses exportations.
- Autre faiblesse, le poids croissant des prélèvements obligatoires (ce que les
Allemands appellent la Staatsquote - la quote-part de l'État -), qui sont passés
de 37 % du PIB en 1970 à 44,5 % en 1995 (mais la France atteint hélas le
même niveau, sans avoir subi le coût d'une réunification et sans en retirer les
avantages politiques et moraux).
- Enfin, les entreprises allemandes recourent de plus en plus aux délocalisa-
tions, afin d'améliorer leur compétitivité-prix. En 1995, ce sont 50 milliards de
DM qui ont été investis à l'étranger. La même année, la fabrication d'automo-
biles allemandes était assurée pour 35 % par des usines à l'étranger, chiffre
en hausse. Il s'agit à 90 % d'investissements dans des pays occidentaux :
ainsi, Mercedes a choisi la France pour produire sa future Swatchmobile. En
1995 toujours, Siemens a supprimé 7.000 emplois en Allemagne et en a créé
4.000 à l'étranger. En 1994, 60 % des investissements de la chimie allemande
ont été réalisés à l'étranger. Cette vague des délocalisations suscite depuis
1993 en Allemagne un vaste débat sur la compétitivité du site productif alle-
mand. Certains, comme Lothar Späth et Herbert Henzler (3), estiment qu'il n'y
a pas d'alternative à ce mouvement, et que l'Allemagne doit au contraire accé-
lérer son entrée dans l'âge post-industriel : 35 % de sa population active est
encore employée dans l'industrie (pourcentage supérieur à celui des autres
19
DOCUMENTS
(3) Voir note 2, p 18.
Coût salarial record
D'après une étude de la Monthly Labour Review américaine, l'Allemagne arrive de
loin en tête dans le monde pour le coût d'une heure de travail ouvrier dans l'indus-
trie. Il s'élève à 27,4 $ contre 17,1 $ aux États-Unis. Seules la Suisse et la Belgique
se rapprochent des chiffres allemands. La France et l'Italie se trouvent environ au
niveau américain, tandis que les salaires japonais sont d'environ 20 % plus élevés
que les salaires américains. L'écart entre l'Allemagne et l'Espagne atteint plus de
50 % et avec la Grande-Bretagne un peu moins de 50 %. Parmi les 29 pays indus-
triels enregistrés par l'étude américaine, 24 ont un coût salarial inférieur de 45 %
à celui de l'Allemagne. La charge salariale globale allemande est, par ailleurs, de
29 % supérieure à la moyenne des pays membres de l'Union Européenne. Toutes
les comparaisons concernent exclusivement les anciens Länder. La conséquence de
ce décalage salarial sont des délocalisations de plus en plus fréquentes des usines
allemandes. Les investissements directs allemands à l'étranger ont ainsi doublé entre
1994 et 1995 pour s'élever à environ 50 milliards de marks. Alfred Frisch
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%