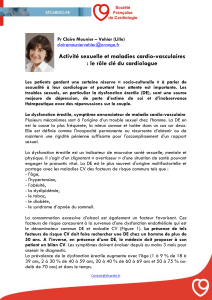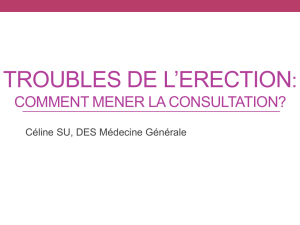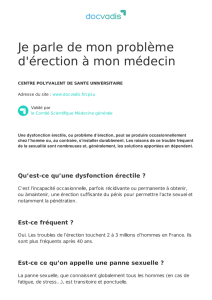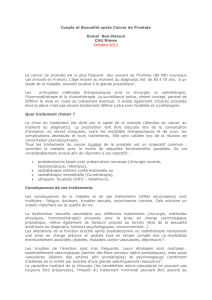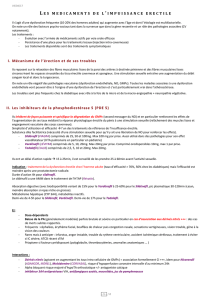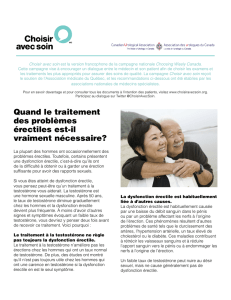détails techniques

16
DÉTAILS
TECHNIQUES
Prise en Char
ge Moder
ne de la Maladie
de Lapeyr
onie
Dr Antoine Faix Urologue
Clinique Beau Soleil - Montpellier
N°2 Septembre 2003
La pre m i è re description scienti-
fique fut faite en 1743 par
François Gigot de Lapeyronie, chi-
rurgien du roi Louis XV, et dont la
statue orne l’entrée de la faculté de
Médecine de MONTPELLIER. Cette
maladie dont l’étiologie est inconnue
depuis longtemps et de traitement
aléatoire, semble progresser depuis
10 ans avec des avancées significati-
ves dans le domaine de la physiopa-
thologie et de la prise en charg e
médicale et chirurgicale.
L’âge moyen de découverte est de 53
ans. La prévalence va de 0.40% à
3.2% selon les études. Celle-ci semble
augmenter avec l’âge allant de 1.5% à
6.5% de 30 à plus de 70 ans et est
vraisemblablement sous-estimée
comme le montre une étude autop-
sique (22%).
En général, la maladie de Lapeyronie
se réfère à une déformation acquise
de la verge en érection (coudure,mal-
ro t a t i o n , e n c o c h e , é t r a n g l e m e n t ,
racourcissement…).
L’examen clinique permet de détec-
ter une plaque albuginéale, éventuel-
lement douloureuse. Les coudure s
congénitales et les douleurs de verge
sans plaque perçue sont exclues de la
définition.
Elle est parfois associée à la maladie
de Dupuytren, la maladie de
Ledderhose, la tympanosclérose, le
diabète, la goutte, la maladie osseuse
de Paget, les manœuvres instrumen-
tales urethrales, les traumatismes et
l’usage des betabloquants. Il existe
également des formes familiales
notamment en cas de maladie de
Dupuytren.
FACTEUR MÉCANIQUE :Un traumatis-
me ou une tension excessive sur la
verge en érection pourrait entraîner
une hémorragie à l’intérieur de l’al-
buginée, notamment au niveau dor-
sal où les contraintes mécaniques
sont les plus importantes. La maladie
de Lapeyronie serait alors l’évolution
d’un mauvais processus de cicatrisa-
tion avec initialement des dépôts de
fibrine comme conséquence de la
lésion microvasculaire initiale.
FACTEUR GÉNÉTIQUE : Il ne semble
pas y avoir de lien génétique, même
si certaines études semblent avoir
reporté des associations avec certains
groupes HLA ou associations avec
des instabilités ou perte d’hétérozy-
gotie (Chromosomes 3-8-9).
FACTEUR AUTOIMMUN :Il a été évo-
qué devant la découverte de tests
immunologiques positifs, notam-
ment le test de Waaler-Rose et la pré-
sence d’anticorps anti-élastine.
FA C T E U R FA M I L I A L :Il semblerait
notamment plus important en cas
d’ascendant avec une maladie de
Dupuytren.
FACTEUR HISTOLOGIQUE :La plaque
est constituée de tissu collagène
dense. Des calcifications sont présen-
tes radiologiquement dans 30% des
cas et il existe une surexpression du
TGF beta 1 (Transforming Growth
Factor) avec peut-être un rôle des
NOS (Monoxyde d’Azote Synthases)
et des radicaux libres, pouvant
ouvrir dans le futur des nouvelles
voies de recherche thérapeutique.
Par conséquent, la théorie actuelle est
que certains hommes, éventuelle-
ment génétiquement prédisposés,
répondent à un stress albuginéal
mécanique, inaperçu le plus souvent,
par un processus d’hyperc i c a t r i s a-
tion et développent une plaque de
Lapeyronie.
Il existe deux phases. Ala phase pré-
coce, l’homme se présente avec un
nodule au niveau de la verge, et/ou
une érection douloureuse, et/ou
encore une déformation de la verge
en érection. Ala phase tardive, le
nodule perçu est plus dur, la défor-
mation est stable, la douleur a le plus
souvent disparu et une dysfonction
érectile est parfois présente. Le dia-
gnostic est le plus souvent évident
par l’histoire médicale et l’examen
clinique qui s’attachera à palper la ou
les plaques et apprécier l’élasticité
résiduelle de la verge. Il est ensuite
important de retracer la chronologie
de l’histoire psychosexuelle avec la
description de l’érection et de l’éven-
tuelle déformation, la douleur éven-
tuelle et apprécier l’impact psycholo-
gique de la maladie.
La plaque perçue est le plus souvent
V
. CLINIQUE
IV
. PHYSIOP
A
THOLOGIE
III. DEFINITION ET HISTOIRE
NA
TURELLE
II. EPIDEMIOLOGIE
I. INTRODUCTION

17
DÉTAILS
TECHNIQUES
N°2 Septembre 2003
inconnue du patient (38 à 62%), pré-
férentiellement sur la face dorsale.
Les plaques ventrales ou latérales
sont plus rares mais semblent pré-
senter plus de difficultés coitales
pour le patient.
La douleur peut être présente pen-
dant l’érection et le rapport ou même
à l’état flaccide ; elle est absente dans
un tiers des cas et régresse générale-
ment en à peu près 6 mois.
La dysfonction érectile semble exister
dans 30% des cas. Elle est vraisem-
blablement multifactorielle.
1. Difficultés coitales : 56% (début
de la maladie 8%)
2. Psychogènes réactionnel avec
baisse de libido éventuelle
3. Secondaire à la douleur
4. Flaccidité distale par compression
vasculaire ou des bandelettes vas-
culonerveuses dorsales avec un
gland mou.
5. Fuite veno-occlusive par perte de
compliance ou par fuite péri-
plaque ou intraplaque
6. Facteurs de risque associés dans
30% : Diabète,HTA.etc…
L’évolution est en général inférieure
à 2 ans , à début rapide ou progressif,
avec parfois des périodes d’accalmie.
Le patient doit être rassuré le plus
possible et au courant de l’évolutivi-
té probable de façon à mieux gérer
sexuellement et psychologiquement
la maladie.
Inutiles le plus souvent pour le dia-
gnostic, une exception doit être faite
en cas d’évolutivité particulièrement
rapide avec une biopsie pour élimi-
ner un rare diagnostic diff é re n t i e l
( s a rcome des corps caverneux
notamment).
Pour le bilan , deux examens peuvent
être parfois demandés : le pharma-
coechodoppler pénien et l’IRM de
verge avec injection de Gadolinium.
Quant aux clichés à rayons mous et à
la cavernosométrie,ils ont été aban-
donnés .
Le pharmacoechodoppler avec injec -
tion de PGE1 peut permettre d’ap-
précier la localisation, le nombre et la
taille des plaques, l’éventuelle effica-
cité d’un traitement médical, l’étude
de la fuite venoocclusive potentielle,
et de retrouver d’éventuelles collaté-
rales entre l’artère dorsale et l’artère
caverneuse avant une chirurgie de
reconstruction.
L’IRM avec injection de Gadolinium
(Figure 1) peut être utile dans les for-
mes anormalement durables ou réci-
divées pour vérifier la stabilité de la
maladie avant une intervention chi-
rurgicale.
Bien sûr, en cas de dysfonction érecti-
le avec facteurs de risque associés, le
bilan classique sera demandé :
Glycémie à jeun, Bilan lipidique,
Testostéronémie biodisponible.
Les patients avec une coudure légère,
stable et sans dysfonction ére c t i l e
associée doivent être rassurés. Pour
les autres, la maladie de Lapeyronie
reste un problème difficile à gérer
psychologiquement, à traiter médica-
lement et toujours un challenge en
cas de chirurgie. En cas de dysfonc-
tion érectile organique, les traite-
ments classiques (Inhibiteurs de la
phosphodiestérase 5) pourront être
prescrits en association au traitement
spécifique.
Traitement médical :Il est à réserver à
la phase initiale de la maladie et peut
être systémique ou local. Les traite-
ments oraux les plus anciens sont la
VITAMINE E pour ses propriétés
antioxydantes avec une efficacité dis-
cutable (300mg/j 3 mois) et le
P O TASSIUM AMINOBENZOAT E
(POTABA) avec peut-être des résul-
tats plus encourageants (20mg/j 3
mois). Certains traitements oraux
sont plus récents dont le TAMOXI-
FENE pour son action sur le
TGFbeta avec des résultats encoura-
geants notamment sur la douleur
(20mg 2fois/j 3 mois), l’ACETYL-L-
CARNITINE plus récemment (1mg
2 fois/j mois) et la COLCHICINE
avec une possible action sur la syn-
thèse du collagène ( de 0.6 à 2.4 mg/j
3-6 mois).
Les traitements locaux (injections
dans la plaque) ont été également lar-
gement testés ; les stéroides locaux ne
sont plus à priori re c o m m a n d é s
compte tenu d’effets secondaire s
( a t rophie, problème cutané…) et
d’une efficacité hypothétique notam-
ment sur la coudure.
Le V E R A PA M I L (bloqueur des
canaux calciques) à la dose de 10 mg
pendant 2 à 4 semaines (12 injections)
semble être à l’heure actuelle le trai-
tement local initial de référence avec
un effet positif sur la douleur et la
coudure.
L’INTERFERON alpha2b s e m b l e
également avoir des résultats encou-
rageants.
Les autres traitements (Org o t e i n e ,
Collagenase, Hormone parathyro i-
dienne…) ne semblent plus être utili-
sés compte tenu de leur toxicité rela-
tive et inefficacité probable.
D’autres traitements sont à l’étude
avec notamment l’application trans-
dermique utilisant l’énergie élec-
trique (orgoteine, dexamethasone,
lidocaine, verapamil…) avec des
résultats encourageants et également
la LITHOTRITIE EXTRACORPO-
RELLEà priori particulièrement acti-
ve sur le facteur douleur. Certains
auteurs étudieraient l’efficacité de la
lithotritie directe à l’aiguille.
Quant à la Radiothérapie, elle semble
abandonnée ou alors réservée à des
formes douloureuses réfractaire s ,
VII.
TRAITEMENT
VI. EXAMENS P
ARACLINIQUE
Prise en Char
ge Moder
ne de la Maladie
de Lapeyronie

18
DÉTAILS
TECHNIQUES
N°2 Septembre 2003
durables et non opérables. La com-
préhension des mécanismes physio-
pathologiques et notamment le rôle
clé du TGFbeta1 et peut-être aussi
des NOS pourrait permettre d’envi-
sager une nouvelle voie thérapeu-
tique comme semble le montrer des
travaux préliminaires sur le rat.
Il est réservé aux formes sévère s
empêchant ou rendant difficiles les
rapports sexuels. Il ne doit pas être
entrepris avant 12 à 18 mois après le
début de la maladie et avec au moins
6 mois à déformation stable.
BILAN PRÉOPÉRATOIRE :L’importance
de la coudure sera un élément essen-
tiel, apprécié par des photos en érec-
tion, un éventuel pharmacoechodop-
pler (taille et localisation des
plaques). La dysfonction érectile sera
également appréciée, notamment en
cas de non réponse au traitement
pharmacologique, avec alors un
pharmacodoppler systématique pour
apprécier le facteur vasculaire (arté-
riel et/ou veno-occlusif). Le consen-
tement éclairé sera primordial, précis
et complet, notamment sur les atten-
tes et risques de cette chirurgie par-
fois complexe.
ANESTHÉSIE :tout type d’anesthésie
est possible, y compris le bloc pénien.
Néanmoins, l’anesthésie locorégio-
nale ou générale est préférée, notam-
ment pour les procédures longues.
INCISION :L’incision coronale éven-
tuellement associée à une posthecto-
mie (pour éviter le paraphimosis
secondaire) sera le plus souvent choi-
sie. En cas de procédure simple type
Nesbit ou Yachia, une incision ven-
trale et longitudinale pourra être
choisie , et une incision penoscrotale
en cas d’implant pénien.
INDICATION :Il existe 2 types de pro-
cédures : les techniques de réaligne-
ment et les implants péniens.
Les techniques de réalignement sim-
ple ne doivent être envisagées qu’en
l’absence de dysfonction ére c t i l e
o rganique ; la pre m i è re solution
consiste à raccourcir le côté convexe.
Nesbit a décrit en premier la tech-
nique, ensuite popularisée par Pryor
et Fitzpatrick (Figure 2).
Elle consiste dans l’excision d’une
ellipse de tunique albuginéale du
côté opposé à la coudure avec suture
à points non résorbables. Les résul-
tats sont très satisfaisants avec un
taux de succès de 82%. Les complica-
tions rapportées sont la dysfonction
érectile, l’hématome, la récidive ou
correction insuffisante, le granulome
sur fil, la dysesthésie du gland, le
phimosis et la plaie urethrale…
Quant au raccourcissement, il semble
quasi systématique et le patient doit
en être prévenu.
D’autres techniques modifiées ont vu
le jour avec notamment la technique
de YACHIA (Figure 3). consistant en
une ou plusieurs incisions longitudi-
nales du côté opposé à la coudure
avec fermeture transversale à points
non résorbables. La simple plicature
controlatérale, popularisée par Essed
et Schro e d e r, semble présenter un
fort taux de rechute même en cas de
fil non résorbable ; une éventuelle
alternative est la plicature sans ten-
sion, dite technique des 16 nœuds,
popularisée par Lue et Gholami
(Figure 4).
Ces techniques de réalignement sim-
ple nécessitent, outre l’absence de
dysfonction érectile organique, une
verge de longueur suffisante et/ou
une coudure en général inférieure à
60°.
Les techniques de réalignement par
incision et/ou excision de la plaque
nécessitent un patch pour couvrir le
defect. Elles sont réservées en cas de
coudure sévère (>60°), déformation
complexe ou longueur de verg e
insuffisante. De plus, elle nécessite
un chiru rgien expérimenté.
Initialement avec une greffe de peau
libre, elle fût ensuite testée avec diffé-
rents biomatériaux autologues ou
h é t é rologues (fascia temporalis,
dure-mère, tunique vaginale, péricar-
de, albuginée, veine saphène et sous-
muqueuse intestinale porcine, colla-
gene porcin…) mais aussi synthé-
tiques (polyester, polytetrafluoro e-
thylene…) avec des résultats variés.
L’incision simple de la plaque semble
être préférable à l’excision complète
pour faciliter le geste et diminuer les
risques de complications.
Montorsi et Lue (Figure 5) décrivent
une incision en H avec patch veineux
saphène interne et des résultats
encourageants (75 à 95%) (Figure 6)
ainsi que des taux de complications
faibles , notamment la dysfonction
érectile de 5 à 13%.
Les autres matériaux utilisés avec des
résultats intéressants sont la sous-
muqueuse intestinale porcine et le
pericarde humain. Le suivi post-opé-
r a t o i re semble particulière m e n t
important, avec la recommandation
selon certains auteurs d’effectuer des
injections intracaverneuses précoces,
d’utiliser de façon quotidienne un
vacuum et de prendre un traitement
médical à base d’Héparine de bas
poids moléculaire puis d’antiaggré-
gants plaquettaires pendant une
période de 3 mois, surtout en l’ab-
sence de récupération rapide d’érec-
tions spontanées ou reflexes, et dans
le but d’éviter une rétraction secon-
daire du patch avec récidive.
Quant à l’implant pénien, il est à
réserver aux formes sévères avec
dysfonction érectile organique ne
répondant pas à un traitement médi-
cal, ou aux formes récidivées com-
plexes. Les implants péniens gonfla-
bles seront préférés (type A M S
700CX) éventuellement associés à
une corporoplastie.
Wilson a décrit et popularisé le
«modeling » consistant dans le réali-
gnement manuel peropératoire après
implantation prothétique, pour évi-
ter la corporoplastie et diminuer les
risques notamment infectieux.
VIII.
TRAITEMENT
CHIRURGICAL
Prise en Char
ge Moder
ne de la Maladie
de Lapeyronie

19
DÉTAILS
TECHNIQUES
N°2 Septembre 2003
Prise en Char
ge Moder
ne de la Maladie
de Lapeyronie
Figure 2 : Technique de Nesbit : schéma
Figure 3 : Technique de Yachia : schéma
Figure 5 : Technique de l’Incision-Patch veineux saphène
interne selon Tom Lue: schéma
Figure 1 : IRM : plaque distale
Figure 4 : Technique de Lue et Gholami des 16 nœuds :
schéma

20
DÉTAILS
TECHNIQUES
N°2 Septembre 2003
Prise en Char
ge Moder
ne de la Maladie
de Lapeyronie
Figure 8 : Repérage de l’Incision en H centrée sur la plaque
après isolement des bandelettes vasculonerveuses dorsa -
les
Figure 7 : Après incision:mesures de la zone à pat -
Figure 9 : Patch veineux saphène interne préparé
Figure 10 : Test érection artificielle après suture du
patch
Fiugre 6Incision en H
 6
6
1
/
6
100%