LES FONDAMENTAUX

LES
FONDAMENTAUX
11

Qu'est-ce que l'axe
« cerveau-intestin » ?
Le concept d'axe « cerveau-intestin » est né progressivement de la
connaissance des voies nerveuses qui contrôlent les fonctions
digestives et de la description de la très riche innervation de la
paroi digestive. L'ensemble de ces voies nerveuses constitue un
réseau intégré en deux contingents principaux : les voies ner-
veuses provenant du tractus digestif et celles, issues du SNC, qui
contrôlent les fonctions sécrétoires et motrices. L'axe cerveau-
intestin est organisé en deux niveaux périphériques : le système
nerveux entérique ou plexus myentérique qui est aussi appelé
« innervation intrinsèque », localisé dans la paroi digestive, et les
« nerfs extrinsèques » qui relient le plexus myentérique à la moelle
épinière et au SNC. Ces voies périphériques comprennent des
ganglions sympathiques et des voies parasympathiques, notam-
ment les nerfs vagues et les voies parasympathiques lombo-
sacrées (Fig. 1). Au niveau de la paroi du tractus digestif, le plexus
myentérique est organisé comme un réseau qui constitue le « cer-
veau intestinal » ; il contient autant de neurones que la moelle
épinière, dont la plupart sont des neurones afférents, donc sensi-
tifs. Dans ce réseau, des interneurones établissent des connexions
entre neurones afférents et efférents, ainsi qu'entre neurones de
différents étages. Le plexus myentérique est donc le premier
niveau d'intégration des sensations digestives, reconnaissant la
taille, la vitesse et la direction des mouvements des particules
alimentaires.
En fonction des segments digestifs, ces fibres nerveuses
sympathiques et parasympathiques se croisent et combinent leurs
effets, permettant une régulation fine des fonctions digestives et
LES DOULEURS ABDOMINALES EN QUESTIONS
13

leur adaptation aux différentes situations physiologiques ou
pathologiques. Contrairement à la conception classique d'un sys-
tème stimulateur et d'un système inhibiteur, les études les plus
récentes ont montré que le contrôle de l'axe cerveau-intestin inté-
grait différents niveaux de contrôle, qui organisent les fonctions
digestives depuis les réflexes locaux les plus élémentaires jusqu'à
l'intégration de processus complexes comme la faim, la défécation
et surtout la perception douloureuse au niveau des hémisphères
cérébraux, donc de la conscience. Les afférences digestives se dis-
tribuent en deux contingents principaux : les afférences vagales qui
proviennent de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum, de l'in-
testin grêle et du côlon ascendant ; et au niveau de l'intestin, les
LES DOULEURS ABDOMINALES EN QUESTIONS
14
Fig. 1 – Anatomie de l'axe cerveau-intestin
Distribution anatomique des afférences d'origine digestive, en fonction des
territoires innervés et du cheminement des neurones au sein des voies
parasympathiques et sympathiques.

afférences digestives sympathiques qui sont situées dans les nerfs
splanchniques (tractus digestif supérieur) et dans les nerfs hypo-
gastriques (tractus bas), projetant respectivement sur les ganglions
mésentérique et hypogastrique et sur les ganglions prévertébraux.
De là, ils projettent dans la moelle épinière où des neurones affé-
rents secondaires atteignent le noyau du tractus solitaire (Fig. 1).
Enfin, les sensations proprioceptives provenant de la sphère ano-
rectale sont véhiculées par les nerfs parasympathiques des plexus
honteux vers les ganglions prévertébraux, la moelle épinière et le
thalamus. Ces voies afférentes participent au contrôle de la défé-
cation et de la continence et reconnaissent la nature du contenu
du rectum.
Les voies nerveuses efférentes qui contrôlent les fonctions
digestives empruntent les mêmes structures anatomiques que les
voies afférentes. Au niveau de l'intestin, elles se distribuent aux
cellules effectrices, les couches musculaires, les vaisseaux et les
glandes, à partir des plexus d'Auerbach et de Meissner (plexus
myentérique). Comme les voies afférentes, elles se divisent en
deux contingents, les fibres sympathiques, originaires de la moelle
thoraco-lombaire et les fibres parasympathiques, procédant par les
nerfs vagues jusqu'au tractus digestif haut (œsophage, estomac,
duodénum, intestin grêle) et par les nerfs honteux et les plexus pel-
viens, vers la partie distale du côlon, le rectum et l'anus.
Chaque niveau de contrôle de l'axe cerveau-intestin régule
certaines fonctions digestives de manière autonome et, par
ailleurs, étant en relation avec les étages sus- et sous-jacents, par-
ticipe à l'intégration de ces fonctions. Ainsi, le réflexe péristal-
tique est-il largement organisé de manière autonome par le plexus
myentérique à travers des réflexes d'axones ne mettant en jeu
que quelques neurones intra-muraux (Fig. 2). Lorsqu'un segment
intestinal est isolé, un réflexe péristaltique est engendré par l'ac-
tivité du plexus myentérique. En revanche, lorsque ce même seg-
LES DOULEURS ABDOMINALES EN QUESTIONS
15

ment intestinal est anastomosé en sens inverse à l'endroit où il
avait été prélevé, un réflexe péristaltique coordonné y réapparaît
après une courte période d'adaptation. Le plexus myentérique
agit donc de manière autonome, mais lorsque l'organe ou le seg-
ment est inclus dans la continuité du tractus digestif, il subit l'in-
fluence des segments adjacents et se place donc sous le contrôle
de niveaux de régulations extrinsèques, parce que situés en dehors
de la paroi digestive : les ganglions vagaux ou les ganglions sym-
pathiques mésentériques, par exemple.
En situation physiologique, la plupart des informations
issues du tractus digestif ne sont pas intégrées par les centres cor-
ticaux et les réponses adaptatives sont engendrées par des réflexes,
inconscients, tels les réflexes vago-vagaux. L'axe cerveau-intestin
coordonne également les fonctions digestives entre différents seg-
LES DOULEURS ABDOMINALES EN QUESTIONS
16
Fig. 2 – Organisation du réflexe péristaltique
Schéma des neurones du plexus myentérique intervenant dans le contrôle du
réflexe péristaltique, mettant en jeu un neurone sensitif, relié par des interneurones
à un neurone stimulateur en amont du bol alimentaire et un neurone inhibiteur en
aval. Il faut noter la présence de plusieurs neurotransmetteurs dans les terminaisons
de ces neurones, tant stimulateurs qu'inhibiteurs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%

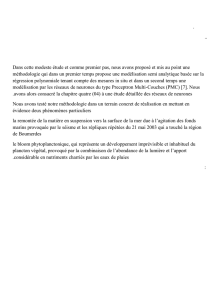


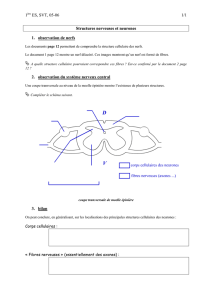
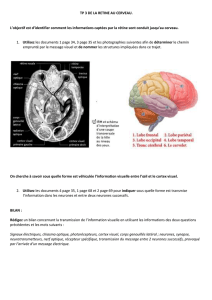
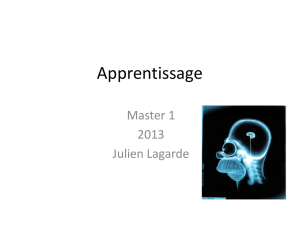
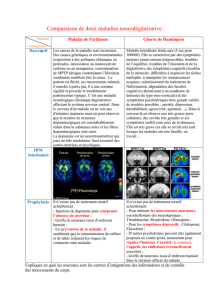
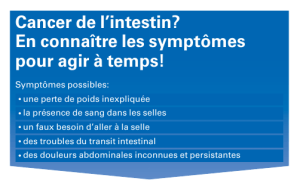
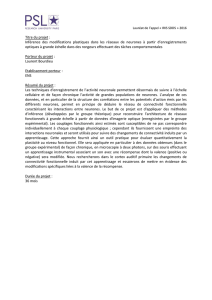
![Découverte d un nouveau centre cérébr[...]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001261824_1-044b689d1e2faad91148811640c2eb34-300x300.png)
