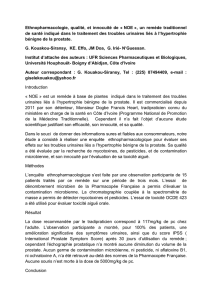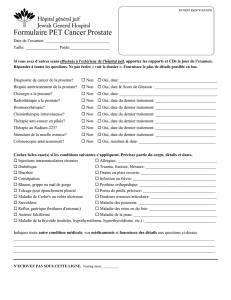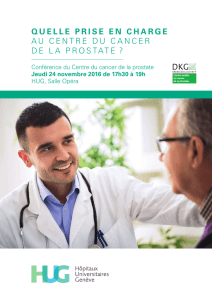Répercussions de l`hypertrophie bénigne de la prostate

Progrès en Urologie (1997), 7, 63-68
63
Répercussions de l’hypertrophie bénigne de la prostate
sur le confort de vie des patients
Christian COULANGE(1), F.A. ALLAERT(2) , Madeleine TORAN-PADOVANNI (3)
(1) Service d’Urologie, Hôpital Salvator, Marseille, France,
(2) Département de biostatistique et informatique médicale, CHRU du Bocage, Dijon, France,
(3) Conseiller médical, Laboratoires Debat, Garches, France
RESUME
B u t s : Evaluer les conséquences sociales de l’hy-
p e rt rophie bénigne de la prostate en fonction des
éléments du score international des symptômes
p rostatiques et de l’âge des patients.
M é t h o d e s : Il s’agit d’une étude transversale de
type épidémiologique : 10 028 patients âgés de plus
de 50 ans atteints de troubles prostatiques se pré-
sentant à la consultation de 2 143 médecins.
L’analyse statistique décrira pour l’ensemble de la
population les troubles prostatiques et leurs réper-
cussions sur la vie professionnelle, associative, cul-
t u relle, sexuelle et familiale ainsi que leurs consé-
quences socio-économiques. Les comparaisons
s e ront conduites par des tests du Chi2 pour les
variables qualitatives et par des analyses de
variance pour les variables quantitatives.
R é s u l t a t s : Les troubles prostatiques provoquent une
gêne dans le travail chez 31% des patients en activité
(2 218). 7% réduisent leurs sorties, 32% réduisent
leurs voyages et 22% éprouvent des difficultés dans
leur vie sociale en raison de leur existence. 28% des
patients éprouvent des difficultés sexuelles. L e s
t roubles prostatiques retentissent sur la forme phy-
sique ou psychique de 56% des patients.
C o n c l u s i o n : L’ h y p e rt rophie bénigne de la pro s t a-
te entraîne une altération de la qualité de vie glo-
bale des patients. L’analyse multifactorielle, inté-
grant l’ensemble des symptômes prostatiques et le
facteur âge, montre que statistiquement ce sont les
signes irritatifs qui apparaissent comme des fac-
teurs indépendants significatifs.
Mots clés : HBP, enquête épidémiologique multicentrique,
répercussions.
Progrès en Urologie (1997), 7, 63-68.
Le pourcentage de patients présentant un prostatisme
modéré à sévère (score international des symptômes,
IPSS supérieur à 7) varierait de 17% chez les quinqua-
génaires à 29% chez les septuagénaires [2] mais,
comme le montrent les travaux de référence [1, 4], la
majeure partie de ces patients ne consultent pas et res-
tent encore aujourd’hui sans traitement. Les motiva-
tions de ce silence résident à la fois dans la gêne qu’ils
éprouvent à aborder ce sujet avec les médecins, et dans
une grande passivité vis-à-vis des symptômes qu’ils
finissent par considérer comme une fatalité, comme
une manifestation inéluctable et normale du vieillisse-
ment.
Cette passivité a d’autres conséquences qui jusqu’à
présent ont été peu évoquées : le désinvestissement
social du sujet qui va peu à peu d’isoler physiquement
et intellectuellement en raison de ces troubles.
Ne pas dépister ni traiter l’hypertrophie bénigne de la
prostate peut faire courir au patient non seulement le
risque des complications habituelles de la sphère uri-
naire mais également celui de perturbations dans sa vie
familiale et sociale susceptibles de retentir sur son
vieillissement intellectuel et physique.
C’est ce risque des répercussions professionnelles,
intimes et familiales de l’hypertrophie de la prostate
que cette enquête cherche à évaluer en fonction des élé-
ments du Score International des Symptômes
Prostatiques.
MATERIEL ET METHODES
D’avril à décembre 1993, 2 143 médecins généralistes
ont accepté d’inclure dans l’enquête les cinq premiers
patients atteints de troubles prostatiques modérés ou
sévères se présentant à la consultation, dans le cadre
d’un premier dépistage ou du suivi habituel de leur
affection. 10 028 patients ont été inclus au terme de
l’étude. Le questionnaire permet de décrire :
• leur âge, leurs caractéristiques morphométriques, leur
statut matrimonial et leur profession,
• le Score International des Symptômes Prostatiques
développé par l’Association Américaine d’Urologie et
adopté par l’OMS.
Manuscrit reçu : décembre 1996, accepté : janvier 1997.
Adresse pour correspondance : Pr. C. Coulange, Chirurgie Urologique, Hôpital
Salvator, 249, Bd. de Sainte-Marguerite, 13274 Marseille Cedex 9.

64
Pour chaque question, une réponse de gravité croissan-
te de 0 à 5 du symptôme correspondant est donnée
aboutissant au total à un score de 0 à 35 (asymptoma-
tique à très symptomatique). A l’heure actuelle, et bien
que les seuils standardisés n’aient pas encore été établis
de manière définitive, un consensus se dégage pour que
les patients puissent être classés de la manière
suivante :
- 0 à 7 : peu symptomatiques,
- 8 à 19 : modérément symptomatiques,
- 20 à 35 : symptômes sévères.
Une question complémentaire sur le confort de vie des
patients, cotée également de 0 à 5 (très satisfait à très
ennuyé), lui était adjointe.
• les répercussions des troubles prostatiques sur la vie
sociale, professionnelle, intime et familiale des patients
au travers de questions pragmatiques compréhensibles
par tous, testées au préalable, et reflétant le vécu quoti-
dien de cette affection,
• les modalités de la prise en charge de l’hypertrophie
bénigne de la prostate.
Méthode statistique
L’étude de l’influence de l’I-PSS et de ses différents
composants cliniques sur l’altération du confort de vie
des patients fait appel à des analyses de régression
simples puis à un modèle de régression multiple dans
lequel sont introduits les sept symptômes pris en comp-
te dans l’I-PSS, mais aussi l’âge des patients afin de
mieux cerner leur rôle propre indépendamment du fac-
teur vieillissement.
L’étude de l’influence de l’I-PSS et de ses diff é r e n t s
composants cliniques sur la vie professionnelle, sociale,
familiale, intime et quotidienne des patients est conduite
selon le même principe mais utilise des tests du Chi2 puis
un modèle de régression logistique en raison du caractè-
re qualitatif à deux classes des variables étudiées.
En raison du nombre important de patients impliqués
dans l’analyse et du nombre de tests statistiques utili-
sés, le seuil de significativité est fixé à α= 0,01.
Le traitement statistique a été réalisé avec le logiciel
SAS sur des stations de travail SUN 3/80 dans le
Centre d’Evaluation et de Normalisation des biotech-
nologies du CHRU du Bocage de Dijon dans le respect
des exigences de la loi du 6 janvier 1978 relative aux
fichiers, à l’informatique et aux libertés.
Description clinique de la population
Les résultats portent sur 10 028 hommes vus en consul-
tation par 2 143 médecins généralistes pour des
troubles prostatiques.
Leur âge moyen est de 67 ± 8 ans et leur poids de 76,5
± 10,5 kg pour une taille de 171,6 ± 5,9 cm. 5,1% sont
célibataires, 80% sont mariés ou vivent en concubina-
ge, 3,3% sont divorcés et 11,7% sont veufs. 75,4% ont
de 1 à 3 enfants et 13,8% plus de trois. 34,6% ont des
antécédents de prostatisme connus.
Chez 50% des patients les différents signes
cliniques : miction incomplète (Figure 1), besoins
répétés (Figure 2), difficulté à retenir les urines (Figure
3), nécessité de forcer pour uriner (Figure 4), et levers
nocturnes (Figure 5) surviennent au moins une fois sur
trois (cotation 2) à l’exception de l’intermittence du jet
(Figure 6), qui pourrait être une symptomatologie
moins fréquente ne se manifestant qu’une fois sur 5
(cotation 1) et de la diminution de la force du jet
(Figure 7), qui survient une fois sur deux (cotation 3).
Le score international qui correspond à la somme des
cotations des différents signes cliniques est de 15,6 ±
6,3 ce qui correspond à des troubles d’intensité modé-
rée. Ils sont présents depuis 40 ± 37 mois en moyenne
(Min = 1, Max = 240) et se sont aggravés dans 57,1%
des cas malgré un traitement antérieur présent chez
53,3% d’entre eux.
RESULTATS
61% des patients déclarent qu’ils seraient ennuyés s’ils
devaient vivre le restant de leur vie avec les troubles
prostatiques qu’ils éprouvent au moment de la consul-
tation. Cette altération du confort de vie apparaît signi-
ficativement corrélée à la fréquence de survenue des
différents symptômes prostatiques considérés indépen-
damment l’un de l’autre et au score international qui
correspond à leur somme arithmétique.
Par contre, une analyse de corrélation multiple prenant
en compte l’ensemble des signes prostatiques et l’âge
des patients qui est un facteur important d’altération du
confort de vie montre :
- l’absence de rôle propre de la diminution du débit
urinaire et de l’existence d’un jet intermittent dans l’al-
tération du confort de vie,
- la contribution significative, par ordre d’importance, de
la fréquence du nombre de levers nocturnes, de l’existen-
ce de besoins répétés, de la sensation d’une miction
incomplète, de la difficulté à retenir ses urines et de la
nécessité d’un effort mictionnel qui est le seul signe obs-
tructif apparaissant significatif dans cette analyse.
Cette prédominance des signes irritatifs en terme de
fréquence dans l’explication de l’altération du confort
de vie se retrouve de manière très nette sur le plan qua-
litatif. Cette symptomatologie représente à elle seule la
majorité des symptômes jugés comme les plus invali-
dants par le patient :

65
Figure 1. Sensation de miction incomplète.
Figure 2. Besoin fréquent d’uriner.
Figure 4. Dysurie d’attente.
Figure 3. Miction impérieuse.
Figure 5. Pollakiurie nocturne. Figure 6. Interruption du jet.

Répercussions sur la vie professionnelle
L’enquête décrit et analyse les répercussions de l’hy-
pertrophie bénigne de la prostate sur la vie profession-
nelle chez les patients en activité et rétrospectivement
chez ceux inactifs mais dont les troubles sont survenus
avant l’âge de la retraite.
31% des 2 218 patients en activité estiment que leurs
troubles prostatiques nuisent à leur vie professionnelle
en provoquant une gêne dans le travail et 20% les res-
sentent comme une gêne dans les relations qu’ils entre-
tiennent avec leurs collègues.
Les tests du Chi2 montrent une liaison significative du
score de l’I-PSS et de chacun des symptômes prosta-
tiques sur l’existence de ces gênes professionnelles set
relationnelles mais la régression logistique permet de
montrer que leur fréquence de survenue est essentielle-
ment expliquée par les signes irritatifs.
Patients en activité
Cette prédominance des signes irritatifs est également
retrouvée sur le plan qualitatif où cette symptomatolo-
gie représente à elle seule 78% des symptômes consi-
dérés comme les plus invalidants par les patients en
activité professionnelle.
Patients en retraite
Chez les patients retraités, dont les troubles sont appa-
rus avant la fin de leur activité professionnelle, on note
qu’avec le recul, l’importance des répercussions pro-
fessionnelles s’est relativisée (12% contre 33%) et
seuls sans doute ceux chez qui ces conséquences ont été
majeures en font état (10%).
Le souvenir de la gêne dans les relations profession-
nelles perdure par contre pratiquement inchangé.
Répercussions sur la vie sociale
61,5% des patients n’ont pas d’activité sociale./ C e t t e
absence ne peut être uniquement rapportée à l’âge et
aux troubles prostatiques mais ces derniers y contri-
buent comme en témoignent 37% des patients qui ont
réduit ou supprimé leurs sorties et/ou qui ont réduit ou
supprimé leurs voyages et 22% qui déclarent avoir
des problèmes relationnels en raison de leur existen-
c e .
Les tests du Chi2 montrent l’influence significative de
chacun des symptômes prostatiques et du score de
l’IPSS sur l’absence d’activité sociale, les réductions
des sorties et des voyages ou la gêne dans les relations
amicales.
La régression logistique montre que l’absence de vie
sociale s’explique essentiellement par l’existence de
besoins répétés et par la fréquence des levers noc-
turnes. Pour les réductions des sorties et des voyages,
ainsi que pour la gêne dans les relations amicales, tous
les symptômes paraissent jouer un rôle à l’exception de
la diminution du débit urinaire. On note cependant que
si les signes obstructifs sont ici presque aussi présents
que les signes irritatifs, les trois premiers par ordre
d’importance correspondent à la trilogie irritative habi-
66
Symptômes Nombre de Pourcentage
de patients patients
Pollakiurie 4 202 46,1%
nocturne
Polakiurie 1 339 14,7%
diurne
Impériosités 1 827 20,1%
Total 7 368 81%
Figure 7. Diminution de la force du jet.
Figure 8. Appréciation sur le confort de vie lié aux symp -
tômes.

tuelle dans cette étude : fréquence des levers nocturnes
(Figure 5), sensation de vidange vésicale incomplète
(Figure 1) et impériosité mictionnelle.
Répercussions sur la vie intime et familiale
Les troubles prostatiques retentissent sur la vie de
couple de 28,2% des patients dont 90,6% éprouvent
des difficultés sexuelles (importance : 34,3%, modé-
rées : 56,3%) et 19,5% font chambre à part.
L’ensemble des symptômes prostatiques et l’IPSS
apparaissent significativement corrélés aux répercus-
sions sur la vie de couple, la vie sexuelle et le fait de
faire chambre à part, mais les analyses de régression
logistiques montrent que les répercussions sur la vie de
couple s’expliquent essentiellement par la trilogie des
signes irritatifs.
Répercussions sur la vie quotidienne
Les troubles prostatiques retentissent sur la forme phy-
sique ou psychique de 56% des patients et conduisent
24% d’entre eux à prendre des précautions avant de
sortir, 45,7% à réduire la durée de leurs déplacements
et 67,4% à prendre des précautions le soir avant de se
coucher.
Chacun des signes prostatiques et l’IPSS apparaissent
statistiquement corrélés à l’ensemble des éléments du
retentissement quotidien étudiés et les régressions
logistiques montrent la contribution de tous les symp-
tômes à ce retentissement quotidien à l’exception de la
diminution du débit urinaire. On note cependant le plus
fort poids des signes irritatifs qui, comme tout au long
de l’étude, constituent les trois premiers signes expli-
quant les conséquences psychosociales de l’hypertro-
phie de la prostate.
L’HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA
PROSTATE EN PRATIQUE
Rappelons que 76% des diagnostics d’hypertrophie de
la prostate reposent sur l’association interrogatoire-
toucher rectal-échographie.
Ce n’est que dans 50% des cas que le malade a abordé
directement ses troubles lors de la consultation. Ces
troubles sont essentiellement abordés en termes uri-
naires (46,6%), de réveils nocturnes (15,6%) ou les
deux (14%) alors que la plus grande crainte des patients
concerne le cancer (52%) et l’impuissance (19%).
La prise en charge proposés à ces patients répond glo-
balement à leurs attentes mais prend en compte la
nécessité d’explorer cette affection afin d’être sûr de
son diagnostic et notamment de sa bénignité.
L’attente thérapeutique des patients est essentiellement
représentée par la prescription d’un traitement médical
(46%), d’examens complémentaires (14%) ou les deux
à la fois (19,5%). Le traitement chirurgical n’est cité
que dans 4,5% des cas ce qui est à mettre en parallèle
sans doute avec les 46,8% des patients qui craignent la
survenue d’une impuissance après chirurgie.
Sur le plan de l’information, un effort reste à faire avec
64,1% des patients (soit, par extrapolation, environ 2
millions d’individus), jugés par les médecins mal ou
pas informés du tout.
Quant à l’évaluation économique de cette affection, la
présente étude ne fait que révéler le besoin d’un travail
complémentaire dans ce domaine : 68,5% des méde-
cins reconnaissent ne pas savoir quel est le poste de
dépense le plus onéreux entre la chirurgie, le traitement
médical et les explorations complémentaires.
DISCUSSION
Si des enquêtes de prévalence sur les troubles miction-
nels liés à l’hypertrophie bénigne de la prostate ont
déjà été rapportées, l’impact de l’hypertrophie bénigne
de la prostate sur les activités de la vie quotidienne est
un nouveau sujet de préoccupation.
Notre enquête montre que l’hypertrophie bénigne de la
prostate retentit sur le confort de vie des patients
(Figure 8) : 61% seraient plutôt ennuyés si ces symp-
tômes persistaient.
L’analyse statistique des résultats montre une relation
entre cette altération du confort de vie et la survenue de
certains symptômes. Les plus invalidants sont la fré-
quence des levers nocturnes, l’existence de besoins
impérieux, la sensation de miction incomplète, la diffi-
culté à retenir ses urines et la nécessité d’un effort pour
uriner, seul signe obstructif significativement relié à
l’altération du confort de vie.
Cette altération paraît nettement en rapport avec les
signes irritatifs de l’hypertrophie bénigne de la prosta-
te, ce que corrobore l’interrogatoire des patients sur les
symptômes qui les gêne le plus : 46% se plaignent de
pollakiurie nocturne, 20% d’impériosités et 15% de
pollakiurie diurne.
La prévalence élevée des symptômes urinaires avait
déjà ét é rapportée [4]. Dans une étude plus récente [5],
plus des 3/4 des sujets (77%) ont rapporté au moins un
symptôme gênant, près de la moitié (45%) s’est plaint
d’au moins d’au moins quatre symptômes urinaires
gênants durant le mois écoulé. Les résultats de cette
étude concordent avec ceux d’un travail américain [3]
récent portant sur 115 hommes atteints d’HBP. 53%
d’entre eux se plaignent essentiellement de signes irri-
tatifs. Deux études françaises [6, 7] donnent des résul-
tats similaires.
67
 6
6
1
/
6
100%