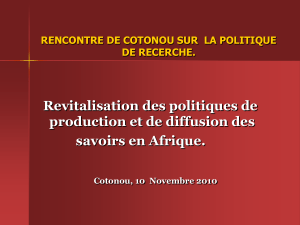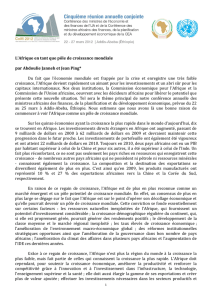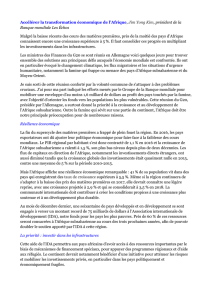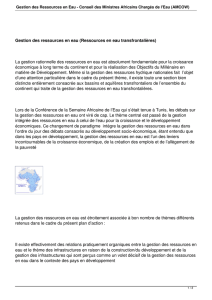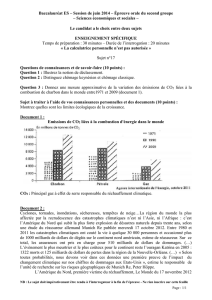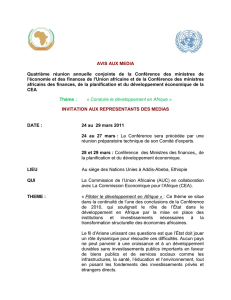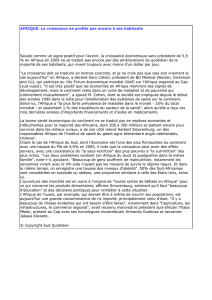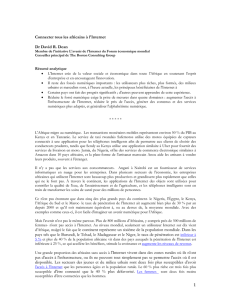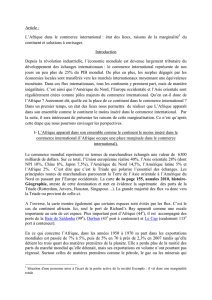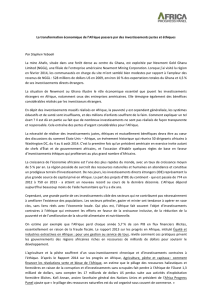La transformation économique pour le développement de l`Afrique

La transformation économique
pour le développement de l’Afrique
Par
Nations Unies, Commission économique pour l’Afrique
Division de la Politique Macro-économique
Réunion du C-10, Avril 2013
Washington D.C.

Table des Matières
Introduction 3
Les arguments militant en faveur de la promotion
de la transformation économique et structurelle en
Afrique 4
Pourquoi l’Afrique ne s’est pas transformée ? 5
Opportunités de transformation économique 5
Concrétiser le programme de transformation 6
Conclusions 15
Bibliographie 15

3
Introduction
Les récentes performances économiques de l’Afrique ont suscité un regain d’optimisme quant aux
perspectives de développement du continent. On ne parle plus de l’Afrique comme le continent sans
espoir mais de l’Afrique en tant que pôle de croissance émergent et marché frontière dynamique. Mais
dans quelle mesure la création de la croissance du continent s’est-elle accompagnée de création d’emplois
ou de structures économiques diversiées et intégrées à même de résister aux chocs extérieurs ? Dans
le présent document, on évalue comment l’Afrique peut, à partir de ses récents succès économiques
s’engager sur une trajectoire de développement plus inclusive et durable par la transformation structurelle
et économique. À cette n, après avoir identié les principaux éléments de la transformation économique,
expliqué pourquoi elle est essentielle pour le processus de développement de l’Afrique, on examine les
possibilités qui s’orent ainsi que les principaux moteurs d’un programme de transformation réussie.
Principaux éléments de la transformation économique
La transformation économique est associée à un changement radical de la structure de l’économie et
de ses moteurs de croissance et de développement. Elle a nécessairement les implications suivantes
: une réallocation de ressources des secteurs et activités moins productifs à des secteurs et activités
plus productifs ; un accroissement de la contribution relative du secteur manufacturier au PIB ; une
diminution de la part de l’emploi agricole dans l’emploi total ; un redéploiement de l’activité économique
des zones rurales vers les zones urbaines ; l’essor d’une économie industrielle et des services moderne ;
une transition démographique assurant le passage de taux de croissance et de mortalité élevés (fréquents
dans les zones sous-développés et dans les zones rurales) à de faibles taux de croissance et de mortalité
(associés à de meilleures normes sanitaires dans les régions développées et dans les régions urbaines), et
une urbanisation croissante.
Il importe toutefois de replacer les éléments énumérés plus haut dans leur contexte. Traditionnellement,
l’urbanisation associée à une transformation économique résulte d’un plus grand degré de transformation
structurelle qui entraîne une migration de la main-d’œuvre du secteur agricole primaire rural vers le
secteur industriel secondaire urbain et le secteur tertiaire des services.
L’expérience de l’Afrique en matière d’urbanisation peut être décrite comme une urbanisation ayant
mal tourné, qui est due à des forces autres que celles mentionnées plus haut. Elle est caractérisée par
une prolifération de taudis dans les zones urbaines en raison de l’incapacité de l’infrastructure urbaine
à faire face à l’aux d’immigrants ruraux. En outre, un processus de transformation durable ne devrait
pas s’accompagner de taux d’inégalité élevés et d’une mauvaise qualité des services sociaux car le
développement du capital humain, et l’inclusion sociale sont essentiels à la réussite du programme de
transformation. En plus de cela, le programme de transformation doit ecacement utiliser la population
jeune de l’Afrique. Finalement, une économie transformée doit être résiliente aux risques liés au climat.
Ainsi, un programme de transformation ecace doit-il également comprendre les éléments suivants : la
transformation des régions rurales en des centres dynamiques d’agrobusiness et d’activité industrielle ; la
matérialisation de l’explosion démographique de la jeunesse de l’Afrique en dividende démographique;
l’accès à des services sociaux qui répondent aux normes minimales de qualité quelque soit le lieu ; la
réduction de l’inégalité – entre les zones et entre les sexes; et la progression vers une trajectoire de
croissance verte inclusive.

4
Les arguments militant en faveur de la promotion
de la transformation économique et structurelle en
Afrique
Pourquoi transformer ?
Au cours de la décennie passée l’Afrique a connu une croissance sans précédent et a remarquablement
résisté à la crise économique mondiale. Le continent s’est classé comme la deuxième région à la croissance
la plus rapide du monde derrière l’Asie de l’Est (CEA, 2012). Entre 2000 et 2009, 11 pays africains
ont enregistré un taux de croissance égal ou supérieur à 7 %, considéré susant pour qu’ils réalisent un
doublement de leur économie dans 10 ans. Se chirant à 2 000 milliards de dollars des États-Unis, le
PIB collectif de l’Afrique est aujourd’hui à peu près égal à celui du Brésil ou de la Russie. En dépit de la
crise de la dette souveraine en Europe et du ralentissement de la croissance en Amérique du Nord et en
Chine, les perspectives de croissance à moyen terme de l’Afrique qui, selon les projections, seront de 4,8
% en 2013 et de 5,1 % en 2014, demeurent fortes. Le climat des aaires sur le continent s’est également
amélioré et on note l’émergence d’une classe moyenne qui se développe. En 2010, elle comprenait, d’après
les estimations, 355 millions de personnes, soit 30 % de la population totale. Les indicateurs sociaux se
sont également améliorés comme l’attestent les résultats remarquables obtenus en ce qui concerne la
scolarisation primaire, la parité entre les sexes dans l’éducation, la baisse des taux de mortalité maternelle
et infantile, la réduction des taux de prévalence et d’incidence du VIH/sida, les améliorations de la
gouvernance et des transitions démocratiques moins violentes.
Cependant, lorsqu’on procède à une évaluation minutieuse des économies de la région, les caractéristiques
suivantes se révèlent : en dehors de l’agriculture, les économies sont pour la plupart tirées par les
ressources naturelles et /ou les produits de base ; le secteur manufacturier reste à l’état embryonnaire, ce
qui limite les gains sur le plan de l’emploi qu’aurait pu rapporter la transformation des produits de base
; la productivité agricole reste faible, se situant à 56 % de la moyenne mondiale et est caractérisée par
une application limitée des technologies modernes (BAD, 2011) ; le secteur rural est fortement sous-
développé, entraînant un exode rural massif qui a transformé les zones urbaines en refuges pour habitants
de taudis ; les taux de naissance et de décès sont élevés ; les taux de prévalence du VIH, de mortalité
maternelle et infantile sont les plus élevés au monde et les programmes de protection sociale sont
sous-développés et sous-nancés, ce qui a pour eet d’aggraver la vulnérabilité des personnes âgées des
personnes handicapées ainsi que de la main-d’œuvre en chômage et sous-employée.
De fait, la croissance de l’Afrique peut être qualiée comme étant largement non inclusive étant donné sa
contribution limitée à la création d’emplois et à l’amélioration générale des niveaux de vie des populations
(CEA, 2011). En fait, en dépit d’une baisse du nombre absolu de personnes pauvres et d’une diminution
de cinq points de pourcentage du taux de pauvreté entre 2005 et 2008, le continent abrite la plus forte
population de pauvres dans le monde, le taux de pauvreté étant de 47,25 % en 2008 (en prenant 1,25
dollar par jour comme seuil).
Ainsi l’Afrique a-t-elle besoin de transformer ses économies pour créer de la richesse, réduire la pauvreté,
réduire au minimum les inégalités, renforcer ses capacités de production, améliorer les conditions
sociales de ses populations et réaliser le développement durable. Si elle réalise sa transformation
économique, l’Afrique optimisera l’utilisation de ses ressources naturelles qui sont épuisables et même
non renouvelables pour certaines. En outre, dans la mesure où la transformation structurelle favorise le

5
développement industriel, elle élargit la gamme des moteurs de croissance et développe la résilience aux
chocs sur les prix des produits de base.
Pourquoi l’Afrique ne s’est pas transformée ?
La capacité de l’Afrique de concevoir et de mettre en œuvre un programme de transformation réussie
a été compromise par des facteurs internes et externes. Si certains de ces facteurs trouvent actuellement
des solutions, d’autres par contre persistent. Au nombre des facteurs internes gurent les faibles capacités
de gestion économique caractérisées par l’instabilité macroéconomique, les médiocres capacités de
conception, de planication et d’exécution, les faibles capacités institutionnelles et individuelles, les
investissements limités dans l’infrastructure sociale et économique, l’investissement limité dans la
technologie et la R-D ainsi que l’instabilité politique.
Les facteurs externes sont notamment : l’espace politique limité dû en partie aux conditionnalités
imposées par les institutions de Bretton Woods et les partenaires de développement qui surestiment
l’importance des approches de développement axées sur le marché ; les barrières commerciales qui
amenuisent les recettes d’exportation et entravent les exportations de produits manufacturés ; la
concentration disproportionnée de l’APD dans les secteurs sociaux et non dans les secteurs productifs de
l’agriculture et de l’industrie ; et la concentration de l’IDE dans les secteurs d’extraction des minerais et
du gaz avec des investissements limités dans la création de valeur. En outre, au cours des dernières années,
le changement climatique s’est révélé une menace pour le développement à travers son impact destructeur
sur l’infrastructure et les modes de vie.
En somme, les stratégies d’industrialisation de l’Afrique n’ont pas entraîné une transformation de ses
économies, les germes de ces problèmes ont été semés durant la période coloniale mais le problème
s’est aggravé après l’indépendance en raison de l’échec des politiques industrielles souvent élaborées à
l’extérieur : d’abord, les politiques de substitution aux importations dans le cadre desquelles les pays
africains ont décidé de s’industrialiser, ensuite les programmes d’ajustement structurel qui ont forcé les
pays africains à désindustrialiser.
Plus récemment, du fait de la structure du système mondial, il est pratiquement impossible pour l’Afrique
de tirer avantage de la mondialisation ou de progresser sur la chaîne de valeur, ce qui nécessite que
l’Afrique inue sur le programme mondial en sa faveur (CEA, 2013).
Sur le plan collectif, en raison des dés énumérés plus haut, le degré de diversication économique est
faible, l’agriculture et le secteur minier gardent une part prépondérante dans le PIB et les ressources
nancières à consacrer au développement durable sont insusantes.
Opportunités de transformation économique
Malgré les dés énumérés plus haut, la dynamique nationale et mondiale actuelle ore une chance pour
le programme de transformation du continent. L’amélioration de la gestion macroéconomique et la
hausse de la demande des produits de base ont créé les conditions favorables à l’investissement dans le
secteur privé et donné au secteur public plus de marge budgétaire pour eectuer des dépenses sur des
programmes qui appuient le programme de transformation de l’Afrique. Les recettes exceptionnelles
accumulées grâce à l’augmentation des exportations des produits de base peuvent être investies dans le
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%