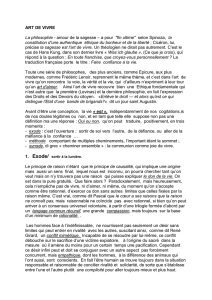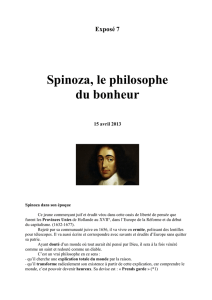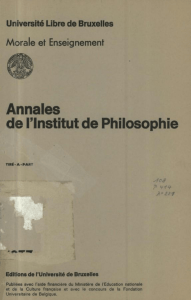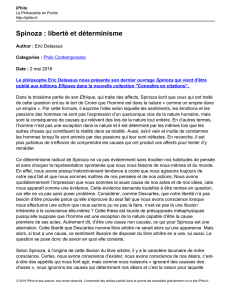Affectio et affectus dans l`Ethique de Spinoza

Université de Bretagne Occidentale (Brest)
Faculté des Lettres
Département de Philosophie
T.E.R de Master 1 de Philosophie
Affectio et affectus dans l'Ethique
de Spinoza
Présenté par : Nicolas CERTENAIS
Sous la direction de Jean-Christophe BARDOUT, Maître de Conférences

Septembre 2005
Remerciements :
Mes remerciements et ma gratitude vont à l'ensemble de mes professeurs qui ont su me
guider au cours de ces quatre années de formation ainsi qu'à mes camarades de la promotion
avec qui j'ai toujours pu converser avec autant de plaisir que d'intérêt. Je remercie également
mes proches pour leur soutien.
2

"L'examen des termes est le commencement de la sagesse"
(Proverbe grec antique)
3

Introduction :
"Une substance est antérieure de nature à ses affections1", ainsi commence la toute
première proposition du livre un de l'Ethique. Si la pensée de Spinoza a pu être présentée
comme une pensée panthéiste où le Dieu substance-unique tenait la place centrale, nous
pouvons remarquer que Spinoza débute son oeuvre maîtresse, à savoir l'Ethique, par une mise
en relation de ces deux concepts de substance et d'affection, annonçant d'emblée la solidarité,
la sorte de parité de ces deux notions. En effet, la proposition inaugurale anticipe le premier
axiome de l'Ethique, sorte de dichotomie -à l'inverse d'Aristote, exhaustive2- du sens de
"être" : "Tout ce qui est est ou en soi ou en autre chose", l'être en soi ("ce qui est en soi et est
conçu par soi") devenant synonyme de substance alors que ce qui est en autre chose se trouve
doté d'un nom : mode (affection). Ainsi, cette œuvre construite comme un traité de géométrie
suit bel et bien un ordre, au sens défini par ce qui apparaît à bien des égards comme un des
maîtres à penser de Spinoza, à savoir Descartes : "L'ordre consiste en cela seulement, que les
choses qui sont proposées les premières doivent être connues sans l'aide des suivantes, que les
suivantes doivent après être disposées de telle façon, qu'elles soient démontrées par les seules
choses qui les précédent.3". Spinoza ne fait donc rien sans "ordre", sans qu'une "chose
proposée", une proposition, ne découle d'une autre qui la précède, d'une définition ou encore,
d'un postulat. A ce caractère "principal" (car premier) du concept d'affection, s'ajoute un
autre, central : l'Ethique, écrite en cinq parties, a pour titre du livre troisième (et donc, au sens
littéral, central) De Origine Et Natura Affectuum4, et pour preuve de l'importance de ces
1 L'édition de l'Ethique citée sera, lorsque rien n'est précisé, la traduction de B. Pautrat (la troisième édition) qui
nous a semblée la plus fidèle à l'esprit du texte latin. Le numéro de page donné après les références propres à
l'Ethique renverra à cette traduction. Par commodité, nous désignerons le livre 1 par l'abréviation De Deo, le II,
par De Mente, le III, par De Affectibus, le IV, par De Servitute, le V, par De Libertate.
2 Spinoza fermant la fameuse "énigme de Z trois", selon l'expression de J. Beaufret (Dialogues avec Heidegger,
tome III, "L'énigme de Z, 3"), où Aristote indique l'insuffisance de son discours à déterminer exhaustivement le
sens de "être", l'irréductibilité de l'oÙs a… à l'Øpoke menon ˆ:
"Nous avons maintenant donné un exposé schématique de la nature de la substance, en montrant qu'elle
est ce qui n'est pas prédicat d'un sujet, mais que c'est d'elle que tout le reste est prédicat. Mais nous ne devons pas
nous borner à ces remarques, qui ne sont pas suffisantes." (Aristote, Métaphysique, Z, 3, 1029a, trad. Tricot p.
242 ). Spinoza clôt ce qu’Aristote avait ouvert par la restriction de tout ce qui est à la substance ou au mode (qui
est mode de la substance, n'ayant pas d'existence autonome possible), comme nous le verrons plus loin. Mais la
terra incognita reste la substance dont nous connaissons que deux attributs parmi une infinité.
3 Descartes, Méditations Métaphysiques, Réponses aux secondes objections, éd. Adam Tannery (désormais citées
A.T) tome IX 1, p.121
4 Ces observations, pouvant paraître fantaisistes, font droit au fait que les auteurs plus anciens étaient beaucoup
plus sensibles à la construction d'un livre que nous autres modernes et Spinoza d'autant plus qu'il était persécuté,
la persécution influant, en ce sens, sur l'art d'écrire.
4

notions, deux des cinq livres de l'Ethique (le troisième et le quatrième) portent dans leur titre
le mot "affect" et se proposent d'analyser ce dernier.
Le problème de la traduction
Pourtant, déjà, une observation s'impose : si nous pouvons, à juste titre, nous
demander si par delà le côté rhétorique de ce caractère principal et central que nous
remarquons –et nos analyses reposent bien évidemment sur un ensemble d'éléments plus
solides que cette triviale mais néanmoins interrogative remarque (l'Ethique semble, dans sa
construction, faire attention à l'ordre dans lequel elle présente les choses)- il y a bien,
conceptuellement, une importance aussi grande de cette notion. Le problème se redouble dès
lors que nous observons que ce n'est pas une notion à laquelle nous avons affaire, mais deux.
En effet, Spinoza emploie d'abord le terme "affectio" ("Substantia prior est natura suis
affectionibus." Ethique, I, 1) mais use du terme "affectus" dans le titre des livres trois et
quatre. Dès lors cette question : la proximité lexicologique des deux termes traduit-elle une
simple identité des deux concepts faisant que Spinoza emploie un vocabulaire flottant (l'un
étant finalement synonyme de l'autre), ou faut-il voir dans cette différence certes ténue, une
distinction stricte, conceptuelle? La question ne fait que se renforcer au fil de la lecture de
l'Ethique : la présence du terme affectus ne se limite pas aux seuls titres des livres trois et
quatre, il n'est pas une simple coquille ou un hapax, les deux termes se retrouve tout au long
de l'œuvre et la jalonne comme pour marquer deux concepts bel et bien distincts. Soyons plus
précis : les deux termes sont présent dans le texte latin, certaines traductions perdant
totalement la proximité lexicale des deux concepts. Ainsi, à titre d'exemple, Saisset traduit la
première proposition de l'Ethique en rendant "affectio" par affection, alors que pour le titre de
la troisième partie, il traduit "affectus" par "passion", ce qui constitue, nous le verrons (tout
"affectus" n'est pas passif), une grave faute d'interprétation. Le problème de la traduction
ayant au moins le mérite de clarifier les choses : que faut-il entendre au juste par affectio et
affectus? Faisant droit à ces questions, il s'agira de montrer la distinction rigoureuse des deux
concepts (notons que Bernard Pautrat, dans sa note préliminaire à la traduction de l'Ethique5,
fait largement mention de ce problème précis comme stimulant pour une large part sa
nouvelle version), de montrer comment l'un ne recouvre pas l'autre, comment l'un (affectus)
suppose l'autre sans s'y réduire et comment ils se complètent dans l'économie de l'Ethique.
5 Ethique, éd. bilingue, trad. Bernard Pautrat, collection "L'ordre Philosophique", éditions du Seuil, Paris, 1988
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
1
/
103
100%