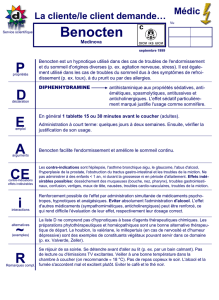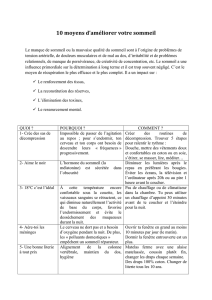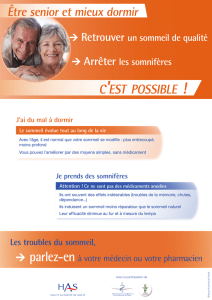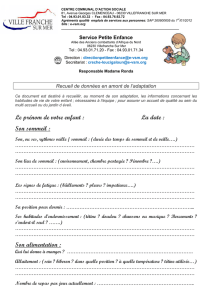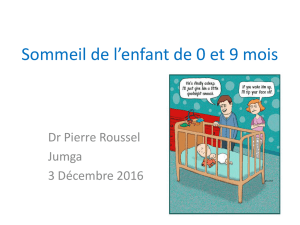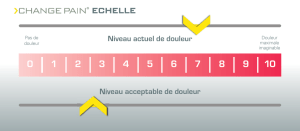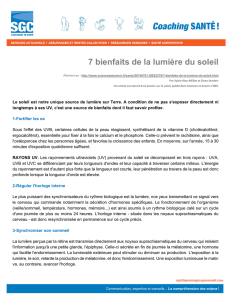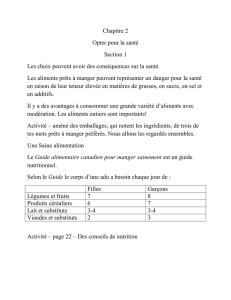Les troubles de l`endormissement de l`enfant de 6 à 36 mois en

SOUTENANCE A CRETEIL
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL
FACULTE DE MEDECINE DE CRETEIL
*******************
ANNEE 2013 N°
THESE
POUR LE DIPLOME D’ETAT
DE
DOCTEUR EN MEDECINE
Discipline : Médecine Générale
----------
Présentée et soutenue publiquement le :
A : CRETEIL (PARIS EST CRETEIL)
----------
Par BEN KHALIFA Nadia
----------
Née le 07/01/1984 à Paris 12
ème
----------
Les troubles de l’endormissement
de l’enfant de 6 à 36 mois en médecine générale
DIRECTEUR DE THESE :
Dr LEROUX Gérard
LE CONSERVATEUR DE LA
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE :

2
REMERCIEMENTS
Au docteur Gérard LEROUX pour m’avoir aidée dans ce projet, et m’avoir permis de
réaliser ce sujet.
Aux docteurs DEMOLIERE, et MARTIN pour m’avoir permis de me servir de leurs
thèses afin de faire la mienne.
A Marion, pour m’avoir aidée à écrire et mettre en forme cette thèse.
A Mme VEERABUDUN pour l’analyse des résultats et le temps passé à m’expliquer les
statistiques.
A tous les médecins qui ont accepté de participer à ce projet.
Et à Thomas, pour m’avoir supportée et soutenue durant ce long, très long travail.

3
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS ……………………………………………………………………. 2
TABLE DES MATIERES ………………………………………………………………. 3
INTRODUCTION ……………………………………………………………………….. 4
I- Caractéristiques du sommeil de l’adulte ………………………………………… 5
II- Le sommeil de l’enfant …………………………………………………………… 6
A- Caractéristiques du sommeil de l’enfant …………………………………….. 6
B- Organisation du sommeil de l’enfant …………………………………………. 7
III- Les troubles du sommeil de l’enfant …………………………………………… 8
A- Les parasomnies ……………………………………………………………….. 8
1- les troubles de la transition éveil-sommeil ou sommeil-éveil ……………. 8
2- Les troubles observés lors des éveils partiels en sommeil lent profond… 9
3- Les parasomnies en sommeil paradoxal ………………………………….. 9
4- Les autres parasomnies ……………………………………………………... 9
B- Les difficultés d’endormissement et les réveils nocturnes …………………. 10
MATERIEL ET METHODE ……………………………………………………………. 12
I- Population de l’étude ……………………………………………………………… 12
II- Variables étudiées ………………………………………………………………… 12
III- Recueil de données ……………………………………………………………… 13
IV- Analyse statistique ………………………………………………………………. 14
RESULTATS ……………………………………………………………………………. 15
I- Population de l’étude ……………………………………………………………… 15
II- Le sommeil des enfants ………………………………………………………….. 17
A- Endormissement ……………………………………………………………….. 17
B- Réveils nocturnes ………………………………………………………………. 17
C- Réveil matin …………………………………………………………………….. 18
D- Sommeil diurne …………………………………………………………………. 18
III- Facteurs liés aux difficultés d’endormissement : analyse univariée ………... 18
A- Lié à la population ……………………………………………………………… 19
B- Caractéristiques de l’endormissement ………………………………………. 21
C- Réveils et siestes ………………………………………………………………. 22
D- Conclusions de l’analyse univariée …………………………………………... 23
IV- Facteurs liés aux difficultés d’endormissement : analyse multivariée ……… 24
DISCUSSION …………………………………………………………………………… 25
I- Nos résultats ………………………………………………………………………. 25
II- Forces de ce travail ………………………………………………………………. 26
III- Faiblesses/limites ………………………………………………………………… 26
IV- Comparaison aux résultats du Dr Demolière ………………………………….. 27
V- Comparaison à la littérature ………………………………………………………. 29
A- Différents chiffres de prévalence ………………………………………………. 29
B- Facteurs influençant les difficultés d’endormissement ………………………. 30
1- L’âge de l’enfant ……………………………………………………………….. 30
2- L’endormissement seul ……………………………………………………….. 31
3- L’origine ethnique des parents ……………………………………………….. 32
4- Le mode de garde ……………………………………………………………… 33
5- Rôle de la télévision dans la survenue de troubles de l’endormissement .. 34
CONCLUSION …………………………………………………………………………… 35
BIBLIOGRAPHIE ………………………………………………………………………… 37
ANNEXE ………………………………………………………………………………… 39
RESUME ..………………………………………………………………………………… 44

4
INTRODUCTION
Alors que les consultations pour les enfants de 0 à 15 ans sont très fréquentes en
médecine générale (17,7 % des consultations de médecine générale selon une étude du
CREDES), et qu’un certain nombre de ces enfants n’est suivi que par un médecin
généraliste, la prévalence des troubles du sommeil est mal connue dans cette
population.
Deux travaux publiés en 2010 et 2012 (mais dont les questionnaires avaient été colligés
en 2007), par les Dr Demolière et Martin, retrouvaient des associations entre certains
facteurs de risque et des troubles de l’endormissement et/ou des réveils nocturnes chez
les enfants de 6 à 40 mois.
L’objectif principal de notre travail était de vérifier, quelques années plus tard, et pour le
même type de population (banlieue parisienne), si les résultats des thèses des
Dr Demolière (endormissement) et Martin (réveils nocturnes) étaient confirmés.
Le thème des troubles du sommeil étant très vaste, les parasomnies ont été exclues de
cette étude, d’autant qu’elles sont rares entre 6 et 36 mois, âge des enfants étudiés.
Ce travail concerne les troubles de l’endormissement ; les réveils nocturnes font l’objet
d’un autre travail de thèse réalisé par le Dr Peeters Charbonneau, avec une population
et un questionnaire communs pour les deux thèses.
Avec leur accord, cette introduction est en partie commune avec celle des thèses du Dr.
Demolière (5) et du Dr. Martin(18).
« Le sommeil de l’enfant et ses troubles constituent un domaine de recherche
relativement récent. Dans la première moitié du XXème siècle, différents stades de
sommeil avaient été individualisés sur la présence ou non de mouvements oculaires ou
de mouvements phasiques de la face chez le nouveau-né endormi [13].
Ce n’est que dans les années 50 que l’application des méthodes utilisée chez l’adulte a
permis à l’équipe de Kleitman d’identifier des cycles de sommeil chez le nourrisson [2].
Le premier enregistrement EEG du sommeil de l’enfant date de 1966, par Nicole Monod
et Colette Dreyfus-Brissac à l’hôpital Port-Royal à Paris [13].

5
La définition du sommeil normal est : l’association entre une inactivité de nuit et un
détachement du cerveau d’un certain nombre d’apports sensoriels [3].
I. Caractéristiques du sommeil de l’adulte
Le sommeil de l’adulte se décompose en deux états : le sommeil lent et le sommeil
paradoxal.
Le terme de sommeil lent à de nombreux synonymes selon les auteurs : sommeil
synchronisé, sommeil calme (chez le nourrisson), sommeil sans phases de mouvements
oculaires rapides ou « non REM sleep » en anglais.
Ce sommeil lent, qui représente 75 à 80 % du sommeil de l’adulte est divisé en quatre
stade de 1 à 4, le stade 0 étant le stade de veille calme correspondant sur l’EEG à une
activité alpha (8 à 13 Hz) et/ou à des fréquences dites mixtes de faible voltage.
Le stade 1 se défini comme étant le premier stade du sommeil. Il est retrouvé soit à
l’endormissement soit dans une phase de pré réveil. On retrouve sur l’EEG des
fréquences mixtes de faible voltage associées à des ondes alpha lentes (8 Hz) et à des
ondes dites thêta (3,1 à 7,9 Hz) prédominantes.
Le stade 2, ou sommeil léger, est défini par la présence de fuseaux de sommeil ou
« spindles » (12 à 14 Hz) d’une durée minimum d’une demi seconde et/ou de complexes
K, grandes ondes isolées et par l’absence d’onde lentes en quantité suffisante (moins
de 20%).
Enfin, les stades 3 et 4 ou sommeil profond sont présents en début de nuit et
correspondent à un sommeil à ondes lentes ou delta (0,1 à 2,9 Hz). Il existe 20 à 50 %
d’ondes lentes dans le stade 3 et plus de 50 % dans le stade 4 [3].
Le sommeil paradoxal est également cité sous différentes dénominations : sommeil
désynchronisé, sommeil avec phase de mouvements oculaires rapides (PMO) ou
« REM sleep », sommeil actif chez le nourrisson ou encore sommeil de rêve.
Le sommeil paradoxal est plus important en fin de nuit. Il correspond à un EEG de
petites amplitudes avec mélange d’ondes Thêta et parfois d’ondes Alpha lentes
associées à une absence de tonus musculaire à l’EMG des muscles du menton et à la
présence de mouvements oculaires rapides [23].
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
1
/
45
100%