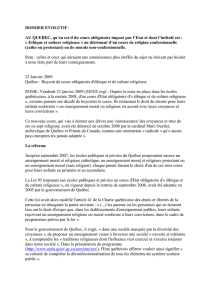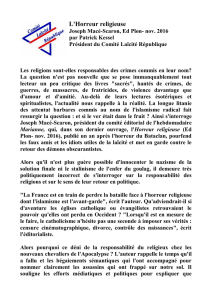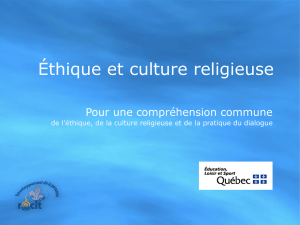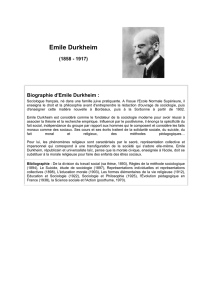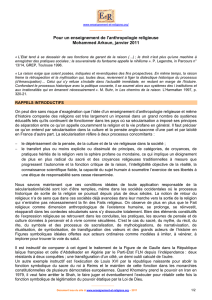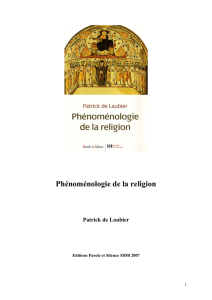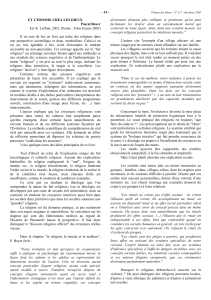Durkheim De la définition des phénomènes religieux corrigé

Lycée franco-mexicain
Cours Olivier Verdun
Durkheim, « De la définition des phénomènes religieux »
Repère : « transcendant / immanent »
1. Quel est l’objet de ce texte ?
Après avoir écarté, dans la première partie des Formes élémentaires de la vie
religieuse, plusieurs définitions de la religion couramment admises (la religion comme
réaction humaine devant ce qui est incompréhensible et mystérieux ; la religion comme
croyance en l’existence d’un ou plusieurs dieux), Durkheim examine, dans la deuxième
partie, ce qui caractérise le fait religieux dans son universalité. Il se propose de dégager
les traits communs à toutes les religions au-delà de leurs différences, en les considérant
comme des faits sociaux à part entière. Ainsi est-il amené à distinguer les croyances et les
pratiques religieuses de la morale et du droit avec lesquels on se serait tenté de les
confondre. Durkheim se demande par la suite quelle est la cause des phénomènes
religieux. Comment expliquer, en effet, le sentiment de respect et la transcendance
religieux ?
2. Comment Durkheim définit-il le culte religieux ?
Durkheim définit le culte religieux comme l’ensemble des pratiques concernant les
choses sacrées. C’est ce qui le différencie des autres pratiques sociales avec lesquelles le
culte religieux présente des similarités. En tant que pratique sociale, le culte religieux
comprend, en effet, des manières d’agir définies qui sont obligatoires à l’instar des
prescriptions rituelles des maximes morales et juridiques. Le culte religieux ne se
caractérise pas non plus, comme on le croit généralement, par le rapport qu’il établit entre
les hommes et les dieux, puisqu’il existe des rites sans dieux. C’est donc le sacré et sa
distinction d’avec le profane qui constitue l’objet propre du culte religieux.
3. Quelles sont les caractéristiques des croyances religieuses ?
Les croyances religieuses ont ceci de caractéristique qu’elles sont socialement
obligatoires : « la société qui les professe ne permet pas à ses membres de les nier ». Que
ce soit l’Israélite, le Chrétien ou le Bouddhiste, il est tenu, en tant que membre d’une
communauté de croyants ayant en partage la même foi, d’adhérer à cette croyance
collective, de partager les « dogmes essentiels de son Eglise ». Si le contenu de ces
croyances (dogmes, mythes, légendes religieuses) varie d’une religion à une autre, on
reconnaît une croyance religieuse à sa dimension impérative, voire coercitive. L’individu
n’a pas d’autre choix que d’adhérer à la foi commune. Durkheim souligne qu’il y a
toujours « une pression exercée par la société sur ses membres pour empêcher qu’ils ne
dévient de la foi commune. » L’essentiel est de protéger les dogmes essentiels contre

Lycée franco-mexicain
Cours Olivier Verdun
« les audaces de la critique ». La société réprime le refus des croyances communes par
différents moyens. Pour ce faire, toutes sortes de châtiments plus ou moins sévères sont
mis en œuvre comme le blâme, la mise à distance, l’exil à l’intérieur du groupe.
Durkheim en conclut que plus les croyances sont religieuses, plus elles sont obligatoires.
En tant qu’opinions obligatoires, les représentations religieuses s’opposent aux autres
représentations, c’est-à-dire aux « libres opinions ».
4. Qu’est-ce qui distingue le sacré et le profane ?
Selon Durkheim, la division des choses en sacrées et en profanes est à la base de toute
organisation religieuse quelle qu’elle soit. La distinction du sacré et du profane est donc
universelle. Les représentations d’ordre religieux sont des opinions obligatoires que
l’individu trouve toutes faites sous les traits de traditions auxquelles il conforme
respectueusement sa pensée. Ces traditions que l’individu doit respecter scrupuleusement
portent sur des êtres d’une nature très différente de celle des réalités ordinaires. Le sacré
est séparé du profane par une « ligne de démarcation » qui signe entre ces deux monde
une différence non pas simplement de « grandeur », mais de « qualité », c’est-à-dire de
nature.
Par extension, le sacré désigne ce qui est mis à part, ce qu'on met à l'écart, à l'abri et
qui est, pour cette raison, inviolable, tabou, intouchable, exigeant le respect absolu. Le
sacré est un ensemble de réalités - êtres, choses, lieux, moments - séparées du monde
profane ordinaire, dans lesquelles se manifeste une puissance jugée supérieure, qu’on ne
peut donc aborder qu’avec précaution, c’est-à-dire rituellement. Les rites rendent
possibles la communication entre le sacré et le profane, sans que le sacré soit souillé par
son contact avec le profane. Ainsi, dans le fameux épisode du buisson ardent, l'Éternel dit
à Moïse : « N’approche pas d’ici, ôte tes chaussures de tes pieds ; car ce lieu où tu te tiens
est une terre sainte » (Exode, III, 5). Au contact de l’être ou de l’objet sacré, l’homme
religieux fait donc l’expérience d’un “tout autre”, d’une transcendance.
5. Qu’est-ce qui distingue la religion de la morale et du droit ?
Les croyances religieuses ont en commun avec le droit et la morale d’être impératives.
Mais il ne faut pas confondre les croyances obligatoires (certaines manières de penser)
dont relève la religion et les pratiques obligatoires (certaines manières de se conduire)
auxquelles ressortissent le droit et la morale. Il y a donc entre la religion, la morale et le
droit toute la différence qu’il y a « entre penser et agir, entre les fonctions représentatives
et les fonctions motrices ou pratiques ». De ce point de vue, les préceptes du droit et de la
morale se différencient de la religion en ce qu’ils ne reposent sur aucun système de
croyances obligatoires.
6. Comment Durkheim définit-il les phénomènes religieux ?
D’où la définition que propose Durkheim des phénomènes religieux : « On appelle
phénomènes religieux les croyances obligatoires ainsi que les pratiques relatives aux
objets donnés dans ces croyances. » Durkheim insiste sur la solidarité qu’il y a, dans les

Lycée franco-mexicain
Cours Olivier Verdun
phénomènes religieux, des pratiques et des croyances. Une croyance n’est religieuse que
si elle aboutit à des pratiques. Dans la religion, la pensée et l’action sont intimement liées.
Par exemple, le dogme de la transsubstantiation est relié à la communion chrétienne. Les
« croyances communes d’ordre laïque, comme la foi au progrès, en la démocratie, etc. »
ne débouchent pas nécessairement sur des manières d’agir spécifiques, c’est-à-dire sur
des cultes. Pour que l’on puisse parler de phénomène religieux, il faut donc que les
croyances collectives se traduisent en un système de pratiques déterminées.
7. Quelle est la source du sentiment de respect religieux ?
La dépendance vis-à-vis de la société est la source du sentiment de respect religieux.
Nous avons vu que ce qui caractérise les croyances comme les pratiques religieuses, c’est
qu’elles sont obligatoires. Or, précise Durkheim, « tout ce qui est obligatoire est d’origine
sociale ». La raison en est que toute obligation implique un commandement et, par
conséquent, une autorité qui commande. Les règles auxquelles l’individu est tenu de se
conformer émanent d’une autorité morale qui les lui impose. Cette autorité qui s’impose à
l’individu, qui le domine, le transcende, est l’autorité du groupe auquel il appartient.
C’est donc dans la dépendance dans laquelle se trouve l’individu à l’égard de la société
que s’enracine le sentiment de respect religieux. Ce dernier est, en réalité, une
transposition du sentiment de déférence que l’individu éprouve envers le corps social.
8. La cause des phénomènes religieux est-elle individuelle ?
La cause des phénomènes religieux est de nature sociale et non individuelle. La source
de la religiosité ne se trouve pas dans des sentiments privés ou des dispositions
psychologiques particulières, mais dans la nature des sociétés auxquelles ces sentiments
et dispositions se rapportent. En s’inclinant devant les traditions, les dogmes, les mythes
considérés comme sacrés, l’individu s’incline, en réalité, devant des forces sociales qui
ont éveillé les croyances religieuses et les ont déterminées à s’exprimer sous telle ou telle
forme. C’est donc dans l’organisation sociale elle-même, et dans la façon dont celle-ci a
pu évoluer au cours de l’histoire, qu’il faut chercher la cause des phénomènes religieux.
9. Comment comprendre la transcendance religieuse ? Vous rappellerez ici le
sens du repère « transcendant / immanent ».
Est transcendant ce qui dépasse l'expérience ordinaire (latin transcendere, « passer au-
delà », «surpasser »), ce qui est d'une nature supérieure, séparée de la réalité ordinaire ou
sensible, ce qui est au-delà de toute expérience possible. Est immanent (latin immanere, «
résider dans »), ce qui relève d'une causalité interne, ce qui n'excède pas l'expérience
possible, ce qui est à l'intérieur du monde sensible. Durkheim considère que la
transcendance religieuse n’est mystérieuse que si on la fait dériver de l’individu. Elle
devient, au contraire, compréhensible en termes sociologiques. La transcendance
religieuse n’est pas à chercher dans quelque mystérieuse disposition psychologique
(hallucination, fantasmagorie, sommeil, rêve…), mais dans « l’esprit collectif » entendu
comme la « manière sui generis dont pensent les hommes, quand ils pensent

Lycée franco-mexicain
Cours Olivier Verdun
collectivement ». La transcendance religieuse traduit à sa façon le mystère que constitue
l’ordre social dont la manière d’être et de penser échappe aux individus, - mystère
provisoire qui exprime notre ignorance à l’endroit des choses sociales et que la science
peut espérer dissiper peu à peu. Le caractère mystérieux de la transcendance religieuse
découle de ce que les « lois de l’idéation collective » sont encore mal connues. Durkheim
en conclut que ces représentations étranges que la religion exprime perdront leur
étrangeté dès lors que l’esprit humain aura réussi à pénétrer ces lois.
10. D’où les formes privées de religiosité dérivent-elles ?
Les formes privées de religiosité dérivent de la religion impersonnelle et sociale. Par
forme privée de religiosité Durkheim entend la façon dont chacun se constitue, à côté des
objets de culte communs, ses propres dieux ou totems privés et modifie, sur tels ou tels
points particuliers, la conception traditionnelle, en s’imposant d’autres pratiques que la
loi religieuse commune ne réclame pas impérativement. Il y a donc souvent place, à côté
de la religion que « l’on reçoit de la tradition, qui est faite par tout un groupe et que l’on
pratique obligatoirement », pour une religion « libre, privée, facultative », que l’on se fait
à soi-même comme on l’entend. La religion privée est tournée tout entière vers
l’individu, tandis que la religion traditionnelle est tournée vers la société. Durkheim
insiste sur le fait que la foi privée dérive de la foi publique. La foi privée n’est autre
qu’une représentation individuelle de la foi publique que l’individu va partiellement
individualiser, idée que Durkheim résume comme suit : « cette religion intime et
personnelle n’est donc que l’aspect subjectif de la religion extérieure, impersonnelle et
publique. » C’est dire que si absorbé que soit l’individu dans la société, il n’y a pas de
formes de l’activité collective qui ne s’individualisent. Chacun de nous, en effet, a « sa
morale personnelle, sa technique personnelle, qui, tout en dérivant de la morale commune
et de la technique générale, en différent. »
1
/
4
100%