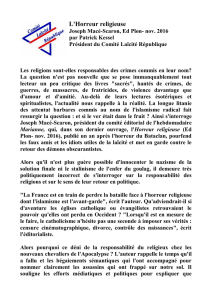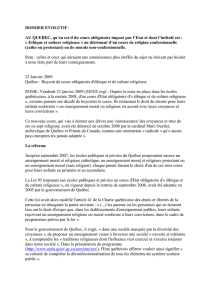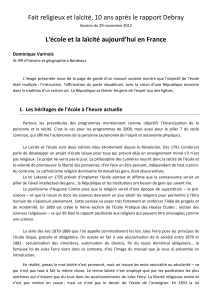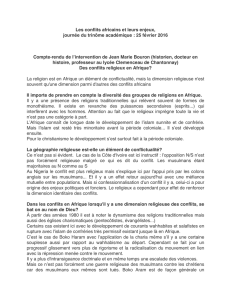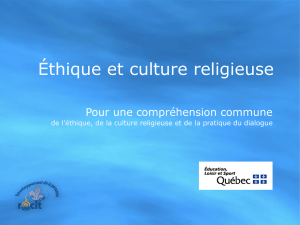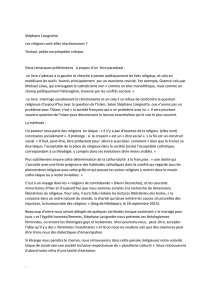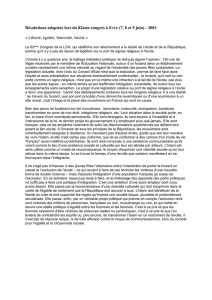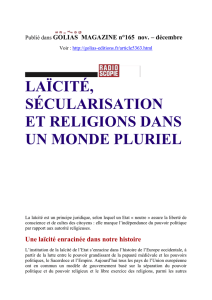Pour un enseignement de l`anthropologie religieuse Mohammed

_______________
Document issu du site www.enseignement-et-religions.org – 2011 1/2
www.enseignement-et-religions.org/
_______________
Pour un enseignement de l'anthropologie religieuse
Mohammed Arkoun, janvier 2011
« L’Etat tend à se dessaisir de ses fonctions de garant de la raison (…) ; le droit n’est plus qu’une machine à
enregistrer des pratiques sociales ; la souveraineté du fantasme appelle le nihilisme ». P. Legendre, in Parcours n°
13/14, GREP, Toulouse 1996.
« La raison exige que soient posées, indiquées et revendiquées des fins prospectives. En même temps, la raison
freine la rétrospection et la mythisation qui, toutes deux, reviennent à figer la dialectique historique du processus
(d’émancipation)… Celui qui s’y refuse s’installe dans l’actualité immédiate, en restant en marge de l’histoire.
Confondant le processus historique avec la politique courante, il se soumet alors aux systèmes des i institutions et
aux irrationalités qui en émanent nécessairement ». M. Buhr, in Les chemins de la raison. L’Harmattan 1997, p.
320-21.
RAPPELS INTRODUCTIFS
On peut dire sans risque d’exagération que l’idée d’un enseignement d’anthropologie religieuse et même
d’histoire comparée des religions est très largement un impensé dans un grand nombre de systèmes
éducatifs tels qu’ils continuent de fonctionner dans les pays où sa sécularisation a imposé ses principes
de séparation entre ce qu’on appelle couramment la religion et la vie profane en général. Il faut préciser
ce qu’on entend par sécularisation dans la culture et la pensée anglo-saxonne d’une part et par laïcité
en France d’autre part. La sécularisation réfère à deux processus concomitants :
− le dépérissement de la pensée, de la culture et de la vie religieuse dans la société ;
− le transfert plus ou moins explicite ou dissimulé de principes, de catégories, de croyances, de
pratiques hérités de la religion vers la sphère profane ou mondaine, ce qui implique un éloignement
de plus en plus radical du sacré et des croyances religieuses traditionnelles à mesure que
progressent l’autonomie et la fonction critique de la raison, l’intelligibilité objective de la réalité, la
connaissance scientifique fiable, la capacité du sujet humain à soumettre l’exercice de ses libertés à
une étique de responsabilité sans cesse réexaminée.
Nous savons maintenant que ces conditions idéales de toute application responsable de la
sécularisation/laïcité sont loin d’être remplies, même dans les sociétés occidentales où le processus
historique de sortie de la religion se poursuit depuis plus de deux siècles. La notion de retour du
religieux n’a de sens que dans ces sociétés déjà avancées dans leur marche vers la sortie de la religion
qui n’entraîne pas nécessairement la fin des Faits religieux. On observe de plus en plus que le Fait
religieux comme dimension anthropologique de l’existence humaine, se prolonge, se réinvestit,
réapparaît dans les contextes sécularisés sans s’y dissoudre totalement. Bien des éléments constitutifs
de l’expression religieuse se retrouvent dans les conduites, les pratiques, les œuvres de pensée et de
culture données à percevoir et à vivre comme séculières. C’est le cas du sacré, du mythe, du récit, du
rite, du symbole et des processus de sacralisation, de mythologisations, de narrativisation, de
ritualisation, de symbolisation, de transfiguration des valeurs et des grands acteurs de l’histoire en
Figures symboliques idéales offertes aux acteurs ordinaires comme modèles à imiter, à vénérer, à
implorer pour trouver la voie du salut.
Il est instructif de comparer à cet égard le traitement de la Figure de de Gaulle dans la République
laïque française et celle d’Abdelkader en Algérie par le Parti-Etat FLN depuis l’indépendance : deux
résistants à deux conquêtes ; une transfiguration d’un côté, un demi oubli calculé de l’autre.
Un autre exemple instructif est l’exécution de Louis XVI par la république naissante pour abolir la
fonction symbolique du sacre du roi à Reims et le maintien de cette fonction dans les monarchies
constitutionnelles de plusieurs démocraties européennes. Quand Khomeiny prend le pouvoir en Iran en
1979, il veut faire arrêter le Shah, le faire juger et éventuellement l’exécuter pour rétablir cette fois la
fonction symbolique de légitimation du pouvoir étatique par la Loi de Dieu.

_______________
Document issu du site www.enseignement-et-religions.org – 2011 2/2
On mesure à quel point ces transformations touchent en profondeur tous les niveaux, toutes les
manifestations et toutes réalisation de l’existence humaine. Avec la laïcité à la française, il y a une
traduction juridique par l’Etat des postulats philosophiques et politiques de la laïcité : la gestion de
l’espace publique est le monopole de l’Etat, le règne de la souveraineté divine est aboli pour laisser
place à l’exercice de la souveraineté populaire, source de tout pouvoir légitime. La raison critique et
scientifique postule la possibilité d’organiser et de gérer la cité politique avec plus d’efficacité et de
pertinence politique et juridique que la théologie politique qui continue de résister, notamment dans les
contextes islamiques contemporains, à cette prétention. Les objectifs explicités de cette résistance sont
plus politiques que religieux ; c’est pourquoi, ils exigent des analyses critiques appliquées non
seulement à l’exemple de l’Islam, mais au devenir du fait religieux global sous l’impact des
connaissances scientifiques et la philosophie politique générées en Occident depuis les 17ème-18ème
siècles. Les travaux de Marcel Gauchet sur l’exemple du christianisme doivent être étendus à d’autres
traditions religieuses pour rendre enfin possible l’enseignement dans les lycées d’une histoire et d’une
anthropologie comparées des religions.
Il s’agit dans un premier temps, de former des maîtres capables d’introduire en tant que chercheurs, puis
enseignants, une distanciation critique par rapport aux Faits religieux et aux systèmes de croyance et de
non croyances légués dans chaque tradition comme des orthodoxies gérées par des clercs.
L’enseignement « objectif » du Fait religieux tel que je le pratique personnellement en tant qu’historien
de la pensée islamique depuis plus de 50 ans, vis à la fois trois objectifs complémentaires :
1) intégrer la dimension religieuse de l’existence historique des hommes à toutes les époques et dans
toutes les formations sociales comme fait social-historique global dans les programmes de
recherche en sciences de l’homme et de la société. Cela oblige à ne plus privilégier l’exemple du
christianisme comme religion inséparable du parcours historique de la pensée en Europe-Occident ;
La recherche et l’enseignement doivent avancer d’un même pas pour toutes les religions vivantes à
ce jour, sans négliger pour autant les religions disparues qui peuvent aider à enrichir la
compréhension du fait religieux comme matrice constante de l’existence et de l’histoire des
hommes ;
2) apprendre la distanciation critique des croyances les plus sacralisées et les plus intériorisées par le
sujet humain dans les différentes cultures qui commencent seulement à découvrir les richesses des
approches neuves de l’inter culturalité et de l’inter créativité. La laïcité bien comprise est un produit
de la modernité critique ; loin d’être un danger pour la laïcité dans l’enseignement public, les
religions ont, au contraire, une vertu irremplaçable pour exercer les jeunes à la distanciation critique
des croyances et des valeurs qui conditionnent le plus intimement leurs jugements dans les
confrontations interculturelles en cours ;
3) en maintenant dans toute recherche, tout enseignement et toute pratique politique le vis-à-vis
constant du Fait religieux et du Fait politique dans l’analyse des sociétés humaines, on réduit
considérablement les risques de dérives idéologiques qu’ont connues au cours de l’histoire de
longue durée aussi bien la raison religieuse triomphante dans les théologies politiques et les
constructions de droits et de valeurs divins que la raison moderne non moins souveraine et
arbitraire avec ses postulats réductionnistes et sa neutralité mensongère. Le maintien du vis-à-vis
« religieux » en contextes de modernité laïque ne signifie pas le renoncement à la critique des
régimes religieux de la vérité, de la légitimité et des valeurs ; mais cette critique gagne une plus
grande validité quand elle est appliquée avec la même rigueur intellectuelle au régime moderne laïc
de ces mêmes instances de vérité, de légitimité et des valeurs. Or c’est un fait historique qua la
raison dite moderne et laïque est vite devenue prisonnière de tout ce qui relève de la raison d’Etat et
de toutes les contraintes de la conquête, de la conservation et de l’exercice du pouvoir. C’est ainsi
que la laïcité théorique devient un laïcisme militant anticlérical qui oppose la culture de l’incroyance
à la culture de la croyance. C’est ce que les français appellent la hache de guerre.
1
/
2
100%