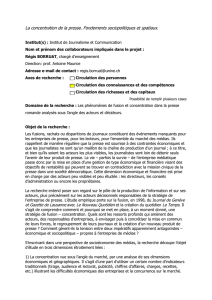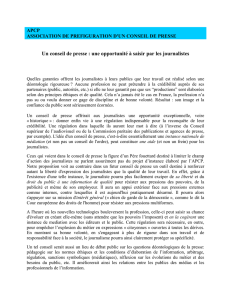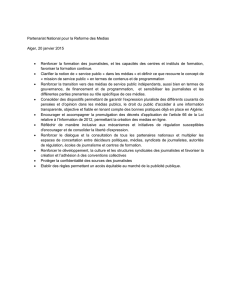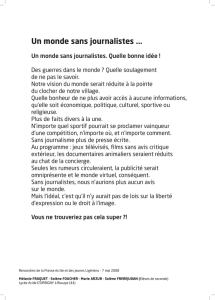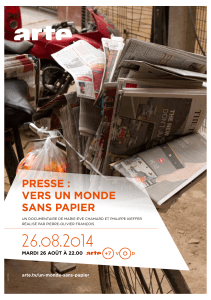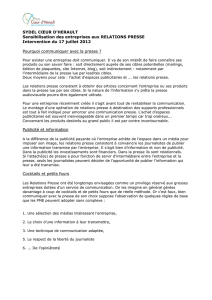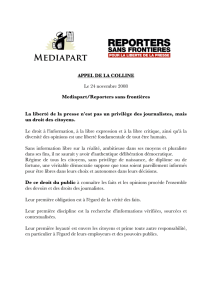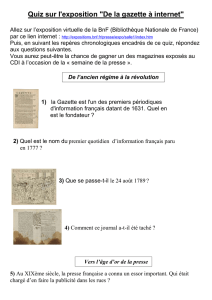Chapitre 2 La presse écrite et la presse électronique

49
Rapport Général de l’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information & de la Communication 2012
49
Chapitre 2
La presse écrite
et la presse électronique

50
Rapport Général de l’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information & de la Communication 2012
50
Rapport Général de l’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information & de la Communication 2012

51
Rapport Général de l’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information & de la Communication 2012
Chapitre 2
La presse écrite et la presse électronique
La presse écrite souffre d’un héritage très lourd et fait face à de multiples dés
(section1) dont notamment la concurrence de la presse électronique qui représente pour
elle à la fois une menace et une issue prometteuse (section2).
Section 1 : La presse écrite
L’histoire de la presse écrite en Tunisie remonte au 19ème siècle, et précisément au
22 juillet 1860 date de la parution du premier journal en langue arabe « Erraïd Ettounsi ».
La Tunisie était, alors, le deuxième pays arabe, après l’Egypte, à connaître la presse papier.
Pendant la période de l’occupation française, la presse écrite a joué un rôle déterminant
dans la mobilisation et l’encadrement des masses populaires. Elle a également contribué
activement à l’édication de l’Etat moderne et à la consécration du régime républicain en
Tunisie, après l’indépendance.
Avant l’accession du général Ben Ali au pouvoir, la presse écrite en Tunisie a connu
une évolution en dents de scie, en fonction des contingences politiques et des changements
sociaux, culturels et économiques qu’a connus le pays.
A partir du début des années 1990, la presse tunisienne est entrée dans une ère sans
précédent dans l’histoire contemporaine de la Tunisie. Une ère marquée par une mainmise
totale du pouvoir sur les médias, publics et privés, et par la multiplication des restrictions
contre les journalistes qui étaient empêchés d’accomplir leur mission et de couvrir certains
évènements importants, tels que les procès politiques contre les islamistes (1991-1992),
l’attentant contre la synagogue de la Ghriba (2002) et les évènements tragiques de Slimane
(2006). Les journalistes étaient même empêchés de couvrir les catastrophes naturelles
(inondations de Bousalem en 2000 et 2003, les inondations de Cebbalet Ben Ammar en
2007 et l’incendie de Boukornine en 2002).
Cette époque était aussi marquée par le verrouillage et le musellement des médias
au niveau politique, et par la médiocrité, voire parfois l’immoralité au niveau professionnel,
malgré les quelques tentatives sérieuses et audacieuses entreprises par certains journalistes
indépendants pour résister au rouleau compresseur et destructeur enclenché par le régime
de Ben Ali.

52
Rapport Général de l’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information & de la Communication 2012
La presse écrite en Tunisie regroupe aujourd’hui trois catégories : la presse publique,
la presse privée et la presse partisane.
Sous-section 1 : La presse publique
L’Etat tunisien détient actuellement deux entreprises dans le secteur de la presse
écrite : la Société Nouvelle d’Impression, de Presse et d’Edition (SNIPE) et « Dar Essabah ».
Paragraphe 1 : La SNIPE
La SNIPE édite le quotidien en langue française « La Presse de Tunisie » et le
quotidien en langue arabe « Essahafa ».
« La Presse de Tunisie » est le plus ancien quotidien tunisien en langue française.
Fondé en mars 1936 par Henri Smadja24, il a été nationalisé en 1968.
La SNIPE, quant à elle, n’a vu le jour qu’en 1973. Elle emploie 488 agents dont 45
journalistes au journal « La Presse » et 63 au journal « Essahafa » qui a été lancé en 198925.
Entre début janvier et n mai 2011, la SNIPE a réalisé un chiffre d’affaires de 4283
mille dinars, en régression de 23% en comparaison avec la même période de l’année 2010.
Les salaires représentent 60% du chiffre d’affaires de l’entreprise26 et ses ventes ont
reculé de 19,9% entre 2010 et 201127. Le revenu des ventes ne représente que 27% des
recettes, contre 67,2 pour la publicité et 5,6% pour les travaux d’impression et les travaux
de ville28.
Pendant de longues années, la SNIPE était chargée de réaliser des travaux dont les
prots ne couvraient pas les dépenses. L’impression du quotidien arabophone « El Arab »,
paraissant simultanément à Londres et à Tunis, coûtait à la SNIPE une perte de 61 millimes
par numéro29. L’entreprise a supporté ce manque à gagner durant une douzaine d’années
(de 1999 à 2011).
A la demande de l’Agence Tunisienne de Communication Extérieure (ATCE), et sur
instructions de la présidence de la république, la SNIPE était aussi chargée d’imprimer
le magazine « Solidarité »30 dont le propriétaire était Tarek Bacharoui, journaliste tunisien
résidant à Paris, proche du régime (voir chapitre sur l’information audiovisuelle).
24 Médecin et entrepreneur tunisien de confession juive (1897-1974).
25 Documents de la direction générale de la SNIPE, reçus par l’INRIC en décembre 2011
26 La règle générale est que le masse salariale ne devrait pas dépasser 35% du chiffre d’affaires
27 Documents de la direction générale de la SNIPE, reçus par l’INRIC en décembre 2011
28 Synthèse d’un rapport d’audit réalisé par un bureau d’études « Najar Media Consulting NMC » (mars 2012)
29 Convention signée le 20 décembre 1999 entre le PDG de la SNIPE, Mohamed Ben Ezzeddine, et le président du
conseil d’administration du journal « El Arab », Ahmed Salhine Houni
30 Voir Rapport de la Commission Nationale d’investigation sur la Corruption et la Malversation (CNICM), octobre
2011 (pages 168-169). Version arabe.

53
Rapport Général de l’Instance Nationale pour la Réforme de l’Information & de la Communication 2012
En octobre 2011, le tirage moyen du quotidien « La Presse » était de 28968 exemplaires
dont 16721 ont été vendus. Le quotidien « Essahafa » tirait, quant à lui, à 2000 exemplaires
dont seulement 463 étaient écoulés. Le pourcentage de rebut représentait 76,8% du tirage.
La SNIPE, qui occupe depuis plusieurs décennies une place prépondérante dans le
paysage médiatique en Tunisie, grâce essentiellement au journal « La Presse » qui groupe
une élite importante de compétences professionnelles, a gravement souffert de la politique de
contrôle et de mainmise du pouvoir.
Cette politique a conduit les journalistes du quotidien « La Presse » à dénoncer
publiquement les pratiques restrictives dont ils étaient la cible. En 2008, ils ont mené une
campagne de protestation contre la dégradation de la situation au sein de l’entreprise31. En
2009, ils ont adressé au pouvoir et à l’opinion publique une pétition signée par 34 journalistes
pour protester contre la marginalisation et le pourrissement du climat social32. Le syndicat de
base de l’entreprise, relevant de l’UGTT, a adopté, le 28 juin 2010, une motion professionnelle
demandant aux pouvoirs publics, au nom des journalistes et agents de la SNIPE, d’intervenir
pour apporter des solutions concrètes aux problèmes qui se posent, menaçant de porter le
brassard rouge.
Après la révolution du 14 janvier 2011, la situation ne s’est pas du tout améliorée. Les
relations sont restées tendues entre les journalistes et l’administration au sein du quotidien
« La Presse ». Par ailleurs, la SNIPE a connu une grave crise sociale à la suite du projet
avancé par la direction générale d’assainir la situation nancière décitaire du quotidien
« Essahafa » qui constitue, selon la direction, un «fardeau » pour l’entreprise.
En effet, l’ancien PDG de la SNIPE, Hmida Ben Romdhane, a annoncé, le 12 février 2011,
lors d’une réunion du conseil d’administration, sa décision d’arrêter la parution du quotidien
« Essahafa » et son remplacement par une version électronique. Devant le tollé général
soulevé par cette décision, la direction générale a été obligée de reculer et de présenter une
nouvelle proposition qui consiste à transformer le quotidien « Essahafa »
en un journal hebdomadaire. Proposition qui a été catégoriquement rejetée33, obligeant
la direction générale à renoncer dénitivement à son projet de restructuration du quotidien
« Essahafa ».
Il convient de noter que le revenu des ventes du quotidien « Essahafa » ne représente
que 5% des recettes de l’entreprise et ne couvre que 25% de la masse salariale de ses
employés34.
En mai 2011, le PDG de la SNIPE a afrmé que l’entreprise perd annuellement 2 millions
de dinars et que les pertes quotidiennes résultant de l’impression du quotidien « Essahafa »
s’élèvent à 5500 dinars35.
31 http://www.gnet.tn/temps-fort/des-journalistes-de-la-presse-montent-au-creneau/id-menu-325.html
32 Pétition rendue publique le 30 avril 2009
33 http://www.almasdar.tn/management/article-4653 (en arabe) sit-in des journalistes du quotidien « Essahafa » au siège
du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), le 24 mai 2011
34 Rapport de l’instance générale de contrôle des services publics relevant du Premier Ministère, daté du 22 septembre
2008
35 Déclaration du PDG de la SNIPE au quotidien « Assabah » le 26 avril 2011 http://www.assabah.com.tn/article-52589.
html (en arabe)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%