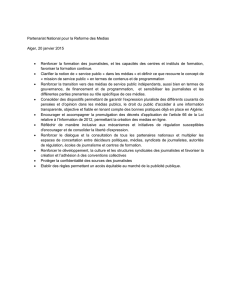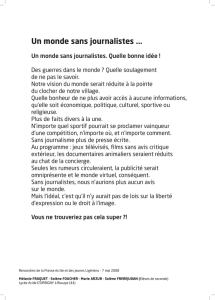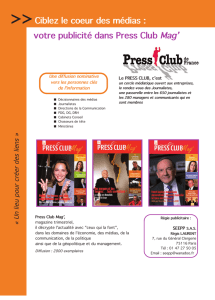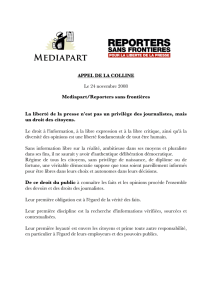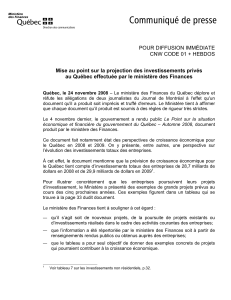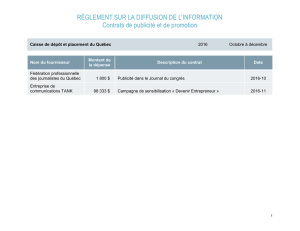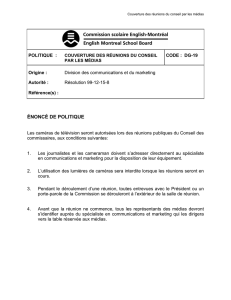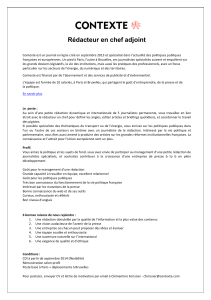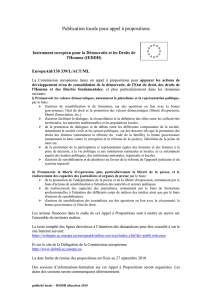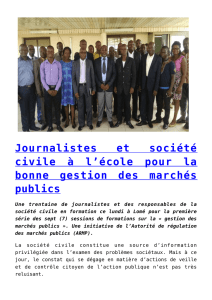Le conseil de presse : une opportunité à saisir

APCP
ASSOCIATION DE PREFIGURATION D'UN CONSEIL DE PRESSE
Un conseil de presse : une opportunité à saisir par les journalistes
Quelles garanties offrent les journalistes à leurs publics que leur travail est réalisé selon une
déontologie rigoureuse ? Aucune profession ne peut prétendre à la crédibilité auprès de ses
partenaires (public, autorités, etc.) si elle ne leur garantit pas que ses “productions” sont élaborées
selon des principes éthiques et de qualité. Cela n’a jamais été le cas en France, la profession n’a
pas su ou voulu donner ce gage de discipline et de bonne volonté. Résultat : son image et la
confiance du public sont sérieusement écornées.
Un conseil de presse offrirait aux journalistes une opportunité exceptionnelle, voire
« historique » : donner enfin vie à une régulation indispensable pour la reconquête de leur
crédibilité. Une régulation dans laquelle ils auront leur mot à dire (à l’inverse du Conseil
supérieur de l’audiovisuel ou de la Commission paritaire des publications et agences de presse,
par exemple). L'idée d'un conseil de presse, c'est-à-dire essentiellement une instance nationale de
médiation (et non pas un conseil de l'ordre), peut constituer une aide (et non un frein) pour les
journalistes.
Ceux qui voient dans le conseil de presse la figure d’un Père fouettard destiné à limiter le champ
d’action des journalistes ne parlent assurément pas du projet d’instance élaboré par l’APCP.
Notre proposition voit au contraire dans un futur conseil de presse un outil destiné à renforcer
autant la liberté d'expression des journalistes que la qualité de leur travail. En effet, grâce à
l'existence d'une telle instance, le journaliste pourra plus facilement exciper de sa liberté et du
droit du public à une information de qualité pour résister aux pressions des pouvoirs, de la
publicité et même de son employeur. Il aura un appui extérieur face aux pressions externes
comme internes, contre lesquelles il est aujourd'hui pratiquement désarmé. Il pourra alors
s'appuyer sur sa mission d'intérêt général (« chien de garde de la démocratie », comme le dit la
Cour européenne des droits de l'homme) pour résister aux pressions multiformes.
A l'heure où les nouvelles technologies bouleversent la profession, celle-ci peut saisir sa chance
d'évoluer en créant elle-même (sans attendre que les pouvoirs l’imposent) et en la cogérant une
instance de mediation avec les éditeurs et le public. Cette régulation sera nécessaire, en outre,
pour empêcher l’explosion du métier en expressions « citoyennes » ouvertes à toutes les dérives.
En montrant sa bonne volonté, en s'engageant à plus de rigueur dans son travail et de
responsabilité face à la société, le journalisme pourra ainsi clairement protéger sa spécificité.
Un tel conseil serait aussi un lieu de débat public sur les questions déontologiques de la presse:
pédagogie sur les normes éthiques et les conditions d’élaboration de l’information, arbitrage,
régulation, sanctions symboliques (médiatiques), réflexion sur les évolutions du métier et des
besoins du public, etc. Il améliorerait ainsi les relations entre les publics des médias et les
professionnels de l’information.
1
/
1
100%