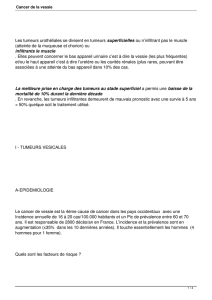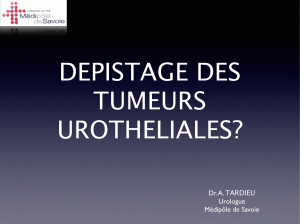les tumeurs superficielles de la vessie

R É S U M É
Cet article résume le rapport de
l’Association Française d’Urologie (AFU)
s u r les tumeurs superficielles de la vessie.
Les principaux aspects abordés sont la
classification pathologique, l’identifica-
tion des groupes à risque, l’histoire natu-
relle, les standards thérapeutiques, l’inci-
dence des progrès de la biologie molécu-
l a i re sur la pratique clinique, la place de
la cystectomie et les modalités des instilla-
tions endovésicales.
Mots Clés Tumeurs superficielles de la ves-
sie, instillations endovésicales, cystectomie,
Association Française d’Urologie.
A B S T R A C T
This paper summarized the re p o rt on
superficial bladder c a n c e r of the Fre n c h
u rological association. Major topics inclu-
de pathological classification, tumor g ro u-
ping according to risk, natural history
therapeutic standards, impact of molecu-
l a r biology on practical management, the
place of cystectomy and modalities of
intravesical instillations.
Key Words Superficial bladder cancer, blad-
der instillations, cystectomy, A s s o c i a t i o n
Française d’Urologie
Les tumeurs superficielles de la vessie repré-
sentent un groupe hétérogène de tumeurs qui
se caractérisent par la difficulté d’apprécier
leur pronostic au diagnostic initial et donc
les indications thérapeutiques. Le dernier
rapport sur les tumeurs de vessie avait été
fait par Hugues Bittard en 1985 [1]. Depuis
cette date, les instillations endovésicales ont
transformé la prise en charge de ces tumeurs,
de même les progrès dans la biologie tumo-
rale permettent d’envisager une classifica-
tion moléculaire et de démembrer ce spectre
de tumeurs en fonction de leur potentiel évo-
lutif. L’objectif de ce rapport est de faire le
point sur les données clinico-pathologiques
qui permettent de définir parmi les tumeurs
urothéliales vésicales les groupes à risque :
faible risque, risque intermédiaire et haut
risque, afin de rationaliser leurs indications
thérapeutiques et leur surveillance.
Dans les pays industrialisés et développés
l’incidence des tumeurs de la vessie va crois-
sante alors que la mortalité stagne ou est en
légère régression [1, 2]. Cette évolution peut
s’expliquer par deux éléments, d’une part,
les changements de classification, qui
I. EP I D E M I O L O G I E
INTRODUCTION
1
RESUME DU RAPPORT 2001 DE
L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’UROLOGIE (AFU) SUR
LES TUMEURS SUPERFICIELLES
DE LA VESSIE
Dominique K. CHOPIN1, Bernard GATTEGNO2
1Hôpital Henri Mondor - Services d’Urologie, Creteil.
2Hôpital Tenon Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

incluent ou excluent des tumeurs à faible
potentiel de malignité, d’autre part, l’eff e t
d’une meilleure prise en charge thérapeu-
tique. En France, en l’an 2000, les données
du CIRC (Centre International de Recherche
sur le Cancer) montrent que les tumeurs de
vessie représentent la 5ème cause de cancer
et la 3ème des décès par cancer [3]. En ce
qui concerne ces décès 75% surviennent
chez l’homme et 25% chez la femme. Les
tumeurs de la vessie sont responsables chez
l’homme de 20% de décès prématuré, c’est-
à-dire avant l’âge de 65 ans. Leur incidence
est en augmentation d’environ 1% par an, le
sexe ratio est de 1 pour 5. Les cancers de ves-
sie sont induits par des carcinogènes exogè-
nes ou endogènes ce qui a plusieurs implica-
tions tout d’abord ces tumeurs possèdent des
caractères immunogéniques [4] qui leur sont
propres et ensuite que certaines d’entre elles
peuvent être évitables si les carcinogènes
sont bien identifiés [5]. C’est notamment le
cas des facteurs professionnels, on estime
qu’actuellement jusqu’à 20 % des patients
présentant des tumeurs de vessie ont une
exposition professionnelle significative [6],
en particulier aux amines aromatiques, aux
hydrocarbures aromatiques polycycliques,
ou au nitrosamines. La reconnaissance des
tumeurs de vessie comme maladie profes-
sionnelles reste encore largement à explici-
t e r. Acôté de ces facteurs, il faut tenir comp-
te de facteurs génétiques de susceptibilité,
notamment les enzymes de détoxification
N AT1, NAT2 [7]. En ce qui concerne les
carcinogènes exogènes la première cause est
représentée par le tabac, les causes environ-
nementales sont l’intoxication à l’arsenic et
la néphropathie des Balkans. Parmi les cau-
ses infectieuses il faut souligner la schistoso-
miase et l’infection chronique notamment
dans les vessies neurologiques. Enfin, il a été
mis en évidence certaines causes iatrogènes
comme la radiothérapie ou intoxication pro-
longée à l’endoxan.
1 .LE
G R A D E
E T L E S TA D E Q U E L L E C L A S S I F I-
C AT I O N U T I L I S E R ?
Le grade a été défini par la classification de
l ’ o r ganisation mondiale de la Santé (OMS).
La plupart des articles utilise la classification
de 1973 [8] qui distingue les papillomes
(tumeurs bénignes) des carcinomes urothé-
liaux qui sont classés en 3 grades G1, G2,
G3. Récemment, le consensus de 1998
regroupant l’OMS et la Société Internatio-
nale de Pathologie a introduit la notion de
tumeurs à faible potentiel de malignité
( L M P /low malignant potential) qui représen-
te une certaine population des G1 [9]. Les
autres tumeurs étant séparées en bas grade et
en grade élevé. Plus récemment encore, la
classification de l’OMS a rétabli la classifi-
cation G1, G2, G3 tout en conservant la
notion de tumeurs à faible potentiel de mal-
ignité [10] (Tableau 1). Ces dernières classi-
fications ne sont pas admises par tous et font
l’objet d’une controverse. Dans ces condi-
tions il est recommandé de toujours utiliser
pour le Grade la classification de 1973. En ce
qui concerne le stade, la classification T N M
de 1997 est recommandée pour les lésions
papillaires, qui sont divisées en pTa et pT1.
Par contre pour les lésions planes, il est
recommandé d’utiliser la classification de
1998 [9] qui simplifie ce groupe de lésion en:
carcinome in situ, dysplasie et atypie.
Les pathologistes du comité de cancérologie
de l’Association Française d’Urologie
(CCAFU) recommandent d’utiliser la notion
p Ta avec basale douteuse et de subdiviser les
pT1 en pT1a et pT1b, si la musculaire
muqueuse peut être mise en évidence selon
son franchissement. Dans tous les cas, il est
indispensable en cas de tumeur pT1 notam-
ment de pT1b que soit précisée la notion de
muscle vu ou non vu sur le spécimen.
II. CL A S S I F I C AT I O N
C L I N I C O P
AT H O L O G I Q U E
2

2 . VA R I AT I O N S D E L’I N T E R P R É TAT I O N
PA
T H O L O G I Q U E
Plusieurs études ont mis en évidence le
risque de variation d’interprétation patholo-
gique [11]. En ce qui concerne le stade, les
tumeurs initialement classées pT1 sont sur-
évaluées dans 27 à 35% des cas. A l ’ i n v e r s e
pour les tumeurs pTa initiales, les tumeurs
classées initialement pTa une relecture
n’entraîne une modification du diagnostic en
pT1 que dans 2 à 8% des cas. En ce qui
concerne le grade, il existe par contre une
tendance à sous grader les tumeurs au dia-
gnostic initial puisque 60% des G1 sont
reclassés G2 et 42% des G2 sont reclassés
G3. Ces variations d’interprétation patholo-
gique soulignent l’intérêt d’une deuxième
lecture lorsqu’une décision particulièrement
importante est à prendre, en particulier
lorsque se discute un traitement radical alors
que le patient était jusqu’alors traité de façon
conservatoire. Afin d’homogénéiser l’inter-
prétation des résultats une “fiche vessie” est
proposée qui doit fournir au pathologiste les
renseignements macroscopiques de la lésion
et à l’urologue les éléments histologiques
décisionnels. C’est l’objectif des marqueurs
moléculaires que d’apporter une aide à la
classification de ces tumeurs.
3. M
A R Q U E U R S M O L É C U L A I R E S D U P R O N O S T I C
Afin de mieux préciser le pronostic d’une
tumeur au moment du diagnostic initial ou
au cours de la progression,de nombreux
investigateurs se sont attachés à identifier les
étapes moléculaires critiques de cette pro-
gression [12]. Cette démarche vient d’une
part de l’insuffisance pronostique des critè-
res clinico-pathologiques et de la variété de
leur interprétation. Parmi les marqueurs les
plus étudiés, il faut citer les gènes suppres-
seurs de tumeurs et, les oncogènes. En ce qui
concerne les gènes suppresseurs de tumeurs
il s’agit pour le cancer de vessie principale-
ment des régulateurs négatifs du cycle cellu-
laire en particulier de la transition G1-S. Les
gènes les plus souvent altérés dans leur
structure ou leur expression sont p 5 3 et R b.
Récemment un intérêt particulier s’est foca-
lisé sur les inhibiteurs des cyclines en parti-
culier p16, p27 et p 1 5. En ce qui concerne
les oncogènes les altérations concernent les
voies de signalisations régulant positive-
ment la croissance cellulaire dont le récep-
teur à l’EGF ainsi que les autres membres de
sa famille, parmi les régulateurs positifs du
cycle cellulaire la cyline D1. En ce qui
concerne l’oncogène RAS seul un polymor-
phisme de certains allèles a été mis en évi-
dence. Récemment, certaines mutations du
FGFR3, mutations activatrices, ont été mises
en évidence dans un pourcentage élevé de
tumeurs superficielles de la vessie [13].
C’est probablement la combinaison de ces
marqueurs plus que l’expression d’un seul
qui permettra de caractériser sur le plan
moléculaire ces lésions d’un point de vue
p r o n o s t i q u e .
4. PR O N O S T I C D E S T U M E U R S U R O T H É L I A L E S
Le pronostic est actuellement défini unique-
ment sur des critères clinico-patholologiques
qui concernent le type histologique, le grade,
le stade, la présence de carcinome in situ. Il
est essentiel que le pathologiste précise si le
muscle est vu ou non sur le spécimen et en
cas de doute une relecture doit être eff e c t u é e .
Afin de standardiser ces paramètres une
3
Tableau 1 : Correspondance entre les classifica -
tions du grade selon l’OMS : OMS 1973 /
Consensus OMS-ISUP1998 / 0MS / 1999

4
TUMEURS DE LA VESSIE - FICHE ANATOMOPATHOLOGIQUE
FICHE VESSIE

5
Profondeur du prélèvement endoscopique : végétation tumorales seules
chorion vu muscle vu
Mode de croissance : Tumeur végétante papillaire
Tumeur bourgeonnante/solide
Tumeur interstitielle
Remaniement tumoraux : Nécrose : 0 +++ +++
Type de tumeur
Tumeur urothéliale : forme commune
variante avec métaplasie épidermoïde avec métaplasie glandulaire autre variante (en clair) :
Grade (OMS) : G0 G1 G2 G3
Index mitotique : nombre de mitoses/10 champs de grandissement 40 …….
Carcinome épidermoïde Adénocarcinome Carcinome sarcomatoïde Sarcome Autres
Stade pTNM
pTx pT1 pT2 pT4
pTapT1A pT3A pTIS
pTa avec basale douteuse PT1B pT3B
Envahissement des organes de voisinage : Prostate VSD Utérus Vagin Rectum
Urothélium plan à distance de la tumeur :
0 - non analysé 4 - CIS
1 – ininterprétable 5 - métaplasie épidermoïde
2 – normal 6 – métaplasie glandulaire
3 – dysplasie 7 – autre
Dome F lat D F lat G F ant F post Trigone Col Uretère D Uretère G Uretère
Prélèvements pour études complémentaires :
Microscopie électronique Marqueurs de prolifération Congélation (banque)
ADN ploïdie p53 autres
Sections chirurgicales (0 : non analysée 1 : Saine 2 : Envahie)
Uretère D ……. G …..
Urètre
Graisse périvésicale
Plan séminale
Embols vasculaires : Lx L0 L- L+
Lésions dues au traitement : Résection BCG Chimiothérapie Radiothérapie Autres
Cancer prostatique associé : Siège : taille : capsule : limites : Gleason : pTNM :
CONCLUSION et Codes lésionnels :
DONNES MICROSCOPIQUES
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%