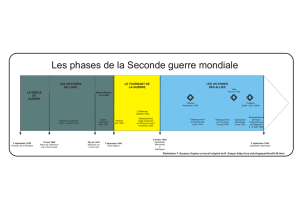Ève Chiapello et Patrick Gilbert, Sociologie des outils de

où les points de convergence et les liens entre
ces pays émergent au fil des pages. À cet égard,
l’ouvrage est utile à quiconque souhaite comparer
les situations nationales sur les questions de
fécondité mais aussi de rapports croisés, à la
famille et à l’emploi des hommes et des femmes,
d’une part, des individus et des politiques publi-
ques, d’autre part. C’est bien l’ambition de cet
ouvrage d’associer presque systématiquement
microcontexte et macroeffets, pratiques privées et
action publique, et d’apporter ainsi sa propre
réponse à la double dialectique du micro et du
macro, de l’empirique et de la montée en géné-
ralité. Cette ambition se trouve redoublée par la
démarche comparatiste d’un panorama inter-
national qui permet de percevoir ressemblances
et différences entre pays, non pas seulement entre
haut et bas taux de fécondité mais parmi les
pays les plus féconds. La France y apparaît encore
nataliste, l’État et les politiques familiales pro-
duisant des normes qui valorisent la maternité :
plus qu’elles ne luttent contre les inégalités entre
les hommes et les femmes, les politiques en
compensent plutôt les effets négatifs. Les politi-
ques familiales scandinaves, qui ont des points
communs avec la France, prônent davantage, et
de plus en plus, l’investissement paternel, notam-
ment à l’aide d’un congé parental réservé en
partie aux pères.
Frédérique Chave
Rédactrice en chef
Politiques sociales et familiales n° 116 - juin 2014
79 Comptes rendus de lectures
Les auteurs proposent, dans ce manuel, une
synthèse des travaux de recherche sur les outils
de gestion, dans une perspective d’analyse
sociale. Ils mettent à disposition du lecteur un
champ de recherches pluridisciplinaire (sociologie,
science politique, psychologie sociale et sciences
de gestion), sur des terrains variés. Les matériaux
sont issus en partie de cours et séminaires à l’École
des hautes études commerciales ou à l’Institut
d’administration des entreprises de Paris. La tona-
lité générale de l’ouvrage s’inscrit clairement dans
une dimension politique des outils de gestion et
non dans le registre utilitaire dans lequel ils sont
généralement cantonnés. La notion même d’« outil
de gestion » est questionnée. Elle dépend de l’angle
pris pour examiner sa matérialité qui peut ainsi
être distinguée selon son domaine fonctionnel
d’intervention, selon le résultat escompté ou selon
l’usage qui en est fait.
Le regard des auteurs se focalise sur ce qui se
passe dans le quotidien des entreprises aujourd’hui,
à travers l’analyse de la multiplicité des outils de
gestion développés ces trente dernières années :
référentiels, tableaux de bord, badges, charte des
valeurs, Customer Relationship Management (CRM –
progiciel de gestion de la relation client), logiciels
intégrés, audits, indicateurs, contrôle de gestion…
Le propos n’est pas d’inventorier ces différents
outils mais de s’interroger sur les raisons pour
lesquelles les entreprises et les services publics
s’en saisissent et sur leurs impacts sur le travail
des salariés. Ce foisonnement d’outils a pris davan-
tage d’ampleur depuis la révision générale des
politiques publiques (RGPP) et des bataillons de
consultants ont progressivement transposé les
pratiques du privé vers le public. Il n’est pas question
ici de décrire les procédés et les techniques mais
bien de sortir les outils de gestion de leur invisibi-
lité et de les soumettre à un examen, à une contre-
expertise démocratique.
En effet, ces instruments techniques, à dimension
quantitative le plus souvent, ne sont pas neutres et
sont impactés par les lieux où ils sont implantés.
Ils sont historiquement associés à l’action bureau-
cratique à travers des règles formelles et de la
prévisibilité et ont vu leur développement décoller
avec l’arrivée des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication. Les auteurs souli-
gnent également que ces outils homogénéisent
les pratiques, lissent les métiers et rendent la
frontière entre public et privé plus poreuse. La gestion
par la performance justifie l’utilisation de ces outils
Ève Chiapello, Patrick Gilbert
SSoocciioollooggiieeddeessoouuttiillssddeeggeessttiioonn
IInnttrroodduuccttiioonnààll’’aannaallyysseessoocciiaalleeddeell’’iinnssttrruummeennttaattiioonnddeeggeessttiioonn
2013, La Découverte, collection Grands repères, 294 pages.

qui contribuent par ailleurs à une meilleure trans-
parence et une lisibilité de l’action de l’État.
Les auteurs proposent, dans une première partie,
une réflexion sur la notion d’« instrumentation de
gestion » et décrivent trois types de comportements
face aux outils de gestion : le déni de la technique
et l’occultation de la place de ces instruments,
l’euphorie technophile où la technique s’appa-
rente à une passion et une modernité folle et la
technophobie où la technique est vécue comme une
oppression. Cette première partie permet égale-
ment de revenir sur les approches traditionnelles
des outils de gestion dans la théorie des organi-
sations, avec l’histoire de la pensée en sciences
de gestion et les travaux fondateurs de Frédéric
Winslow Taylor et Henri Fayol.
La partie centrale de l’ouvrage traite de l’analyse
sociale des outils de gestion à partir d’une copieuse
revue de littérature dans laquelle trois courants
théoriques sont repérés. Tout d’abord, les études
critiques qui considèrent que les outils de gestion
sont des leviers de domination ou d’exploitation
des travailleurs. L’une des manifestations de ce
courant porte sur la critique du technicisme et
l’évacuation de la subjectivité où la méconnais-
sance du travail effectif et l’idéologie de la trans-
parence ont des effets néfastes sur la santé des
salariés (Christophe Dejours, Yves Clot). Une autre
approche assimile l’outil de gestion à un vecteur
de déshumanisation et d’aliénation des sujets : des
cliniciens considèrent que certaines techniques de
management peuvent s’apparenter à de la mani-
pulation (Nicole Aubert, Vincent De Gaulejac).
Les études institutionnalistes qui s’intéressent au
rôle joué par les institutions dans le développement
des outils de gestion sont présentées en deuxième
partie de l’ouvrage. L’un des exemples porte sur
les normes proposées par des organisations inter-
nationales [Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), Union euro-
péenne, International Organization for Standar-
dization (ISO)] qui se révèlent être sources
d’homogénéité plus forte que la centralisation du
pouvoir et des décisions. Une autre approche
considère l’outil comme un « investissement de
forme », expression de François Eymard-Duvernay
et Laurent Thévenot qui sont également à l’origine
de l’approche conventionnaliste. La convention
permet à la fois de régler la coordination de l’action
dans un contexte d’incertitude mais elle permet
également de coordonner non seulement les
comportements mais également les représentations.
Le courant de l’approche néo-institutionnaliste
repose sur des études qui s’appuient sur les inter-
actions entre outils et acteurs. L’accent est porté
sur l’autonomie de ces derniers. Le statut de l’outil
de gestion est différent selon les thèses mobilisées.
En voici trois types illustratifs :
•la théorie de l’acteur-réseau (Michel Callon,
Bruno Latour, Madeleine Akrich) où « la société et
les sciences se mélangent », et où les chercheurs
s’intéressent au rôle que les outils de gestion
jouent dans les organisations et à la façon dont ils
agissent ;
•l’outil comme être de langage où l’accent est
mis sur la dimension communicationnelle des
organisations et qui confirme la simultanéité de
l’outil et du langage (travaux du réseau de recherche
Langage et Travail autour d’Anni Borzeix et
Béatrice Fraenkel) ;
•la théorie de l’acteur stratégique élaborée par
Michel Crozier et Erhard Friedberg où les compor-
tements ne résultent pas d’un déterminisme mais
d’une intention stratégique des acteurs sociaux et
où les stratégies individuelles dans le changement
et la régulation de l’action dans les organisations
sont importantes.
La dernière partie de l’ouvrage est constituée de
quatre études de cas réalisées par de jeunes
chercheurs qui complètent et illustrent les aspects
théoriques présentés précédemment. Les thèmes
abordés sont variés : le choix des indicateurs de
performance de l’enseignement supérieur et de
la recherche, les ratios prudentiels de l’activité
bancaire, le rôle d’un progiciel dans un processus
de changement des pratiques de gestion de la
relation-clientèle, les dispositifs de financement
de l’action sociale. Chaque outil est éclairé d’un
point de vue théorique pour en montrer les consé-
quences et les enjeux.
Deux études de cas ont retenu notre attention de
par leur proximité avec les problématiques de la
branche Famille. Tout d’abord celui présenté par
Bernard Grall sur la mise en place d’un progiciel
CRM dans une entreprise. Cet outil permet notam-
ment de gérer les contacts avec les clients, les
usagers ou les partenaires, d’identifier et de définir
leurs profils et d’organiser la communication
avec eux. Le projet a duré trois ans et s’est révélé
complexe à mettre en œuvre, les logiques de
conception de la relation client étant différentes
entre celles inscrites dans le progiciel et celles
des commerciaux de l’entreprise. Par ailleurs,
des défaillances techniques lors de la phase de
lancement ont montré le rôle important de la
technique dans le processus d’appropriation par
les acteurs. Au final, le progiciel est un acteur à
part entière du processus d’appropriation par les
utilisateurs.
La seconde étude de cas présentée par Corine
Eyraud examine la mesure des actions publiques
mise en place dans le cadre de la loi organique
relative aux lois de finances. Elle décrit ces pro-
cessus de quantification comme le produit de
rapports de force entre les différentes administrations
ministérielles, et souligne combien la construction
de l’information chiffrée sur le monde peut contri-
buer à orienter l’action publique, subordonnant
ici l’attribution des moyens à la performance des
établissements. Cette étude de cas confirme que
Politiques sociales et familiales n° 116 - juin 2014
80 Comptes rendus de lectures

les acteurs orientent leurs actions en fonction des
indicateurs.
L’ensemble des contributions conduit le lecteur
à porter un regard neuf et pluriel sur la place
des outils de gestion. Cantonnés à l’origine dans
l’entreprise, ces derniers gagnent désormais
d’autres sphères de la vie publique : l’État, l’éco-
nomie sociale, les organisations et les services
publics. Les auteurs invitent ainsi à une relecture
des travaux de base de la pensée en sciences de
gestion et ouvrent de nouvelles perspectives de
recherches.
Catherine Vérité
Cnaf – Département de l’animation de la recherche
et du réseau des chargés d’étude
Politiques sociales et familiales n° 116 - juin 2014
81 Comptes rendus de lectures
Il n’est pas décelable, à la lecture de son ouvrage
Tenir ! Les raisons d’être des travailleurs sociaux,
que l’auteur, Jean-François Gaspar, a lui-même
été travailleur social. Le sociologue belge (1),
auteur de cet ouvrage paru en 2012, s’était
notamment fixé comme objectif de « rendre
compte sociologique- ment de l’univers du travail
social sans enchantement ni prétention démystifi-
catrice » (p. 21). Il y est parvenu, en dépit ou
peut-être plutôt grâce au fait qu’il avait auparavant
exercé la profession pendant dix ans. Il est en
effet réputé « difficile d’enquêter auprès des
travailleurs sociaux » dans la mesure où ils « sont
soumis à des conditions de travail de plus en plus
difficiles (…) » et seraient « frottés plus ou moins
de sociologie » de sorte que « certains d’entre eux
voient les sociologues comme des concurrents
possibles » dont ils « ont de bonnes raisons de
chercher à contrôler étroitement le travail (…) »(2).
J.-F. Gaspar indique avoir « peu rencontré ce type
de difficulté (…) [étant] à la fois suffisamment
proche et familier de cet univers (…) pour ne pas
être considéré comme ignorant et suffisamment
éloigné pour ne pas être impliqué dans les enjeux
sociaux locaux » (p. 25).
La recherche dont rend compte l’ouvrage de
J.-F. Gaspar aura duré quatre ans au cours des
années 2000 durant lesquelles l’auteur aura couplé
observations et entretiens semi-directifs appro-
fondis avec treize travailleurs sociaux (deux à
quatre entretiens par professionnel). L’échantillon,
qui n’a pas vocation à être représentatif, a toutefois
été construit de façon à intégrer des profils divers
en termes de sexe, de types d’institutions, de
populations prises en charge et d’âge. Les enquêtés,
qui ont au moins cinq ans d’expérience, exercent
leur métier en Wallonie (Belgique), dans une ville
d’environ quatre-vingt-mille habitants située dans
un ancien bassin minier et sidérurgique, rebaptisée
« Chaliémon » par l’auteur. Le chômage y atteint
un taux de 40 % chez les jeunes âgés de moins de
25 ans et un habitant sur dix est en contact avec le
centre public d’action sociale (CPAS) de la ville
(équivalent en Belgique des centres communaux
d’action sociale français). C’est dans ce cadre
qu’évoluent différents types de travailleurs sociaux.
J.-F. Gaspar montre que les travailleurs sociaux
au sens large présentent des caractéristiques
contrastées.
Plus précisément, l’auteur parvient à établir une
classification des travailleurs sociaux qu’il a
étudiés en trois grandes catégories : les travail-
leurs sociaux « cliniques » ; les travailleurs sociaux
« militants » ; les travailleurs sociaux « normatifs ».
Chacun de ces types de travailleurs sociaux est
finement décrit ; ne sont évoqués ici que quelques
éléments parmi les plus saillants de son analyse.
Dans la classification construite par J.-F. Gaspar,
les travailleurs sociaux dits « cliniques » sont des
travailleuses. L’auteur esquisse des éléments d’ana-
lyse genrés de cette catégorie et plus largement de
la profession dont on sait qu’elle est à la fois très
féminisée et, paradoxalement, peu souvent abordée
sous cet angle. Les travailleuses sociales évoluent
Jean-François Gaspar
TTeenniirr!!LLeessrraaiissoonnssdd’’êêttrreeddeessttrraavvaaiilllleeuurrssssoocciiaauuxx
2012, Paris, La Découverte, collection Enquêtes de terrain, 240 pages.
(1) J.-F. Gaspar est maître assistant responsable de la recherche dans le Master en ingénierie et action sociale de
Louvain-la-Neuve à Namur, et membre associé du Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-Paris).
(2) Beaud S., Weber F., 2002, Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte, collection Repères.
1
/
3
100%