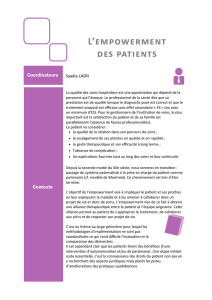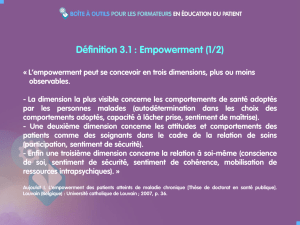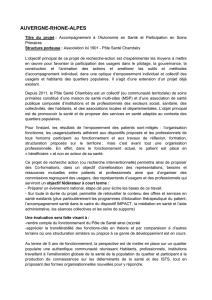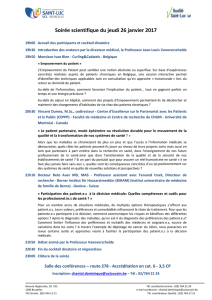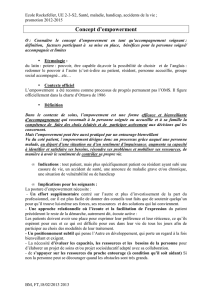Des NOTES de LECTURE - Plateforme d`hébergement Centres

Des NOTES de LECTURE
… 15 novembre 2014 …
« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole associatif qui,
souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec ceux qu’elles
intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du moment et les choix de
l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant qu’elles inciteront à lire, à nourrir le
travail et les réflexions des acteurs bénévoles et professionnels, dans l’accord comme dans
le débat contradictoire ! Les ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.
Site : http://www.centres-sociaux.fr/ - rubrique : « Ressources / Notes de lecture »
. Guillaume le BLANC, Que faire de notre vulnérabilité ? - Editions Bayard, Le temps
d’une question, 2011. [216 p., 15 Euros].
Un certain nombre d’études aux thèmes proches se sont multipliées ces dernières années.
Elles ont en commun de tenter un approfondissement et un renouvellement des questions
liées à la disqualification, la désaffiliation ou la relégation. Elles touchent le social, le
sanitaire, le médico-social, mais sous l’angle plus général de la précarité, mieux,
concernent la vulnérabilité humaine. Au-delà des compétences sociologiques,
psychologiques ou politiques qu’elles requièrent, ces approches sont une interpellation
philosophique qui cherche ses sources dans le terrain de la théorie sociale contemporaine,
aux frontières de la philosophique politique et sociale. Elles s’énoncent en termes de
reconnaissance versus mépris, d’utilité sociale versus inutilité, de capacités, ‘capabilités’
ou ‘capacitations’ versus déclassement. En un mot, la question se travaille comme
‘visibilité’ versus ‘invisibilité sociale’. Tel est l’objet des ouvrages de Guillaume LE BLANC
que nous recommandons à lecture.
« Que faire de notre vulnérabilité ? » constitue à nos yeux une excellente
introduction par l’auteur lui-même. LE BLANC, se pliant au genre « synthèse
pédagogique » et « ouverture de la problématique » de la petite collection Le
temps d’une question, chez Bayard, fait découvrir l’étendue et le sens de ses
recherches, en quoi et comment elles peuvent servir une stratégie. Il s’agit de
renouveler nos approches de l’existence humaine à partir d’une compréhension
plus lucide de la finitude et de la vulnérabilité – celles des êtres vulnérables
(enfants, personnes âgées, handicapés… ceux qu’il faut « protéger ») et, plus
universellement, la vulnérabilité des humains, des êtres vivants, de la planète… Et
d’inventer en conséquence de nouveaux référentiels de développement – éthique,
économique et écologique…- qui ne se contentent plus des modèles déjà formatés
en d’autres contextes historiques et se globalisent selon des standards imposés par
les dominants.
Une citation peut servir à illustrer le ‘programme’ de cette démarche : bien des
acteurs du social y reconnaîtront tant leurs préoccupations éthiques que
convictionnelles ou méthodologiques. Nous vivons dans un monde paradoxalement
tiraillé entre deux contradictions : « D’un côté, nous sommes de plus en plus
absorbés par les impératifs économiques de la cité : nous n’avons jamais été
autant sollicités pour produire et consommer… (…) D’un autre côté, nous sommes
de plus en plus précarisés dans la cité et nos vies nous apparaissent comme
hautement fragiles. Que peut-on faire de cette fragilité ? Peut-on la retourner
1

contre les présupposés autoritaires de la cité et la faire jouer comme une autorité
alternative ? » [p.14]
Cette question est au cœur de l’ouvrage et en anime la démarche. Il s’agit de
questionner la puissance d’agir des « sans-pouvoirs » ou des « invisibles » - ou tout
du moins de ceux d’entre nous que l’on qualifie de tels… Ces exclus ne sont pas des
sujets négatifs qui attendraient leur insertion/intégration (au sens d’être remis sur
les rails de la loi de la cité, c’est-à-dire selon ses normes) : à l’image de l’Antigone
de la tragédie grecque, qui refuse la loi de la cité qui lui interdit d’enterrer son
frère, les exclus « portent une voix qui conteste le privilège de la loi qui inclut es
uns pour exclure les autres. C’est cette voix qui perce dans les mouvements
sociaux, politiques par lesquels des vies en viennent à reconsidérer ce qui les lie à
la cité. » [p.15]
Voilà qui appelle à renverser le regard sur ce que l’on considère comme le normal
ou le non-normal1, soit, au regard des normes politiques et sociales, savoir ou
décider (de) qui est exclu, qui est intégré ; et, à plus forte raison, quand les
fomats économiques et sociales de l’intégration produisent de plus en plus
d’exclus2.
Ainsi, et c’est l’axe de travail de LE BLANC : « L’exclu, en son invisibilité réelle, en
sa dangerosité supposée, l’absent des places et des classements, par la persistance
de sa voix et de son agir, interroge le cours normal présumé des choses… » [p.16].
En refusant d’être considéré dans le champ du pathologique, « il nous contraint à
nous révéler à nous-mêmes notre fond de vulnérabilité commune », à l‘accepter,
et à nous questionner sur ce qui aujourd’hui fait monde commun.
1
1
Guillaume Le Blanc dans ses travaux universitaires à travailler notamment sur le grand penseur du savoir
médical, Georges Canguilhem, dont un célèbre ouvrage interroge les frontières et les passages entre le
Normal » et le « pathologique ».
2
2
Sans aller chercher les études statistiques de la DARES sur les évolutions de la pauvreté/précarité dans les
dernières décennies, les chiffres de la pauvreté des enfants récemment présentés par l’UNICEF sont
suffisamment éloquents : le taux de pauvreté des moins de 18 ans en France a grimpé de trois points, passant
de 15,6% à 18,6 % entre 2008 et 2012, soit une augmentation nette d'environ 440.000 «enfants de la
récession».
Depuis le début de la crise financière en 2008, 2,6 millions d'enfants ont sombré dans la pauvreté dans les 41
pays les plus riches du monde, selon un rapport publié ce mardi par l'Unicef. Environ 76,5 millions d'enfants
vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté (fixé à 60% du revenu médian) dans ces pays. En France, le taux de
pauvreté des moins de 18 ans a grimpé de trois points, passant de 15,6% à 18,6 % entre 2008 et 2012, soit une
augmentation nette d'environ 440.000 «enfants de la récession». Voir le rapport Innocenti 10 pour l’UICEF,
Mesurer la pauvreté des enfants, 2012. Chiffres diffusés dasn la presse française fin octobre 2014.
http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_Innocenti_Mesurer-la-pauvrete-des-enfants_2012%281%29.pdf
2

Le sommaire de l’ouvrage rend compte par ces intitulés de cet itinéraire de
pensée. Il vaut la peine de l’exposer intégralement :
Introduction : Le sentiment
d’exclusion
1 - DROIT DE CITE
. Frontières politiques
. "La vie est survie"
. Expulsables
. Exclus des pouvoirs, pouvoirs des
exclus
. Les angles morts de la citoyenneté
2 - AU NOM DES AUTRES
. Sujets irreprésentables
. Les "sans-voix" ont-ils une voix ?
. Voix subalternes et porte-voix
. Prises de parole
. Au nom des autres malgré tout
3 - LA NOUVELLE QUESTION SOCIALE AUJOURD'HUI
. Elargir la sphère publique
. Les contre-espaces publics
. Une vie aura été exclue
. Droit d’assistance contre le refus du droit d’ingérence
. « Care » et « empowerment »
Conclusion : Vies invivables
Parmi les questions qui nous éveillent à cet autre regard, une attention toute
particulière doit être accordée à celle des articulations et contradictions entre
l’approche par las philosophie et la méthodologie du « prendre soin » ou « Care »,
d’une part, et celle de la capacité ou pouvoir d’agir (« empowerment ») : un
chapitre entier lui est en effet consacré, à la mesure du débat entre les différentes
conceptions.
Nous avons attiré récemment l’attention sur ces deux thématiques, en leur
consacrant des notes de lecture. Nous y renvoyons volontiers les lecteurs intéressés
(mais qu’ils aillent surtout vers les œuvres présentées) car leurs auteurs offrent
d’excellentes introductions critiques à ces concepts, aux bonnes conditions de leurs
usages et, surtout, à la meure de leurs limites3. Au-delà des risques
3
3
- Sur le « care », les philosophies auxquelles se réfère cette approche et les enjeux qu’elle engage, voir :
Fabienne BRUGERE, L’Ethique du « care », Que Sais-je ? PUF, 2011.
Voir également, sur la vulnérabilité : Corine PELLUCHON, Eléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les
hommes, les animaux, la nature… éditions du Cerf, 2011 ; Martha C. NUSSBAUM, Capabilités. Comment créer
les conditions d'un monde plus juste ?, Flammarion, coll. « Climats », 2012, ( trad., Solange Chavel).
Dans le prolongement de la note de lecture précédente (octobre 2011) sur le « Que sais-je ? » de Fabienne
BRUGERE, «
Sur le site FCSF, notre note de lecture sur cet ouvrage : http://www.centres-sociaux.fr/2011/10/28/note-de-
lecture-l%E2%80%99ethique-du-%C2%AB-care-%C2%BB-par-fabienne-brugere/
- Sur le « pouvoir d’agir », l’« empowerment », voir : Marie-Hélene BACQUE, Carole BIEWENER :,
L'empowerment, une pratique émancipatrice, La Découverte, coll. « Sciences Humaines / Politique et sociétés »,
2012. Sur le site FCSF, idem : http://www.centres-sociaux.fr/2013/04/24/note-de-lecture-lempowerment-une-
pratique-emancipatrice-marie-helene-bacque-et-carole-biewener/
- Et, associant les pratiques des acteurs des centres sociaux : « On voudrait entendre crier toutes les voix de nos
cités. Paroles d’habitants des quartiers en politique de la ville ». Rapport national. Fédération des Centres
sociaux et socioculturels de France (FCSF) et Question de Ville (association des directeurs des centres de
ressources de la politique de la ville), 2012.
Sur le site FCSF, idem : http://www.centres-sociaux.fr/2013/02/26/note-de-lecture-on-voudrait-entendre-crier-
toutes-les-voix-de-nos-cites-fcsfquestions-de-ville/
3

d’interprétations plus ou moins déviantes qui accompagnent ce qui peut être perçu
comme des effets de mode, notamment lorsqu’on utilise en français des termes
issus des travaux des chercheurs anglo-saxons, on peut évaluer comme pertinente
la question ouverte par l’entrée de ces notions dans le champ de la réflexion
sociale et, surtout, par son articulation avec la pensée philosophique de la
reconnaissance.
Guillaume LE BLANC invite à considérer en effet qu’il y continuité entre le vivre et
le survivre : « la nécessité de survivre ne commence pas avec le manque social (de
logement, de ressources, de papiers…) elle commence avec la vie elle-même, dès
ors qu’elle et exposée à la perte, à la possibilité d’être sans […] La vulnérabilité,
comme monde de la perte, exposition à la blessure, est bien ce qui rend le vire et
le survivre indissociables. » [p.49]. On est alors fondé à désigner comme précarité
ce commun de la vie, du vécu et des vécus – de ce que ces penseurs nomment « la
vie ordinaire ». Il s’agit là non pas du sens sociologique, ou psychologique voire
seulement économique de la précarité, mais de ce que la tradition philosophique
appelait naguère la finitude, autrement dit, le caractère de précarité
intrinsèquement (ou, plus précisément, ontologiquement) attaché à toute vie. Ces
remarques non seulement affectent à tout être la condition de vulnérabilité,
quelques soient les aggravations de celle-ci lorsque les processus d’exclusion
pluridimensionnels interviennent, mais interpellent la condition des « sans-voix » :
ils ont quelque chose à dire et à se voir restaurer le droit à la parole qui leur a été
confisqué ; et cela vaut non seulement pour les dominants qui leur dénient ce droit
– par exemple en faisant jeu de la stigmatisation des « assistés » -, mais
également, et plus insidieusement, pour ceux qui se prétendent ou s’instituent
comme porte-parole des « sans », non pas comme « porte-voix », mais comme
« prête-voix ». C’est l’autocritique que l’on doit élaborer en tant
qu’intellectuel...de gauche : « Ne faut-il pas accueillir avec scepticisme le gage
de la voix perdue de l’exclu(e) et la promesse de sa restauration à l’identique
dans la voix hautement qualifiée de l’intellectuel ? » Ce qui revient à traiter, de
fait, les « sans-voix » comme des « subalternes » que la voix de l’intellectuel
saurait seule exprimer : position on ne peut plus autocentrée sur la compétence de
l’interprète qui est « dedans » au lieu de rendre à l’autre – qui est « dehors » - sa
propre parole ; et ce qui aboutit à le marginaliser une fois de plus, comme par une
double peine. [Voir plus particulièrement, p. 94-105 : « Les sans-voix ont-ils une voix ? » et p.
106-122 : « Voix subalternes et porte-voix ».]
Ces remarques nous orientent vers la bonne pratique qui consiste à rendre la parole
– soit à faciliter l’accès au droit à la parole - plutôt que de parler au nom des
autres : ce dont rend compte la démarche du travail social conçu ces dernières
décennies sous la démarche du développement social local et qui s’exprime dans
des formules telle que : « faire avec », ou « faire par », au lieu de « faire pour ».
Mais, là encore, LE BLANC nous et en garde : nous sommes pris entre deux axes de
travail qui ouvrent autant de potentiels que de risques. Et, pour éviter de se laisser
emporter par des engagements plus idéologiques qu’évalués et argumentés, il
nécessaire d’en relever les contradictions aussi bien que les ressources.
Pour une introduction très abordable de ces questions, et notamment pour remettre à leur place les
polémiques qui se sont développées notamment autour des questions posées par les « gender studies » - trop
souvent caricaturées et simplifiées en « théorie du genre » -, se reporter à l’entretien de la philosophe
Fabienne BURGERE avec Elodie Maurot : « Qui a peur des philosophes ? », Editions de l’Eclat, octobre 2014.
4

Le paragraphe « Care » et « empowerment » est situé dans un chapitre intitulé
« La nouvelle question sociale aujourd’hui » [p. 143sq]. Il illustre bien les
contradictions en jeu. On peut y voir en effet une tentative originale visant à
articuler deux logiques qui saisissent de manière différente, la réalité de
l’aliénation, de l’exploitation sociale. D’une part, selon la tradition ouverte par
l’analyse à partir de la sphère économique - l’accumulation du capital accaparée
par la classe dominante aux dépends des dominés ; considérant l’aliénation subie
par l’exploitation du travail, cette approche est une saisie collective, par les
classes sociales ou par les masses et, partant, justifie des politiques sociales
d’accompagnement, de prise en charge…qui ont traditionnellement été regroupée
sous le terme d’ « assistance ». Celle-ci i s’exerce par les redistributions sociale et
les services sociaux. Mais à l’extrémité de cette logique, « il y a la dépendance des
toutes les vies et plus encore l’assistance aux vies impuissantes qui ont été
exclues du marché économique, qui sont considérées comme ne pouvant plus
participer à la cité… » [p.181]
Un autre courant, différent quant à son angle d’attaque, développe une analyse en
termes d’individus, à partir de la désaliénation d’un sujet en quête d’autonomie. Il
table sur la conscience et la construction de soi : « tes ressources sont en toi… »4,
mais engage aussitôt la responsabilité du sujet – au contraire de l’approche
collective -, et suggère de gérer ‘l’entreprise de soi’, ce qui peut devenir… gérer
les sujets comme l’entreprise, conformément aux moules néolibéraux avec, selon
l’évolution de l’Etat Providence de ces pays, le retrait des aides collectives, et
l’arrivée des exigences du calcul d’intérêt et de la performance. Le premier
système, dans sa conception trop monolithique de la solidarité (son « holisme »),
manque de compréhension de l’individu comme sujet ; le second, sous prétexte de
libérer l’individu et de promouvoir le développement du sujet dans ses capacités
d’autonomie, dénoue la et les solidarité(s) et impose la logique du tout marché…
Ce qui peut se résumer, en simplifiant à outrance : l’économie et la financiarisation
qui l’accompagne puis, désormais, la domine, au lieu d’être au service de la
société, commandent les liens sociaux. A quelles conditions en sortir ? Comment
respecter l’autonomie des sujets, ne pas entrer en ingérence dans leur propre
processus de développement qui s’exprime depuis quelques années sans les
approches par le pouvoir d’agir (voir : l’ « empowerment ») tout en ayant souci du
droit d’assistance « prendre soin » (soigner, exercer de la sollicitude,
accompagner : ce qu’on trouve dans l’expression du « care ») sans pour autant
« assister » ?
LE BLANC propose en ce sens une formule : « Droit d’assistance contre refus du
droit d’ingérence5 » [p. 178]. La recherche d’une alternative crédible doit se
demander si nous pouvons « nous efforcer de comprendre le pouvoir social des
exclus non comme un simple effet de la rage ou de la misère, mais comme la
preuve d’une inventivité des exclus dans leur résistance à l’exclusion ? » [p.178]
4
4
Une certain lecture de l’empowerment, selon ses ambiguïtés d’origine, et sa dépendance avec un certain
fondamentalisme américain, pourrait aller jusqu’à l’imputation de la responsabilité de son malheur à l’exclu lui-
même.
5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%