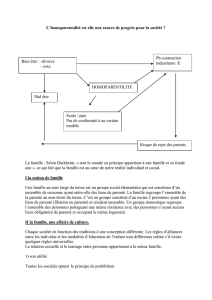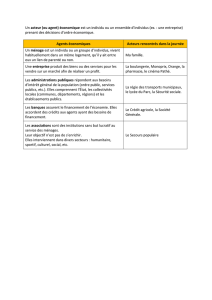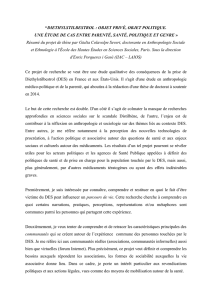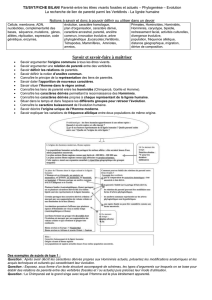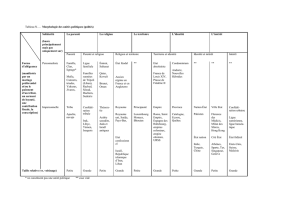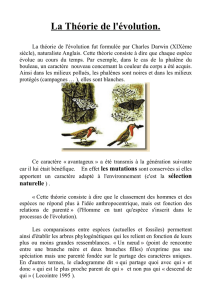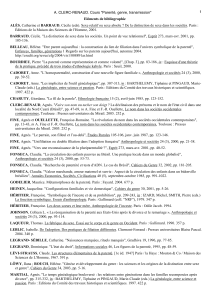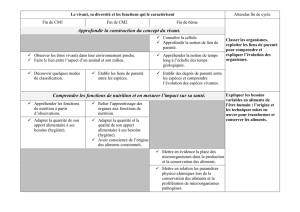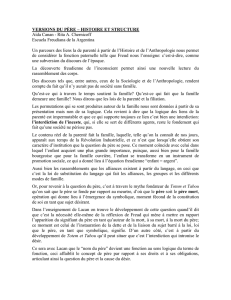Martin_Emilie_2014_memoire - Papyrus : Université de Montréal

Université de Montréal
Anthropologie de la parenté :
La méconnaissance de la perspective évolutionniste et ses conséquences sur la théorisation.
Par
Émilie Martin
Département d’anthropologie
Faculté des arts et des sciences
Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
en vue de l’obtention du grade de
Maître ès sciences (M.Sc.)
en anthropologie
Novembre 2014
© Émilie Martin, 2014

ii
Université de Montréal
Faculté des études supérieures
Ce mémoire intitulé :
Anthropologie de la parenté :
La méconnaissance de la perspective évolutionniste et ses conséquences sur la théorisation.
présenté par
Émilie Martin
a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
Guy Lanoue : président-rapporteur
Bernard Chapais : directeur de recherche
Karine Bates : membre du jury

iii
RÉSUMÉ
Pendant plus de cent ans, les anthropologues ont étudié les phénomènes de parenté tels que le
mariage et la famille dans une grande diversité de sociétés humaines. En dépit de ces efforts, il
y a clairement un manque de consensus concernant les notions de bases impliquées et
plusieurs anthropologues sont insatisfaits de l’état actuel des connaissances théoriques offertes
par leur discipline. Nous nous sommes donc demandé si la perspective culturaliste, qui ne tient
pas compte des fondements biologiques du comportement humain et qui a dominé les études
de parenté depuis leurs débuts, serait responsable de cet état de fait. Pour tester cette
hypothèse, nous avons comparé deux corpus de connaissances portant sur les notions de base
de la parenté humaine. Le premier s’appuie sur le contenu de sept manuels d’anthropologie
ainsi que sur l’œuvre marquante de David M. Schneider « A Critique of the Study of Kinship »
(1984). Le deuxième s’appuie sur des connaissances acquises dans une perspective
évolutionniste portant sur les mêmes phénomènes. Les résultats de cette analyse comparative
indiquent que les anthropologues méconnaissent l’influence de la biologie sur la parenté et que
l’intégration des connaissances existantes à ce sujet dans les théories anthropologiques
permettrait de résoudre les principaux problèmes identifiés.
Mots-clés:
Culturalisme, Exogamie, Famille, Inceste, Mariage, Nature humaine, Parenté,
Schneider, David M.

iv
ABSTRACT
For more than 100 years, anthropologists have studied kinship phenomena such as marriage
and family, in a vast array of human societies. In spite of those efforts, there is a clear lack of
consensus on some of the most basic notions involved and many anthropologists are deeply
dissatisfied with the current state of theory in this research area. The question I address here is
whether the culturalist perspective, which ignores the biological foundation of human behavior
and has dominated kinship studies ever since their beginning, may be responsible for this state
of affairs. In order to test this hypothesis I compare two bodies of knowledge on basic aspects
of human kinship. The first is based on the content of seven anthropology textbooks and on
David M. Schneider’s influential monography, A Critique of the Study of Kinship (1984). The
second includes knowledge from evolutionarily oriented disciplines on the same human
kinship phenomena. The results of this comparative analysis indicate that anthropologists
misunderstand the influence of biology on kinship and that the integration of the
corresponding information in anthropological theories offers many solutions to the problems
identified.
Key Words:
Culturalism, Exogamy, Family, Human Nature, Incest, Kinship, Marriage,
Schneider, David M.

v
TABLE DES MATIERES
RÉSUMÉ ................................................................................................................................................ III
ABSTRACT ........................................................................................................................................... IV
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................... V
LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................................... VII
REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ VIII
1. INTRODUCTION ................................................................................................................................ 1
1.1 OBJECTIFS ....................................................................................................................................... 4
2. MÉTHODES ......................................................................................................................................... 6
2.1 MÉTHODE D’ANALYSE DES MANUELS D’ANTHROPOLOGIE ............................................................. 6
2.2 MÉTHODE D’ANALYSE D’UNE ŒUVRE SPÉCIALISÉE EN ANTHROPOLOGIE DE LA PARENTÉ. ......... 11
I : LA PARENTÉ SELON LES PERSPECTIVES CULTURALISTE ET ÉVOLUTIONNISTE
3. LE DÉBAT SUR LA NATURE DES RELATIONS ENTRE PARENTÉ ET BIOLOGIE ............... 13
3.1 LA PERSPECTIVE CULTURALISTE ................................................................................................... 13
3.1.1 Les limites de la perspective culturaliste ............................................................................... 18
3.2 LA PERSPECTIVE ÉVOLUTIONNISTE ............................................................................................... 20
3.2.1 La causalité fonctionnelle ...................................................................................................... 21
3.2.2 La causalité phylogénétique ................................................................................................... 25
3.2.3 Les causalités proximale et ontogénétique............................................................................. 30
II LA PARENTÉ DANS LES MANUELS D'ANTHROPOLOGIE
4. L’ÉVITEMENT DE L’INCESTE ...................................................................................................... 33
4.1 ANALYSE CRITIQUE ....................................................................................................................... 40
5. LE MARIAGE ET L’EXOGAMIE .................................................................................................... 48
5.1 ANALYSE CRITIQUE ....................................................................................................................... 56
6. PARENTÉ ET SOCIÉTÉ ................................................................................................................... 65
6.1 ANALYSE CRITIQUE ....................................................................................................................... 65
7. LE RAPPORT NATURE / CULTURE .............................................................................................. 73
7.1 ANALYSE CRITIQUE ....................................................................................................................... 74
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
1
/
125
100%