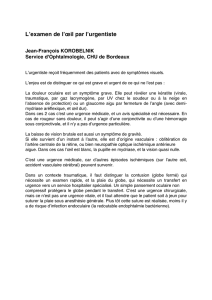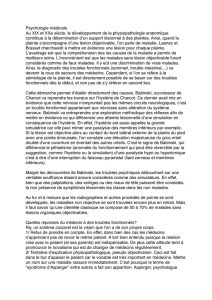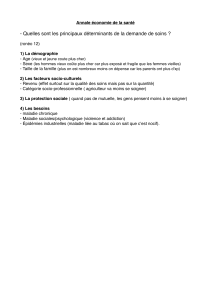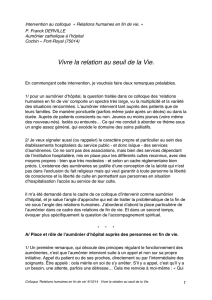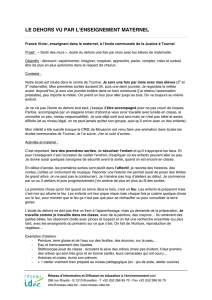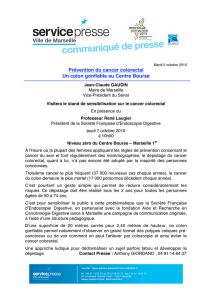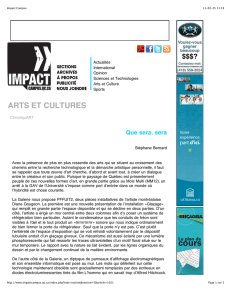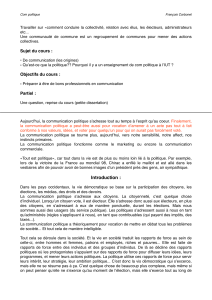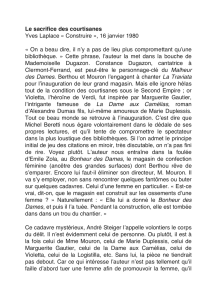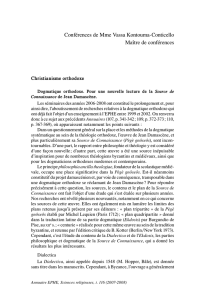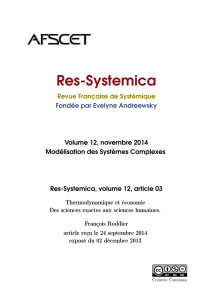Painting Surgeries: Herméneutique du sens, perception et

1"
"
Painting Surgeries: Herméneutique du sens,
perception et survenance des propriétés
esthétiques.
ESSENGUE AMOUGOU Yannick
Chercheur, Enseignant de Philosophie au Collège Libermann, Douala, Cameroun
Introduction
Les arts visuels sʼils renvoient à lʼensemble des productions qui nécessitent la
médiation de lʼœil et de la vue respectivement comme organe et sens pour la perception
visuelle, sont aussi dʼune certaine manière le rapport que lʼhomme entretient avec sa
perception esthétique. A cheval entre arts plastiques, cinématographie, photographie et
anthropologie, les possibilités cybernétiques ont donné des possibles dʼun tout autre genre à
lʼexpression de la sensibilité esthétique de lʼhomme. Cet état de chose se traduit par divers
courants qui offrent aujourdʼhui des visages de plus en plus variés où se mêlent design,
dilettantisme et professionnalisme. Pour parler précisément de « performance artistique », le
regard que donne Marie-Lou Desmeules via les Painting Surgeries ou chirurgies picturales
nous donne lʼoccasion de réfléchir au sens de la perception et de lʼaperception en lien avec
le visuel esthétique. « Du langage jusqu'à la chair! Regards sur l'homme, l'art et la
philosophie à partir de l'oeuvre de Marie-Lou Desmeules ». Une telle problématique suscite
un regard qui touche le rapport entre esthétique, langage, corporéité et perception. Pour ce
faire, la démarche de la philosophie analytique, précisément en ontologie qui se veut une
approche du sens des choses à partir de la description de leurs propriétés, nous semble
toute indiquée pour y conduire notre réflexion. Cʼest la raison pour laquelle en partant de
lʼesthétique traditionnelle, les travaux de Brian O'Shaughensessy, in "Les propriétés
spatiales des objets de perception"1 et de Frédéric Nef2 nous donnerons dʼaborder le rapport
entre arts visuels et philosophie en termes dʼindividualisation des sensations et de
survenance des propriétés esthétiques. Avant dʼy parvenir, parler de chirurgies picturales
nʼest-ce pas finalement poser la question de lʼinterprétation que confère la vision
herméneutique de lʼhomme et de son rapport au monde ? Il apparaît dès-lors quʼun encrage
existentiel devient inévitable entre le corps qui porte lʼœil, lʼanthropologie et lʼart qui donnent
sens et signification à lʼœuvre dʼart, le tout en lien avec les possibilités réceptives de
lʼhomme.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Jean-Maurice Monnoyer (Dir.), La structure du monde. Objets, propriétés, états de choses. Renouveau de la
métaphysique dans l’école australienne de philosophie, Paris, Vrin, 2004.
2 F. Nef, Les propriétés des choses. Expérience et logique, de, Paris Vrin, 2006.

2"
"
Arts visuels et sensibilité esthétique comme expérience ontologique
« Performance artistique et philosophie : Du langage jusquʼà la chair! » : Lʼidée de
langage nous vient tout dʼabord de lʼattitude des personnages de Marie-Lou, qui sont
généralement dépourvus de parole. Les représentations quʼelle propose, manifestent la
situation de lʼhomme privé de toute expression langagière bien quʼayant à dire et à se dire.
De cette quête identitaire, surgit pour notre part une réflexion sur le rapport entre langage et
esthétique. Une telle approche nʼest possible que si nous commençons par situer notre
entreprise sur un plan essentiellement ontologique. Le rapport entre art et philosophie
pourrait dès-lors se faire par lʼétroit canal de la réflexion philosophique sur lʼesthétique.
Comme prolongement – dʼune certaine manière à défaut quelques fois dʼune manière
certaine – de la métaphysique, lʼesthétique équivaut chez Platon à lʼesquisse dʼapproche du
Beau, compris avec le Vrai et le Bien comme idées intelligibles, donc éternelles. Plus
exactement, lʼart pose le problème du rapport que lʼhomme établit ou a à établir avec son
environnement, non pas dans une perspective scientifique pour en rechercher les lois
immuables, encore moins pour tenter dʼen percer les mystères de lʼévolution. Lʼart se veut au
contraire une manière de sentir le rapport de lʼhomme au monde, à travers la représentation
de la nature. Cette dernière peut-elle avoir un sens sans lʼesprit qui donne précisément
valeur à toute représentation ?
Ce qui semble a priori faire la caractéristique essentielle de lʼart, cʼest son
enracinement existentiel. En effet, le support artistique est avant toute chose
fondamentalement un produit de la nature, plus ou moins perfectionnée par le travail de
lʼhomme. Des planches aux instruments de musique en passant par la peinture brute, le
papier sur lequel sont inscrites les partitions, lʼart est avant tout le produit de la nature. Ce qui
lui confère un caractère transcendant, viendrait alors sans doute de la culture, de la
perception et du sens donné ou « trouvé » (lʼinterprétation). Il est vrai que relativisant lʼunion
indéfectible que fait déjà Platon et plus radicalement Hegel entre vrai et beau, Jean Nabert
en réfléchissant sur le sens du laid et de la laideur, en arrive au beau et aux catégories
esthétiques. Dʼaprès lui, quoique « lʼart nous enseigne la beauté de la nature et nous incite à
croire que celle-ci nʼest pas conquise mais donnée, rien ne nous autorise à sortir des
frontières que dessinent les catégories esthétiques et à convertir le prédicat esthétique en un
prédicat ontologique. »3. La question ontologique de lʼart nous situe cependant en face dʼune
aporie, étant entendu que le passage de la catégorie esthétique à la saisie ontologique pose
dʼemblée problème. Cependant, il demeure inéluctable que la question du sens jointe à celle
de la valence conceptuelle en matière de réceptivité, touche le sens esthétique. Cʼest ce qui
précisément donne aux personnages de Marie-Lou ce caractère privatif car dénués de toutes
possibilités de sʼexprimer. La chirurgie qui investit de facto leur conditionnement renvoie par
le fait même à la fluidité de leur expression et de leurs expressions. Dire le sens de ce qui se
donne à voir, cʼest donc parler du symbole de ce qui se donne à dire. Cʼest ce que semble
faire ressortir Marc Lamontagne, lorsquʼil écrit de Marie-Lou que loin de nʼêtre que dilettante,
son « intention est bien plutôt, en projetant lʼimage, dʼêtre considérée comme telle, cʼest-a-
dire comme lʼimage réfléchie de ce qui ne peut pas être vu autrement que grâce a une telle
réflexion spéculative »4. Cʼest donc dire que de la catégorie du silence à celle de
lʼexpression, il sʼagit de « prendre part, participer, sʼy attarder, et surtout, se laisser dire
« quelque chose » de lʼœuvre, entendre la question nous vient de lʼœuvre. »5. De quelle
question sʼagit-il donc ? Nous allons pour rendre compte de ce premier moment de notre
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 Jean NABERT, Essai sur le mal, Paris,"PUF,"1955,"p. 13.
4 Marc LAMONTAGNE, « Que fais-tu Marie-Lou ? »
5 Marc LAMONTAGNE, « Que fais-tu Marie-Lou ? », http://www.ulaval.ca/phares/vol11-automne11/vol11-
automne11.html.

3"
"
analyse, convoquer le sens de la parole dans la pensée existetialiste de Heidegger, pour
arriver à la corporéité telle que perçue par Merleau-Ponty.
« Du langage jusqu'à la chair! » Enracinement ontologique et valence langagière de
lʼart comme corporéité et sensibilité
Le passage du langage à la chair, semble se faire dʼemblée dans lʼimplication des
organes appropriés au langage. Mais dans le cadre des chirurgies picturales, un enjeu
important semble se (re)trouver dans la technique même de Marie-Lou : Sorte de
momification ? Embaumement et fixation par lʼimage photographique, la dimension de
corporéité reste fondamentale dans le projet artistique de Marie-Lou. Tout part du corps et
tout y revient. Mais la signification de cette corporéité va jusquʼà la chair, puisque cʼest dans
les proportions physiques du « mannequin » que se greffe lʼinspiration susceptible de
conduire à la réalisation du produit fini. Le sens de la parole ou du langage dans ce contexte
ontologique, nous vient surtout de Heidegger. Sans ignorer le débat platonicien du Cratyle et
le fameux aphorisme 7 de Wittgenstein (en sens inverse) : « Ce dont on ne peut parler, il faut
le taire ». Tout au contraire, nous voulons réaffirmer la place centrale de la parole dans la
compréhension de lʼêtre et la condition des personnages de Marie-Lou privés de parole.
Selon Heidegger, la capacité pour lʼhomme de parler est le point de départ de lʼanalytique du
Dasein développée au deuxième chapitre de son ouvrage majeur. « Le Dasein, cʼest-à-dire
lʼêtre de lʼhomme, est déterminé dans sa "définition" vulgaire autant que philosophique […]
comme le vivant dont lʼêtre est essentiellement déterminé par la possibilité de parler »6. Si
donc le langage est lʼhabité de lʼêtre, ce que nous apporte ainsi Heidegger, cʼest lʼencrage
ontologique de la recherche du langage. Plus loin, il va ajouter que
les tentatives pour saisir lʼ"essence du langage" se sont toujours orientées sur lʼun de ces
moments isolé des autres et ont conçu la langue à la lumière de lʼidée dʼ" expression", de
"forme symbolique", de communication en tant quʼ "énoncé", de "notification" des sentiments
vécus ou de "mise en forme" de la vie. Mais pour parvenir à une définition de la langue qui soit
tout à fait satisfaisante, il nʼavancerait encore à rien de vouloir agglomérer syncrétiquement ces
différentes déterminations partielles. Ce qui reste décisif, cʼest de travailler préalablement à
dégager la structure intégralement ontologique existentiale de la parole en se fondant sur
lʼanalytique du Dasein7.
Avec lʼapproche phénoménologique de la perception que propose Merleau-Ponty,
nous arrivons à une approche de la sensibilité comme « étude des essences », cʼest-à-dire
une étude qui vise essentiellement la transcendance. Celle-ci, liée à la nature humaine et la
dimension de corporéité de lʼart vient du fait que les cinq sens sont dans un second lieu
après la matière, les réceptacles qui rendent possible la réception artistique. Chez Merleau-
Ponty le corps est comme ce sans quoi le monde nʼexisterait pas pour moi. Mon corps me
permet de reconnaître mes frontières, « mon corps tout entier nʼest pas pour moi un
assemblage dʼorganes juxtaposés dans lʼespace »8. Le corps, occupe une place de choix
dans lʼentreprise phénoménologique de Merleau-Ponty. Quelle est sa spécificité ? Comment
arrive-il à se comprendre comme objet et quel est le lien quʼil garde avec la conscience, qui
est au cœur de la phénoménologie originaire avec Husserl ? Le souci de notre auteur, est
dʼenlever les résidus dʼune dichotomie trop mécanique à la façon de Descartes, qui opère
une distinction nette et radicale entre le sujet et lʼobjet, pour monter en définitive que la
parole parlée, différente de la parole parlante, est finalement un médium dans lʼunion entre le
sujet et lʼobjet ? Dʼoù lʼidée de « corps propre ». Avec Merleau-Ponty, la parole est vécue
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6 M. HEIDEGGER, Etre et Temps, Paris Gallimard, 1986, p. 40.
7 M. HEIDEGGER, Etre et Temps, p.p. 209-210.
8 MERLEAU-PONTY M., Phénoménologie de la perception édition Gallimard, Paris, p. 114.

4"
"
comme medium de lʼexpression du corps. La fonction langagière, est comprise dʼemblée
chez lʼhomme comme une existence concrète de certaines « images verbales ». Pour notre
auteur, il sʼagit de saisir des traces quʼont laissé en nous les mots que nous avons nous-
mêmes prononcé, ou ceux que nous avons entendu. Le point de départ de Merleau-Ponty,
est de réaffirmer que le corps a bel et bien une expression, et celle-ci sʼaccomplit dans la
parole comme langage articulé. Comprendre de fait ce corps, cʼest le vivre, et la conviction
profonde de Merleau-Ponty, est quʼil convient de garder des distances par rapport à
lʼapproche cartésienne qui a voulu opérer une distinction radicale entre lʼobjet et le sujet, et
de là dirions-nous, entre lʼâme et le corps.
Au sens général, la parole est pour Merleau-Ponty, « un être de raison », puisquʼelle
est profondément enracinée dans la vie mentale ; cʼest ce qui fait quʼelle soit assez souvent
sujette à des pathologies qui troublent non seulement lʼélocution, mais aussi la capacité
dʼécrire, comme cʼest le cas avec lʼaphasie. Ici, le mot doit pouvoir être plus quʼun simple
revêtement de la pensée, il doit avec la parole aller au-delà de la simple désignation de
lʼobjet ou de la pensée, « pour devenir la présence de cette pensée dans le monde sensible,
et, non pas son vêtement, mais son emblème ou son corps »9. Le langage est ainsi compris
comme une activité intentionnelle qui part du corps propre pour retrouver sa pureté originelle
dans le monde. Ce qui atteste lʼinhérence de la parole au corps, cʼest le constat qui est fait
en cas dʼanomalies de fonctionnement du langage. Elles ne peuvent en effet être comprises,
sans quʼelles ne touchent non seulement le corps du mot, mais aussi le dispositif matériel qui
permet lʼexpression. Il apparaît donc quʼun homme dont les fonctions corporelles
anatomiques ou neurologiques fonctionnent mal, aura nécessairement des
disfonctionnements locutoires. La phénoménologie du langage dont parle Merleau-Ponty, est
en fin de compte un aboutissement ou une extension de la capacité expressive du corps. Le
langage est finalement compris avec le temps, comme deux dimensions qui enveloppent
lʼobjet et tentent de le saisir de façon globale. La parole quant à elle, est comprise comme ce
qui opère la synthèse et lʼunion retrouvée entre lʼobjet et le sujet, telle semble être la tentative
de réponse donnée par Heidegger.
Le sens que donne Heidegger à la parole est essentiellement ontologique, car cʼest
par la parole que se manifeste lʼêtre. Cette parole, affirme Heidegger, nʼest pas en premier
lieu lʼexpression dʼune opinion, mais dʼemblée lʼarticulation protectrice de la vérité de lʼétant
en totalité, cʼest-à-dire de lʼêtre, puisquʼil est convaincu que le sens de la parole déborde
largement le cadre dʼun acte expressif. La parole est au contraire une articulation qui protège
la vérité même de lʼêtre. Cʼest la raison pour laquelle, Heidegger dit dʼelle quʼelle est : « la
maison de lʼêtre »10. Il en sera de même du langage ; en se sens quʼil porte, de par son
essence, cette caractéristique particulière liée à lʼêtre. Et à la suite de la parole, notre
philosophe va définir le langage en ces termes : « le langage est la maison de lʼêtre. Dans
son abri, habite lʼhomme »11. De ce qui précède, nous voyons que langage et/ou parole sont
deux lieux où demeure lʼêtre ; lieux où il se cache et est appelé à sʼarticuler dans sa vérité
essentielle. Quel est donc finalement le sens de « habiter » ? Notre auteur nous renseigne
sur la question, en montrant que « si nous parvenons à penser le verbe « habiter » avec
suffisamment dʼampleur et de sens il nous nomme la façon dont les hommes accomplissent
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 Idem, p. 212.
10 M. HEIDEGGER, Acheminement vers la parole, Paris, Gallimard, 1976, p. 255.
11 M. HEIDEGGER, Lettre sur l’humanisme, in Questions III, Le chemin de campagne. L’expérience de la
pensée. Hebel. Lettre sur l’humanisme. Sérénité, Paris, Gallimard, 1966. p. 74

5"
"
sur terre et sous la voûte du ciel leur migration de la naissance vers la mort »12 . Il ne sʼagit
donc pas avant tout dʼhabitation comme lieu fixé, mais dʼune sorte dʼacte dʼaccomplissement,
cʼest-à-dire tenter de déployer une chose dans la plénitude de son essence. Porté vers le
Dasein, disons que « habiter » peut se comprendre pour lʼhomme comme accomplissement
de son intégration et en même temps que son déploiement dans le monde. Le sens du
langage est ainsi chez Heidegger ouverture vers lʼhomme : « les tentatives pour saisir
lʼ"essence du langage" se sont toujours orientées sur lʼun de ces moments isolé des autres
et ont conçu la langue à la lumière de lʼidée dʼ" expression", de "forme symbolique", de
communication en tant quʼ"énoncé", de "notification" des sentiments vécus ou de "mise en
forme" de la vie. Mais pour parvenir à une définition de la langue qui soit tout à fait
satisfaisante, il nʼavancerait encore à rien de vouloir agglomérer syncrétiquement ces
différentes déterminations partielles. Ce qui reste décisif, cʼest de travailler préalablement à
dégager la structure intégralement ontologique existentiale de la parole en se fondant sur
lʼanalytique du Dasein13 ».
Si pour Heidegger les poètes et les penseurs sont ceux qui veillent sur cet abri de
lʼêtre quʼest le langage, alors lʼherméneutique peut devenir en tant que science de
lʼinterprétation, une détermination particulière du Dasein. En partant ainsi du langage, la
parole et la corporéité conduisent chez Gadamer à ce « regard sur lʼhomme » comme
herméneutique du sens même de la condition humaine. Comment comprendre un tel
rapport ?
« Regards sur l'homme » : Chirurgie picturale comme fusion des horizons pour une
« esthétique de la réception ».
Ce que nous voulons lire comme regard sur lʼhomme et qui de fait pose la question
du rapport entre art et philosophie, tient pour notre part à une ouverture herméneutique de
lʼœuvre dʼart. Il semble de toute évidence que toute œuvre dʼart nécessite une certaine
interprétation et les chirurgies picturales davantage. Il sʼagit avant tout ici dʼun projet
anthropologique, essentiellement fondé sur lʼhomme : cʼest lʼhomme « réel » qui sert de
modèle à Marie-Lou. Lʼidentification entre lʼauteur et son œuvre si elle touche le langage et la
chair, se fonde radicalement sur la condition de lʼhomme dont le sens est à élucider. Prenons
le cas de « Rama IX The King of Thailand » : Ce qui est dʼabord frappant dès son abord,
cʼest lʼexpression de son visage dont les points saillants sont dans le visuel et le locutoire. En
effet, Rama IX peut dʼemblée nous irriter par la volupté de sa coiffure, par son regard hagard
et perdu au loin, mais lʼexpression de sa bouche qui varie entre sourire lointain et proche
mesquinerie peut avoir quelque chose de ce que Mat Maria Bieczynski a désigné par
« memento mori » ou expérience de vanité grotesque qui nous rappelle notre condition
mortelle dʼêtre marqué du sceau de la finitude. Il faut cependant considérer les décorations
du personnage pour voir quʼil ne sʼagit pas dʼun singulier individu. Quel sens Marie-Lou a-t-
elle bien voulu donner à la photographie de Rama IX représentant ce dernier recouvert dʼune
couche de plastique ? Souci de conservation ? Besoin de réaffirmer son autorité ou de
sauvegarder une certaine probité de son exercice ? « Memento mori » ? Il convient tout de
même de remarquer la forme de ses cheveux et les dauphins en arrière plan, pour
comprendre que le personnage est en route vers les bas fonds, ce qui explique dès-lors la
vacuité de son regard. Cette œuvre artistique a sans doute un sens et une signification quant
au sens de lʼhomme, au sens du pouvoir politique, mais surtout une expression à
communiquer de la déréliction de lʼhomme privé de parole dans le silence de sa descente
vers les profondeurs abyssales du non sens, vers la déchéance devant laquelle tout pouvoir
est face à lui-même dans une dépossession totale de la parole sur soi, de lʼimpossible
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
12 M. HEIDEGGER, Op. Cit., p. 53.
13 M. HEIDEGGER, Etre et Temps, Op. Cit., p.p. 209-210.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%