Un modèle de codage prédictif par populations de neurones

COGMASTER 2009-2010
Un modèle de codage prédictif par populations
de neurones appliqué à la réponse à la
nouveauté du cortex auditif primaire
Mémoire de Master 2
Catherine Wacongne – Sous la direction de Stanislas Dehaene
04/06/2010
Unité de Neuroimagerie Cognitive – CEA/INSERM

2
Sommaire
Sommaire ................................................................................................................................................ 2
1. Introduction .................................................................................................................................... 3
1.1. Données expérimentales sur la MMN ..................................................................................... 5
1.2. Cadre théorique....................................................................................................................... 7
2. Matériel et Méthodes ..................................................................................................................... 9
2.1. Choix du type de modèle ......................................................................................................... 9
2.2. Organisation du réseau ......................................................................................................... 11
2.3. Règles de plasticité ................................................................................................................ 14
2.4. Implémentation du réseau .................................................................................................... 16
2.5. Séquences test des simulations. ........................................................................................... 17
3. Résultats ........................................................................................................................................ 17
3.1. Paradigme local/global .......................................................................................................... 17
3.1.1. Contexte AAAAA ............................................................................................................ 17
3.1.2. Contexte AAAAB ............................................................................................................ 24
3.2. Séquences alternées .............................................................................................................. 25
3.2.1. Contexte ABABA ............................................................................................................ 26
3.3. Paradigme Oddball ................................................................................................................ 29
4. Discussion et perspectives ............................................................................................................ 30
Bilan ................................................................................................................................................... 30
Confrontation avec les données expérimentales .............................................................................. 30
Prédictions et test du modèle ........................................................................................................... 32
Limites et extensions possibles du modèle ....................................................................................... 34
ANNEXES ............................................................................................................................................... 36

3
1. Introduction
Reconnaitre un organisme conscient est un challenge non résolu. Lorsque nous tentons d’évaluer
l’état de conscience des êtres humains qui nous entourent, nous nous basons essentiellement sur le
rapport subjectif qu’ils sont capable de faire. Si une personne est capable de communiquer le fait
qu’elle se sent subjectivement consciente, dans un contexte où il est improbable que cette réponse
soit due au hasard, nous admettons que cette personne est consciente. Lorsque des patients perdent
la capacité de communiquer avec l’extérieur, poser la question de l’état de conscience devient
complexe. Malgré tout, ce diagnostique est crucial pour adapter la prise en charge clinique des
patients en état apparemment végétatif. Récemment, ce problème a reçu une attention particulière
de la part des cliniciens, qui commencent à exploiter l’imagerie fonctionnelle, en particulier l’IRM
fonctionnelle, comme interface de communication avec des patients potentiellement conscients
mais prisonniers de leur corps [1]. Si ces méthodes ont permis d’obtenir des résultats spectaculaires
sur quelques cas, elles souffrent de divers inconvénients. D’une part les protocoles IRM sont couteux
et complexes à mettre en place de façon systématique, d’autre part, les méthodes utilisées
demandent que le patient maintienne une imagerie mentale sur de longues périodes, ce qui requiert
une attention soutenue. Il est possible que des patients dont les états de conscience sont fluctuants,
appelés patients minimalement conscients, passent au travers de telles méthodes. Il serait donc
souhaitable de développer des techniques plus théoriquement fondées et utilisant des méthodes
moins couteuses et plus simple d’implémentation. Une telle approche permet un enrichissement
mutuel de la clinique par la recherche et vice versa.
Dans cette perspective Bekinstein et al.[2] ont développé un protocole auditif passif utilisant des
enregistrements MEG/EEG aisément applicable à des patients. Des données de la littérature
montrent qu’il existe deux types de réponses évoquées par un son inattendu [3] : une réponse
précoce à la déviance dans un flux régulier (connu dans la littérature sous le nom de MMN) et le
complexe P300. La MMN a plutôt été associée à une réponse pré attentionnelle automatique et
inconsciente [4] alors que la composante tardive de la P300 (P3b) est considérée comme un indice du
rafraichissement de la mémoire de travail et associée à l’accès conscient. Partant de ces données, le
protocole mis en place teste l’hypothèse que différents types de déviance affecteront différemment
les deux réponses évoquées.
Le protocole (Figure 1), auquel on fera référence par la suite sous le nom de « local/global », consiste
en l’écoute passive de stimuli sonores, il ne nécessite donc pas de concentration particulière. Les
sujets entendent des groupes de 5 sons, pouvant appartenir à 2 catégories : soit les 5 sons sont
identiques (XXXXX), soit seuls les 4 premiers sont identiques et le dernier diffère (XXXXY). Dans ce cas
le dernier son représente une violation de la règle locale de répétition établie par les premiers sons.
Le sujet entend ces groupes de sons au sein d’un bloc de quelques minutes au cours duquel une des
catégories est majoritairement représentée : 25 groupes de la catégorie dominante fixent la « règle »
en début de bloc. Une centaine de groupes de 5 sons sont présentés ensuite, dont 20% de groupes
appartenant à l’autre catégorie. Ces groupes constituent une déviance à la règle globale. Un déviant
à la règle locale peut ainsi se trouver être la séquence globalement régulière. La déviance est dans ce
cas parfaitement prédictible.

4
Figure 1: design expérimental du protocole développé par Bekinstein et al.
L’analyse des résultats montre que les deux types de déviance évoquent deux types de réponses
différentes. La déviance à la règle locale évoque une composante précoce, 150 ms environ après le
début du dernier son. Cette composante est bien connue dans la littérature sous le nom de
Mismatch negativity (MMN). La déviance à la règle globale évoque une réponse plus tardive sous
forme d’une P300. De façon intéressante, alors que la mismatch negativity est peu affectée par les
états de conscience des sujets ou leur état d’attention, la P3 est très diminuée chez les sujets ne
portant pas attention au stimulus, et disparait complètement chez les patients végétatifs.
Ce paradigme fournit donc une dissociation entre 2 niveaux de traitement : un niveau
« automatique » peu dépendant des ressources attentionnelles, apparemment local dans le temps ;
et un niveau conscient capable de coder pour des régularités de plus haut niveau.
Afin de mieux comprendre la spécificité du niveau conscient, on souhaite développer un modèle
neuronal biologiquement plausible permettant de rendre compte de ces effets. Dans un premier
temps on s’intéressera au niveau « automatique » afin de mieux comprendre ses capacités et la
nature de l’information codée.
De façon surprenante, malgré une littérature plus qu’abondante, il n’existe pas de consensus
théorique sur la façon dont la MMN est générée ou même sur sa signification computationnelle
[5][6].
Après une revue des principales données expérimentales de la littérature contraignant le modèle,
ainsi que des principales pistes théoriques pertinentes, nous proposerons un modèle possible de la
mismatch negativity à l’échelle locale et en discuterons les performances.

5
1.1. Données expérimentales sur la MMN
Le terme mismatch negativity a été introduit en 1978 par Näätänen et al.[7] pour décrire une
composante des potentiels évoqués (ERP) décrite auparavant par Squires [8] produite par un
changement dans le flux de stimuli. Cette composante n’est apparemment pas spécifique de la
modalité auditive car des analogues on pu être décrites dans la modalité somato-sensorielle [9],
olfactive [10] et visuelle [11]. L’immense majorité de la littérature sur la MMN reste cependant
concentrée sur la modalité auditive.
Effet1 : MMN à la déviance dans un flux de sons purs répétés à intervalles réguliers
Dans le paradigme dit « oddball » un stimulus auditif est répété à intervalle régulier (le standard). De
façon rare, un son de fréquence, d’amplitude, de durée différente est présenté : c’est un déviant. La
MMN est la composante négative obtenue de façon reproductive en soustrayant les ERP produits
par un stimulus donnée entre la condition ou il est en position de déviant et celle où il est en position
de standard. De façon générale, on trouve une mismatch negativity significative entre 100 et 200 ms
après le début du stimulus déviant.
Effet2 : Sensibilité de l’amplitude de la MMN à la fréquence du déviant
L’amplitude de la mismatch negativity varie en fonction de la magnitude de la différence physique
entre le standard et le déviant : si le déviant est un son pur d’une fréquence différente mais proche
du standard, l’amplitude de la mismatch est proportionnelle à l’écart entre les fréquences des deux
sons. Pour des fréquences suffisamment différentes, l’amplitude de la mismatch est constante.
L’amplitude de la mismatch varie également avec la probabilité d’occurrence du son déviant. Dans un
paradigme oddball, une étude [12] a pu montrer que l’amplitude de la mismatch augmente quand la
différence entre les probabilités d’occurrence du standard et du déviant augmente (Figure 2).
Figure 2 : Mismatch negativity (déviant-standard) en fonction de la fréquence du déviant dans un paradigme oddball.
Repris de Sato et al.
Effet3 : MMN à la répétition dans un signal alterné
La mismatch negativity est cependant sensible à des relations plus complexes que la simple
fréquence relative des stimuli. Dans un signal alterné (ABABA… ) la répétition d’un élément
(ABABABBABABA..) évoque une MMN [13].
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%

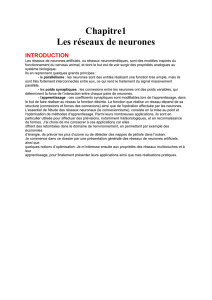
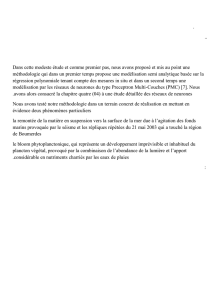


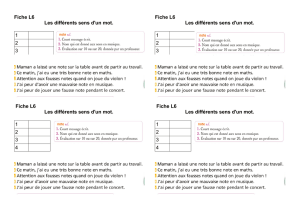

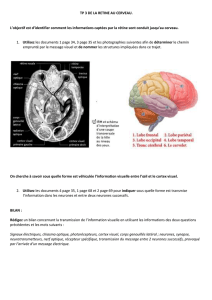
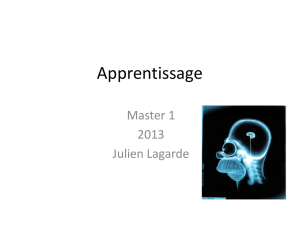
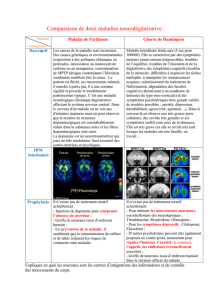
![Découverte d un nouveau centre cérébr[...]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001261824_1-044b689d1e2faad91148811640c2eb34-300x300.png)
