Licence de mathématiques ALG`EBRE

UNIVERSIT´
E DE RENNES 1
INSTITUT MATH´
EMATIQUE DE RENNES
Licence de math´ematiques
ALG`
EBRE
Cours r´edig´e par Laurent Moret-Bailly
Septembre 1997


Chapitre I
Groupes
1. D´efinitions, premi`eres propri´et´es, exemples
D´efinition 1.1 Un groupe est un couple (G, ∗)o`u G est un ensemble et ∗une loi
de composition interne sur G, v´erifiant les propri´et´es suivantes :
(i) ∗est associative : pour tous g, g0, g00 ∈Gon a (g∗g0)∗g00 =g∗(g0∗g00).
(ii) ∗admet un ´el´ement neutre : il existe e∈Gtel que pour tout g∈Gon ait
g∗e=e∗g=g.
(iii) tout ´el´ement gde Gadmet un sym´etrique pour la loi ∗, c’est-`a-dire qu’il existe
g0∈Gtel que g∗g0=g0∗g=e(l’´el´ement neutre).
Le groupe Gest dit commutatif, ou encore ab´elien, si de plus la loi ∗est commutative,
i.e. g∗g0=g0∗gpour tous g, g0∈G.
1.2. Commentaires.
1.2.1. ˆ
Etes-vous sˆur de savoir ce que l’on entend par ”couple”, ”ensemble”, ”loi de
composition” ? Voil`a une bonne occasion de vous rafraˆıchir la m´emoire. . .
1.2.2. Gest appel´e l’ensemble sous-jacent au groupe. En pratique, on confond sou-
vent (en particulier dans les notations) le groupe avec son ensemble sous-jacent,
de sorte qu’on parle, par exemple, des “´el´ements d’un groupe G” plutˆot que des
´el´ements de l’ensemble Gsous-jacent au groupe (G, ∗). Il s’agit d’un abus de lan-
gage sans gravit´e s’il n’y a pas d’ambigu¨ıt´e sur la loi de composition. (Cet abus a
d’ailleurs ´et´e commis dans la d´efinition : `a quel endroit ?)
Par exemple, on dit qu’un groupe est fini si son ensemble sous-jacent est fini ; le
nombre d’´el´ements (ou cardinal) de cet ensemble est alors appel´e l’ordre du groupe.
Noter au passage que cet ordre n’est pas nul car un groupe n’est jamais vide : il a
au moins un ´el´ement, `a savoir l’´el´ement neutre.
1

GROUPES
1.2.3. L’´el´ement neutre de Gest unique : en effet si eet e0sont deux ´el´ements neu-
tres, on a e∗e0=epuisque e0est neutre, et e∗e0=e0puisque eest neutre, d’o`u
e=e0. Ceci justifie la formulation adopt´ee dans (iii) : en toute rigueur, il aurait fallu
´ecrire par exemple “. . .tel que g∗g0et g0∗gsoient neutres”.
1.2.4. De mˆeme le sym´etrique g0de g∈Gest unique : si g00 est un autre sym´etrique
de g, on a g0=g0∗e=g0∗(g∗g00)=(g0∗g)∗g00 =e∗g00 =g00.`
A cause de cette
propri´et´e d’unicit´e (qui utilise l’associativit´e, contrairement `a la pr´ec´edente), il est
l´egitime de parler du sym´etrique de get de le d´esigner par une notation telle que
g−1(voir ci-dessous). Quel est le sym´etrique de l’´el´ement neutre ? celui de g−1?
celui de g∗g0? (Remarque sur ces questions et toutes les autres : il ne suffit pas de
deviner la r´eponse, il faut la justifier).
1.2.5. La notation la plus courante pour une loi de groupe est la juxtaposition (ou
notation multiplicative) : le compos´e de deux ´el´ements get g0est simplement not´e
gg0. Dans ce cas, on convient g´en´eralement de noter g−1le sym´etrique de g, et de
l’appeler son “inverse”. ´
Eviter la notation 1/g.
Sauf mention expresse, ou ´evidence, du contraire, tous les groupes consid´er´es ici
seront not´es multiplicativement, et l’´el´ement neutre d’un groupe Gsera not´e eG, ou
simplement esi aucune confusion n’en r´esulte.
1.2.6. Une autre notation souvent utilis´ee, mais uniquement pour les groupes com-
mutatifs, est la notation additive : la loi de groupe est not´ee +, le sym´etrique de g
est appel´e son oppos´e et not´e −g, et l’´el´ement neutre est not´e 0.
1.3. R`egles de calcul dans les groupes. Soit Gun groupe, not´e multiplicativement ;
on notera el’´el´ement neutre de G.
1.3.1. Simplification. Si a, b, c ∈Gv´erifient ac =bc alors a=b(la r´eciproque ´etant
triviale). En effet a=ae =a(cc−1)=(ac)c−1= (bc)c−1=b(cc−1) = be =b. Bien
entendu on se contente de r´esumer ces calculs d’une phrase telle que “multiplions `a
droite par c−1les deux membres de l’´egalit´e ac =bc”. De mˆeme, ca =cb implique
a=b, “en multipliant `a gauche par c−1”. Par contre, une relation telle que ab =ca
n’implique pas en g´en´eral que b=c, sauf si l’on sait que aet bcommutent, c’est-`a-
dire que ab =ba.
1.3.2. ´
Etant donn´es aet b∈G, l’´equation ax =ba une unique solution xdans
G, `a savoir x=a−1b, que l’on trouve en multipliant `a gauche par a−1. De mˆeme,
l’´equation xa =ba pour unique solution x=ba−1.
1.3.3. On peut reformuler 1.3.2 en disant que, pour tout a∈G, l’application x7→ ax
de Gdans G(“translation `a gauche par a”) est bijective, ainsi que la translation `a
droite d´efinie par x7→ xa.
2

I.1 D´
EFINITIONS, PREMI `
ERES PROPRI ´
ET ´
ES, EXEMPLES
1.3.4. Op´erations “inverses” de la loi de groupe. Il est important de noter que les
deux ´equations ax =bet xa =bconsid´er´ees en 1.3.2 sont (`a moins que Gne soit
commutatif) deux ´equations diff´erentes, avec des solutions en g´en´eral diff´erentes.
C’est pourquoi, mˆeme dans un groupe not´e multiplicativement, on ne parle pas
de “division” : il y a en effet deux “quotients” de bpar a, qui sont a−1bet ba−1.
Bien entendu, ils co¨ıncident si Gest commutatif. En particulier, dans un groupe
not´e additivement (1.2.6), l’usage permet de d´efinir une soustraction par la formule
a−b=a+ (−b) = (−b) + a.
1.3.5. Produits finis dans un groupe. Si n∈Net si a1, . . . , ansont n´el´ements de G,
on d´efinit par r´ecurrence sur nleur produit a1···ancomme ´etant l’´el´ement neutre
esi n= 0 (suite vide), et (a1···an−1)anpour n > 0. Ainsi abcd est d´efini comme
´etant ((ab)c)d. On d´eduit alors de l’associativit´e la formule
(a1···am)(b1···bn) = a1···amb1···bn(1.3.5.1)
(exercice : r´ecurrence sur n). Cette formule entraˆıne la r`egle de calcul suivante : le
produit a1···anpeut se calculer par regroupement arbitraire de termes cons´ecutifs,
par exemple abcde = (a(bc))(de)=(ab)((cd)e). (Exercice : v´erifier ces ´egalit´es
d’abord directement `a l’aide des d´efinitions et de l’associativit´e, puis en utilisant
(1.3.5.1)). En particulier, on peut supprimer tout terme ´egal `a l’´el´ement neutre, et
toute suite du type aa−1. Par contre, un changement dans l’ordre des termes change
la valeur du produit, sauf si Gest commutatif ou plus g´en´eralement si les termes
commutent entre eux.
Un cas particulier important de la r`egle de regroupement est la formule
(ab)(b−1a−1) = e
qui donne la r´eponse `a une question pos´ee plus haut (1.2.4) en montrant que l’inverse
de ab est b−1a−1(et non a−1b−1: aviez-vous trouv´e ?).
1.3.6. Puissances. Pour n∈Net a∈G, on d´efinit ancomme le produit a1···ano`u
chacun des aiest pris ´egal `a a. On a donc notamment a0=eet a1=a. Pour nentier
n´egatif , on pose an= (a−1)−n(ce qui est compatible avec les notations ant´erieures
pour n=−1). On v´erifie alors que am+n=amanpour met nquelconques dans
Z(par exemple en discutant suivant les signes, le cas o`u met n∈Nr´esultant de
(1.3.5.1)). On a en particulier a−n= (an)−1, et aman=anam(les puissances d’un
mˆeme ´el´ement commutent entre elles). On a aussi amn = (am)n. En revanche on n’a
pas en g´en´eral (ab)n=anbn, sauf si aet bcommutent. (Exercice : pour n=−1 et
pour n= 2, la formule (ab)n=anbnest vraie si et seulement si aet bcommutent).
Lorsque Gest commutatif et not´e additivement, on ne parle plus de puissances
mais de multiples et on note ´evidemment na et non an.
1.4. Exemples de groupes.
3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
1
/
182
100%






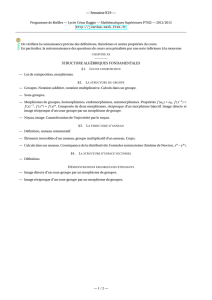
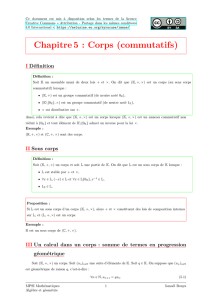

![14 C[X, Y ]/(X 2 + Y 2 − 1) principal - Agreg](http://s1.studylibfr.com/store/data/003770161_1-f3ec298fcc6df231437153404bd18909-300x300.png)