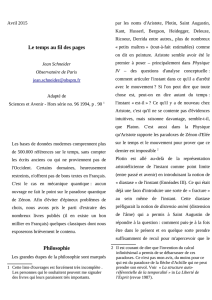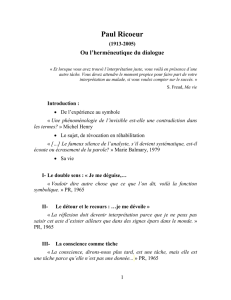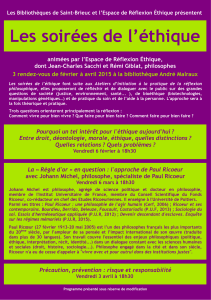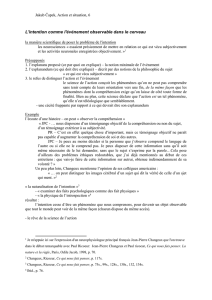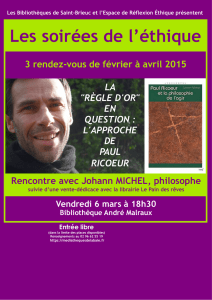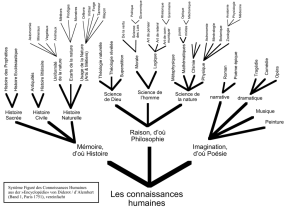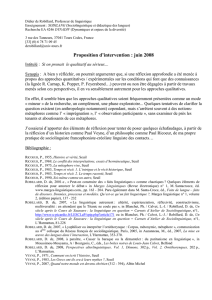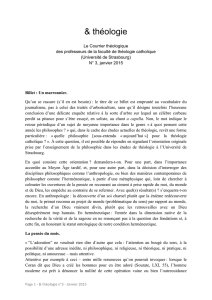Introduction à Ricoeur 1

Julien Lambinet, Université de Fribourg
Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015
1
Séminaire Paul Ricoeur : témoigner de la Révélation
M. Negel m’a demandé de préparer un séminaire de théologie fondamentale sur la
compréhension du témoignage de la révélation développée par P. Ricoeur. La chose n’est pas
évidente. Il faut en effet d’emblée prendre quelques précautions. P. Ricoeur n’a notamment
jamais prétendu être un théologien. Il était professeur de philosophie et n’a pas prononcé son
discours intellectuel sous un autre statut. La remarque est évidemment importante d’un point
de vue méthodologique. P. Ricoeur, bien qu’il n’ait jamais caché sa confession chrétienne
(protestante), n’a dans ses livres jamais voulu emprunter d’autre chemin que ceux de la
raison, entendue de surcroît en un sens moderne, c’est-à-dire la voie de la subjectivité
connaissante et réflexive, comme point de départ méthodologique. Il est un disciple de la
phénoménologie husserlienne, dont nous dirons un mot par la suite, elle-même héritière en
quelque façon des tournants cartésien et kantien de la pensée et de leur retour sur la
subjectivité. Et assez globalement, on peut dire que pour Ricoeur, l’homme produit du sens
par un retour sur soi. Une affirmation qu’il nous faudra relativiser et préciser, c’est tout le
sens de la problématique du « témoignage ».
D’autre part cependant, la philosophie de P. Ricoeur, sa démarche de pensée et ses
résultats, ont fortement inspiré de nombreux théologiens, non seulement en théologie
fondamentale, mais jusqu’à inspirer les fondements d’une démarche exégétique de l’Ecriture
sainte, qu’on a appelé exégèse narrative. Le professeur André Wénin, à Louvain-la-Neuve,
débutait chacun de ses cours d’exégèse de l’Ancien Testament par un rappel méthodologique
de l’exégèse narrative qui intégrait l’apport de P. Ricoeur. Signalons également, plus près
d’ici, le travail que François-Xavier Amherdt consacra à l’importance de Ricoeur pour
l’herméneutique de l’Ecriture, et la manière dont le Professeur de Fribourg reconnut la place
prépondérante occupée par Ricoeur au sein du document L’interprétation de la Bible dans
l’Eglise, préparé par la Commission biblique pontificale
1
. Il n’est donc manifestement pas
tout à fait absurde de vouloir parler de ce grand philosophe français lors d’un séminaire de
théologie.
Quel sens cela peut-il avoir cependant, d’en parler au sein d’un séminaire de
« théologie fondamentale » ? Et qu’entend-on par théologie fondamentale ? On peut la
comprendre comme cette partie ou cette discipline de la théologie qui a pour but de réfléchir
sur ses propres fondements et ses propres raisons, née en suite des essoufflements, à la fin du
XIX
ème
et au début du XX
ème
siècle, de ce qu’on appelait traditionnellement l’apologétique.
L’apologétique était le plus souvent vue comme une démarche rationnelle, destinée à
démontrer la crédibilité rationnelle des articles de foi et de la Révélation, de manière en
1
Cfr F.-X. A
MHERDT
, « Présentation », dans P. R
ICOEUR
, L’herméneutique biblique, Cerf, Paris, 2011, pp. 12-
13 ; C
OMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE
, L’interprétation de la Bible dans l’Eglise, Cerf, Paris, 1994, pp. 66-67.

Julien Lambinet, Université de Fribourg
Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015
2
quelque sorte préalable (et les médiévaux parlaient de praeambula fidei) à l’acte de foi lui-
même. C’est là une démarche qui, poussée à l’extrême, entraîne en quelque sorte une
distinction questionnable entre l’apologétique et la démarche théologique en tant que telle,
puisqu’il ne sera pas rare alors de situer l’apologétique du côté de la raison, et la théologie du
côté de la foi. A l’exemple d’Ambroise de Poulpiquet, qui écrit un traité sur L’objet intégral
de l’apologétique en 1912 et déclare : « Les quelques traits extérieurs de ressemblance ne
sauraient altérer une différence aussi spécifique que celle qui existe entre la méthode
d’autorité de la théologie et la méthode strictement rationnelle de l’apologétique »
2
. C’est-à-
dire que selon de Poulpiquet, la première (la théologie) établit son discours en se fondant
entièrement sur des sources autorisées (Bible, Magistère, grands auteurs, les Pères) alors que
la seconde (l’apologétique) n’use que de la stricte raison et de ses enchaînements logiques.
L’apologétique était progressivement, à force de lutte contre l’agnosticisme, le déisme ou le
fidéisme, devenue « extérieure » à son objet
3
. La théologie fondamentale, qui est une
discipline relativement récente donc, cherchera à réintroduire la démarche rationnelle au sein
d’une démarche de foi.
En 1929, Henri de Lubac prononce une leçon inaugurale sur « Apologétique et
théologie » alors qu’il prend possession de sa chaire à Lyon et qualifie l’apologétique
moderne de « défensive », « opportuniste » et « extérieure ». Pour de Lubac, l’apologétique
oublie de s’intéresser au récepteur même de la révélation, à ce qui dans la Révélation de Dieu,
touche l’homme au plus profond de lui-même. Elle tente d’accumuler les arguments objectifs
sur ce qu’elle finit par considérer comme un « objet » lui-même, lui restant donc extérieur,
comme face à face, et obnubile par là tout un pan de l’intelligence de la foi. Elle oublie en
quelque sorte que la théologie est tout autant une « intelligence de la foi » qu’une
« intelligence par la foi ». Il reviendrait alors à la théologie fondamentale de mettre au jour les
fondements propres de la théologie, dans le Verbe lui-même, c’est-à-dire dans une certaine
forme d’intelligence elle-même, et de faire valoir sa rationnalité propre, sa méthode propre.
Pour cela, elle s’est traditionnellement confrontée, dans le sens positif du terme, avec les
autres démarches. Elle a usé des autres disciplines (principalement de la philosophie, mais
aussi des théories du langage, etc.) tant à ses fins propres que pour s’en démarquer et
revendiquer sa propre spécificité. « La grande limite de [l’] apologétique était son caractère
abstrait et formel, son oubli de la situation de celui à qui elle est destinée. Confrontée
longtemps au déisme philosophique, elle était devenue trop défensive, ou trop belliqueuse peu
importe. Elle n’était plus assez soucieuse de dire son Mystère »
4
. La théologie fondamentale
naissante, par réaction, veut revenir à « l’intelligence du Mystère » déjà mise en valeur par les
2
A.
DE
P
OULPIQUET
, L’objet intégral de l’apologétique, Bloud et Cie, Paris, 1912, pp. 531-532.
3
En très gros, voulant lutter contre les démarches qui avaient éloigné Dieu de l’humanité en montrant qu’il ne
pouvait être accessible à la raison (agnosticisme, déisme, fidéisme), l’apologétique avait « occupé le même
terrain ». Elle chercha à démontrer la validité d’une réflexion rationnelle sur Dieu, mais se limita à ce plan,
tendant dès lors à réduire le sacré à l’« objet » d’une démarche argumentative.
4
Cfr J.-P. W
AGNER
, La théologie fondamentale selon Henri de Lubac, Cerf, Paris, p. 31.

Julien Lambinet, Université de Fribourg
Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015
3
Pères, et au delà du formalisme de l’apologétique essentiellement moderne, prendre en
compte l’expérience totale de l’être au monde du croyant, en instaurant dialogue plutôt que
défiance vis-à-vis des diverses facettes de l’être au monde exploitées par les autres disciplines
rationnelles.
Si la théologie fondamentale emprunte ainsi, dan sa réflexion sur les fondements de sa
foi (la révélation, la parole, et.), la voie du dialogue avec les autres disciplines et toutes les
facettes qui font de l’homme un être dans le monde, alors il est clair que la pensée de
P. Ricoeur peut constituer pour elle une interlocutrice privilégiée. P. Ricoeur en effet, en une
première approche, est un philosophe qui a toujours revendiqué l’interdisciplinarité, le recours
à la linguistique notamment, etc. au cœur de sa démarche et qui, plus que la plupart a insisté
sur l’importance de l’inscription de l’interprétation d’un sens et d’un récit au cœur d’une
communauté, ou sur l’importance de la manière dont un sens est reçu par cette communauté.
Enfin, il a cherché a trouver dans l’acte même d’interprétation d’une parole, une
caractéristique fondamentale de l’être de l’homme.
I. Eléments biographiques
Selon Ricoeur, et nous verrons plus en profondeur pourquoi un peu plus tard, cela n’a pas
de sens de réduire, comme le faisait Heidegger, la biographie d’un penseur, à ces quelques
mots lapidaires : « il est né, il a travaillé, il est mort ». La biographie d’un auteur possède des
résonnances dans son travail et constitue un témoignage au sens plein de sa pensée. Nous
dirons donc avant de commencer, dans le respect de cette conviction de P. Ricoeur, quelques
mots de sa vie, même si nous resterons très concis. Il est souvent utile, sinon agréable,
lorsqu’on étudie un auteur, de savoir un minimum de qui l’on parle.
Paul Ricoeur est né à Valence (France) en 1913. Son enfance sera marquée par la perte
tragique de sa mère, peu après sa naissance, et de son père, mort lors de la première guerre, à
la bataille de la Marne en 1915. Il est élevé par ses grands-parents paternels et une tante ; son
éducation est alors matériellement prise en charge par l’état en tant que pupille de la nation. Il
passe une licence de philosophie en 1933, après avoir soutenu un mémoire consacré à la
tradition de la philosophie réflexive française, intitulé : « Méthode réflexive appliquée au
problème de Dieu chez Lachelier et Lagneau ». On le verra, ce problème et cette tradition
resteront prégnants dans la pensée de Ricoeur, jusqu’à intéresser directement la question que
nous travaillerons, puisque nous le verrons, réside à la source de son intérêt pour la question
du témoignage, l’œuvre d’un autre philosophe appartenant aux ultimes ressacs de cette
tradition réfléxive, à savoir Jean Nabert, avec son livre posthume sur le désir de Dieu. Ricoeur
devient, au courant de la même année (1933), professeur de lycée à Saint-Brieuc. Il prépare
l’agrégation à Paris, qu’il reçoit en 1935. Il épouse alors Simone Lejas, avec laquelle il aura
cinq enfants. Il perd encore cette année, son unique sœur, d’une tuberculose. A Paris, il

Julien Lambinet, Université de Fribourg
Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015
4
fréquente régulièrement les « Vendredis » de Gabriel Marcel, qui joue pour lui le rôle
d’éveilleur. Il y retiendra notamment la pratique imposée à chacun des participants de ces
rencontres de ne jamais s’autoriser de la parole de l’autre, et d’affirmer courageusement son
propre point de vue. C’est aussi son premier contact avec les écrits de Husserl. La Revue
Esprit, créée en 1932, suscite également son enthousiasme ; celui d’un protestant soucieux de
liberté de parole et d’un éveil qui le conduit à lancer en 1936 une petite revue, Etre, inspirée
par le grand théologien protestant Karl Barth. Il écrit ses tout premiers articles en 1935 dans la
revue détonante qu’est Terre Nouvelle, organe des « chrétiens révolutionnaires par l’union du
Christ et des travailleurs pour la Révolution sociale ». Protestant très engagé, il s’intéresse à
cette époque à la question du christianisme social et lit abondamment Marx.
Il enseigne dans divers lycées avant d’être mobilisé en 1939, et fait prisonnier en 1940. Il
est envoyé en Poméranie orientale (région du nord ouest de la Pologne) dans les camps de
Gross-Born, puis d’Arnswalde, pour toute la durée de la guerre. Dans ce dernier camp, il se
trouve dans une chambrée avec sept compagnons, tous intellectuels. Ils y créent une sorte de
petit cercle de philosophie. Ricoeur se consacre à la philosophie existentialiste de K. Jaspers
(à laquelle il consacrera son premier livre publié juste après la guerre, « Karl Jaspers et la
philosophie de l’existence », écrit en collaboration avec son camarade prisonnier
M. Dufrenne) et traduit les Idées directrices pour une phénoménologie pure de E. Husserl (en
cachette, puisque Husserl avait été mis à l’index par les nazis).
La guerre terminée, il sera nommé, en pleine mode existentialiste, professeur à la
faculté de Strasbourg en 1948. Ce moment de l’immédiat après-guerre est celui du triomphe
de l’existentialisme sartrien. Paul Ricœur effectue lui aussi la traversée de l’existentialisme,
mais d’un existentialisme essentiellement nourri par la pensée de Gabriel Marcel, Jaspers et
Kierkegaard. Il prône, à la différence de Sartre, non une forme d’arrachement à la « glu de
l’être » et une liberté sortie d’un néant, mais l’engagement d’un être comme acte, d’un « être-
avec ». Il entre au sein du cercle des collaborateurs de la revue Esprit et fait la connaissance
de son fondateur, le grand « personnaliste » E. Mounier. Ricoeur publie sa thèse, Le
volontaire et l’involontaire, en 1950. Celle-ci constituera les prémisses d’un chantier
important de sa philosophie qu’on caractérise comme une « philosophie de la volonté ». C’est
un aspect également, nous le verrons, qui interviendra dans les textes que nous lirons.
Dans ces années, Ricœur est surtout, avec Lévinas et Merleau-Ponty, l’un des grands
introducteurs de Husserl en France. Sa thèse sur la volonté se veut complémentaire de l’œuvre
de Maurice Merleau-Ponty, attachée quant à elle essentiellement à la perception, et se donne
comme champ de réflexion une phénoménologie de l’action. Cette dernière défend d’abord
l’idée qu’on ne peut penser le volontaire sans l’involontaire, que tout n’est pas choisi, et que,
contrairement à ce que dit Nietzsche, « vouloir n’est pas créer ». Une part de passivité et de
finitude est indéfectiblement inscrite au coeur de l’action humaine. L’homme est un mixte de
finitude et d’infinitude, qui porte, dès la dialectique de l’agir et du pâtir, une disproportion

Julien Lambinet, Université de Fribourg
Proséminaire de théologie fondamentale, Semestre d’automne 2015
5
entre une face de responsabilité, de capacité, et une face de vulnérabilité, de fragilité. Dans
cette disproportion se loge la faillibilité humaine, la possibilité d’être coupable, de faire le mal
que l’on ne voulait pas. Le mal est alors considéré par Ricoeur comme l’une des ces grandes
apories de la pensée, qui oblige la philosophie à faire le détour des symboles, des mythes, du
tragique, de toutes les sources non philosophiques qui déplacent l’intelligence même de la
question.
En 1957, il est nommé à la Sorbonne, à Paris, qu’il quitte en 1964, notamment lassé
par le caractère impersonnel induit par le nombre des étudiants, pour rejoindre l’équipe
pourtant encore toute nouvelle de l’Université de Nanterre, en pleine création. Il y fonde le
département de philosophie, avec, entre autres, son camarade de captivité Dufrenne. Il y fera
nommer quelques temps plus tard E. Lévinas. Depuis 1960 et son article-tournant « Le
symbole donne à penser », publié dans la revue Esprit en 1959, Paul Ricœur est entré dans un
moment majeur de son parcours philosophique. Il qualifiera plus tard ce dernier de « greffe
herméneutique » sur son programme phénoménologique. L’idée centrale en est qu’une
philosophie sans présupposition, sans pré-compréhension, est impossible, et que toute naïveté
est en quelque sorte « seconde », comme reconquise par-delà un moment critique. C’est
d’ailleurs le moment où Ricœur découvre et publie, dans la collection qu’il dirige au Seuil, le
livre du philosophe de l’herméneutique post-heidegerrienne Hans-Georg Gadamer, Vérité et
Méthode. Ricœur reprend certains des grands thèmes de cette herméneutique, mais en les
soumettant à un déplacement. C’est qu’en dépit de Heidegger et de Gadamer, il recherche une
herméneutique « critique », c’est à dire une herméneutique qui ne sépare pas l’appartenance
ontologique à une pré-compréhension englobante d’une part, de la distance critique induite
par la diversité des méthodes scientifiques de décryptage du sens d’autre part (mises en
oeuvre dans le travail quotidien de l’exégèse biblique, mais aussi de la philologie littéraire, de
l’interprétation historique, ou dans la jurisprudence, etc.).
Nommé doyen de la faculté des Lettres de Nanterre en 1969, il connait plusieurs
déconvenues résultant des événements de 1968 et ne parvient pas à assurer le rôle de
médiation qu’on lui demandait. Cet échec le conduit à démissionner en 1970. L’échec de la
gestion de Nanterre, s’ajoutant à celui d’une candidature en 1969 au Collège de France, pour
laquelle on préférera nommer Michel Foucault, conduit Paul Ricœur, tout en continuant à
enseigner en France, à s'investir davantage à l’étranger: à l'Université de Louvain, haut lieu de
la phénoménologie qui abrite les archives Husserl (sauvées des nazis et exilées par le Père
Van Breda), où il enseigne pendant trois ans, mais aussi à Montréal, et surtout à la célèbre
divinity school de Chicago, où il accepte la chaire John-Nuveen de 1970 à 1992, succédant
ainsi à Paul Tillich. La fin des années 80 et les années 90 marquent cependant un véritable
retour en grâce de Ricoeur en France. Il décède il y a à peine 10 ans, en 2005.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%