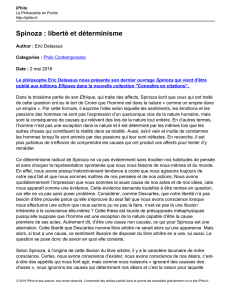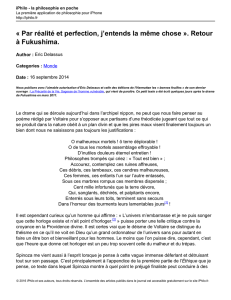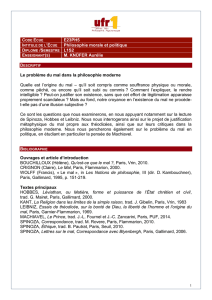Nouveauté et éternité. Instaurations spinozistes éditées par

MICHAËL DI VITA
NOUVEAUTÉ ET ÉTERNITÉ
INSTAURATIONS SPINOZISTES ÉDITÉES PAR
JOHANNES CLIMACUS
Mémoire présenté
à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université Laval
dans le cadre du programme de maîtrise en philosophie
pour l’obtention du grade de Maître ès arts (M.A.)
FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
UNIVERSITÉ LAVAL
QUÉBEC
2012
© Michaël Di Vita, 2012

ii

iii
Résumé
Ce mémoire est le fruit d’une enquête sur le problème de la nouveauté dans la philosophie
de Spinoza. Je me suis intéressé à la critique que ce dernier fait des nouveautés un peu
partout dans ses œuvres, et, au fur et à mesure où j’avançais dans mes recherches, j’ai
compris que si la nouveauté devait figurer au sein du système spinoziste, ce n’était pas en
tant que nouveauté objective, mais en tant que nouveauté radicale, inscrite au cœur même
de l’expérience de la béatitude éternelle. Le paradoxe de la nouveauté et de l’éternité est
donc devenu l’objet principal de mon enquête. C’est lui que j’ai découvert et expérimenté à
quelques endroits de l’Éthique et du Traité de la réforme de l’entendement. Or les
différentes expressions de ce paradoxe m’ont peu à peu amené à modifier mon problème
initial, car le paradoxe à partir duquel j’ai abordé le problème de la béatitude renvoyait de
diverses manières à l’écriture de Spinoza, laquelle réfléchit activement le problème de la
nouveauté en tant qu’elle s’inscrit essentiellement dans le parcours qu’effectue le lecteur
dans sa quête de la béatitude. Ce sont alors les stratégies d’écriture informant le rapport du
lecteur à la nouveauté que j’ai essayé de comprendre comme autant de moyens
philosophiques que Spinoza a forgés pour le lecteur désirant atteindre une nouvelle sagesse,
et qui, épris de ses affects, oscille perpétuellement entre l’admiration de la béatitude et la
fiction de la nouveauté ou sa critique, ayant peine à viser la cible de son désir. Du coup
mon enquête sur le problème de la nouveauté s’est transformée en la réflexion de mon
propre désir d’enquêter sur la nouveauté dans la pensée spinoziste. Car si Spinoza est
attentif aux causes qui nous déterminent à désirer la béatitude, il me fallait aussi me tourner
vers le problème de l’écriture en participant à l’instauration du champ des désirs, non plus
du point de vue de Spinoza, mais du mien, passant ainsi du rôle de commentateur
transparent à celui d’expérimentateur multiple résolument inclus dans son enquête
réflexive. Pour réfléchir ce rapport personnel à la nouveauté en philosophie, et afin
d’exposer les modalités du sentiment et des désirs sous-jacents à ma décision de prendre le
système de Spinoza comme objet de recherche et de pratique, il m’a paru nécessaire de
recourir moi-même à la fiction, laquelle éclate au carrefour du paradoxe de la nouveauté et
de l’éternité de la béatitude. C’est la fiction qui a permis à cette enquête de se différencier

iv
en quelques-uns de ses aspects, par exemple en fabriquant des rôles et des formes de
discours qui cherchent à répondre aux multiples modulations du paradoxe. Pourquoi choisir
Spinoza comme maître, demandera-t-on, et non d’autres philosophes ? La réponse est
contingente ; bien que j’aie tâché d’en tirer nécessité en rapportant ce choix aux autres
influences se mouvant à la source de mon enquête. En auscultant mon sentiment, le
philosophe Johannes Climacus, une voix constitutive de la polyphonie kierkegaardienne
que j’aime bien, est apparu en sa qualité de maître en concurrence avec Spinoza, l’autre
voix bien définie de cette enquête. Le paradoxe de la nouveauté et de l’éternité est au
fondement de toute l’entreprise philosophique de Climacus, et c’est pour cette raison qu’il
m’a semblé nécessaire de le faire apparaître pour lui-même, en tant que maître et
diagnosticien d’un disciple, M.D., lequel est fictif et pourtant non moins réel que le sont les
œuvres de Spinoza et de Climacus. L’enquête est alors passée d’un mode subjectif à une
pluralité de modes de pensée ou de personnages auxquels la vérité n’appartient à aucun
d’entre eux pris séparément, un peu comme les propositions et autres modes de discours
dans l’Éthique qui n’ont de puissance qu’en leur champ de rencontres. La fiction est au
principe de la structure de ce champ et il aurait été de mauvais goût que mon enquête
cherche à la neutraliser ou à la supprimer. La raison pour laquelle j’ai décidé de mélanger
mon entreprise avec la fiction est donc fournie par le déploiement du paradoxe de la
nouveauté et de l’éternité. Il va de soi qu’elle ne peut faire l’objet d’un résumé. Seulement
les personnages et la mise en scène pourront justifier cette propension à la fiction, et, peut-
être, réussiront-ils également à relancer le lecteur dans le jeu de ses propres réflexions
quant à son désir de produire de la nouveauté en philosophie. Car ce n’est que de cela qu’il
s’agit dans ce mémoire à multiples points de vue : comment réfléchir et comprendre la
nouveauté qui peut-être s’avère nécessaire pour notre propre quête de sagesse éternelle ? Ici
se forme le film essentiellement inachevé de cette tentative paradoxale qui ne m’appartient
plus ; j’espère que le lecteur acceptera d’y mettre du sien et d’y jouer son autorité privée.

Table des matières
Résumé ........................................................................................................................................ i
Table des matières .................................................................................................................. v
Préface, Par Johannes Climacus .......................................................................................... 1
Le problème de la nouveauté dans la correspondance et dans l’appendice à la
première partie de l’Éthique ............................................................................................. 11
Décision et invention dans le Traité de la réforme de l’entendement .................... 55
Nouveauté et éternité….. .................................................................................................. 103
Postscriptum à l’œuvre inachevée de M.D., Par Johannes Climacus .................... 113
Bibliographie ....................................................................................................................... 134
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
1
/
143
100%