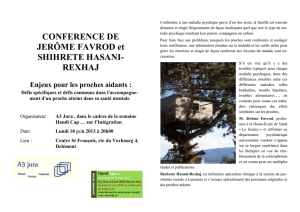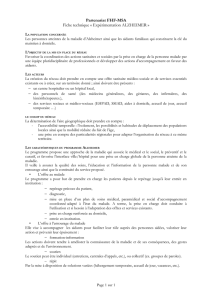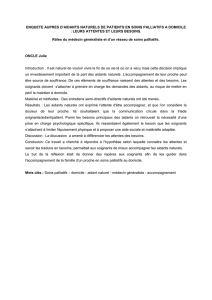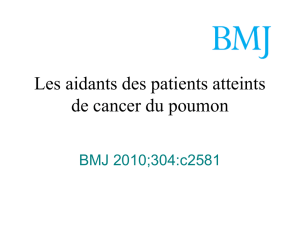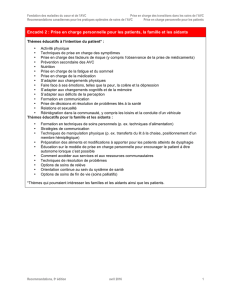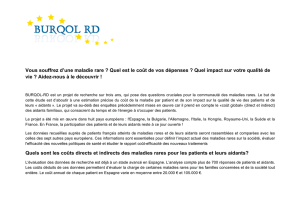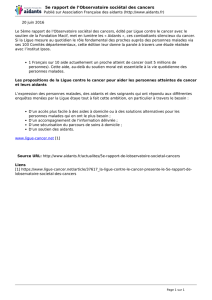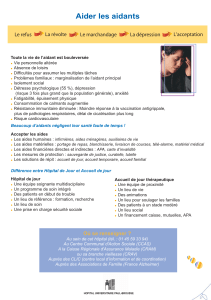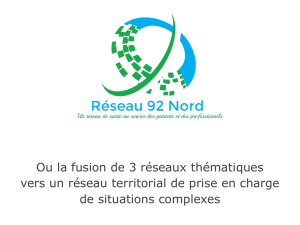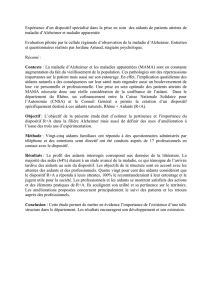Les proches accompagnant un malade en fin de vie

Les proches accompagnant un malade en fin de vie : quelles conséquences, quels supports ?
Extrait du site de la Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon
http://www.croix-saint-simon.org
Les proches accompagnant un
malade en fin de vie : quelles
conséquences, quels
supports ?
- Formation et Recherche - Centre De Ressources National soins palliatifs François-Xavier
Bagnoud - Information et Documentation - Produits documentaires - Synthèses documentaires
-
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon
Tous droits réservés
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 1/9

Les proches accompagnant un malade en fin de vie : quelles conséquences, quels supports ?
Introduction
Dans les pays occidentaux, toutes les études le montrent, la famille est engagée auprès des personnes malades, en
situation de handicap ou âgées dépendantes. De même, les proches sont très présents au moment de la fin de la
vie. Quels que soient les efforts professionnels, le malade peut rarement rester chez lui sans la participation active
de l'entourage. Et même lorsque la mort survient à l'hôpital, une partie du parcours de soins palliatifs ou de la
période de fin de vie se déroule à domicile. Chez soi, les proches-aidants représentent la clef de voûte de la
permanence et de la continuité relationnelles et des soins ; ils réalisent de nombreuses tâches de soutien et de soins
au regard de la situation de la personne souffrante et en fin de vie. Lors des séjours hospitaliers, ils restent présents
auprès du malade et continuent à jouer un rôle important notamment en assurant, en complément des soignants,
certains actes de la vie quotidienne.
Cette synthèse, essentiellement basée sur des publications médicales, a pour objet d'analyser les conséquences
pour l'entourage de leur implication auprès d'un malade en fin de vie, et aussi de repérer dans la littérature, les
facteurs de production ou d'aggravation de ces effets. Puis, nous analyserons les supports offerts aux aidants afin de
leur permettre d'assurer cet accompagnement dans les meilleures conditions possibles.
Il importe de lire ce texte avec prudence. En effet, les auteurs définissent rarement ce qu'ils entendent comme
« aidants » et « non-aidants ». Selon les études, nous ne savons pas dans quelle catégorie est classée, par
exemple, une femme qui assure l'ensemble des tâches de la vie quotidienne auprès d'un conjoint âgé et non malade,
ou autre exemple, un proche, qui assure une présence relationnelle et affective auprès d'un malade en fin de vie
sans participer aux soins ou aux actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, les troubles ou bénéfices sont repérés à
partir de méthodes très variées qui rendent les interprétations et la synthèse délicates. Ensuite, les effets
apparaissent différents selon les types d'aidants et selon le moment o๠ils sont mesurés (pendant la phase d'aide,
tout de suite après le décès, quelques mois après le décès). De plus, les études sont pour la grande majorité
anglo-saxonnes ou émanent des pays scandinaves, la transposition des résultats à la France ne peut être
totalement affirmée. Enfin, les études sont nombreuses, de qualité inégale ; elles apportent une multitude
d'informations de nature différente qui se prête mal à la synthèse. Il existe cependant de grandes tendances, des
résultats régulièrement trouvés dans différents pays que nous soulignerons dans ce texte.
Accompagner un proche en fin de vie : quelles conséquences pour les aidants ?
Même si l'entourage en retire un certain nombre de satisfactions, accompagner la fin de vie d'un être proche reste
une épreuve d'une grande intensité.
Les conséquences valorisées par les aidants
Certaines études montrent que s'occuper d'un proche permet parfois une forme d'accomplissement personnel, une
meilleure estime de soi et une relation renforcée aux autres. C'est l'occasion d'une meilleure connaissance de soi et
des autres, voire de donner un sens à ses actions pendant cette phase douloureuse (Hebert, Schutz, 2006). Plus
récemment, Wong et al. (2009) reprennent les résultats de plusieurs études montrant l'importance pour les aidants
d'avoir pu offrir à leur proche une fin de vie digne et une « bonne mort ». Bouchet et al. (2010) insistent également
sur cette dimension de satisfaction pour les membres de la famille. Au-delà de résultats déjà mis en évidence,
l'étude qualitative de Wong, auprès de 23 aidants en Australie, montre que les aidants disent avoir découvert des
ressources personnelles qu'ils ignoraient : une force imprévue à travers l'adversité, des capacités à reconnaà®tre la
gravité de la situation tout en trouvant des chemins pour répondre aux difficultés et aux nécessités de
l'accompagnement du malade en fin de vie. Les aidants valorisent la qualité de la relation qui s'est développée
pendant cette période avec le malade. Lorsque celui-ci était au courant de sa mort proche, l'intensité du temps passé
ensemble en a été renforcée. Ces études sont concordantes avec les recherches en sciences humaines et sociales
à propos de l'expérience de la maladie et du handicap. Les situations personnelles difficiles peuvent s'inscrire dans
la trajectoire biographique des individus comme élément de construction de soi et de sa relation aux autres.
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 2/9

Les proches accompagnant un malade en fin de vie : quelles conséquences, quels supports ?
Les conséquences néfastes sur les aidants
Cependant, les auteurs médicaux et paramédicaux parlent assez peu des conséquences valorisées par les aidants.
Ils mettent essentiellement l'accent sur les répercussions néfastes, en termes de santé physique et mentale, pour
l'entourage. Globalement, sur tous les facteurs étudiés, les études montrent une détérioration de la santé des
proches aidants ou une moins bonne santé que des personnes comparables mais « non-aidants ». Les résultats sont
plus ou moins négatifs et les effets inégalement répartis au sein des proches aidants.
Les conséquences psychiques
Sensation de fatigue voire d'épuisement (Gaston-Johansson, 2004), anxiété et dépression, insomnie, sentiment de
solitude et de difficulté à faire avec ses émotions, détresse psychologique (Thomas, 2002) sont les aspects les plus
documentés (Favrot, 1985 ; Schultz, 1999 ; Pinquart, 2003 et 2004 ; Aoun, 2005 ; Hebert, Schutz, 2006 ; Pitaud,
2006). Pinquart et Sà¶rensen (2003) ont réalisé une méta-analyse portant sur 84 articles. Ils ont montré une
différence importante, au détriment des aidants par rapport aux non-aidants, dans la sensation de dépression, de
stress, d'efficacité personnelle et de bien-être subjectif. La prévalence de l'anxiété est estimée à environ la moitié
des aidants ; celle des dépressions autour d'un tiers à 40%. Kessler (2005) montre que l'anxiété est plus importante
si le proche est seul. Les troubles du sommeil sont également fréquents ; 25 à 50% selon les études (Carter, 2009 ;
Aoun, 2005). Ils sont en partie dus au fait que les aidants donnent des soins programmés ou impromptus aux
malades durant la nuit. Ils relèvent également d'une charge psychique et mentale importante qui perturbe le
sommeil. Carter et al. (2009) reprennent plusieurs études qui montrent que la quantité et la qualité du sommeil sont
perturbées. Plus les troubles sont prolongés, plus ils sont associés à une augmentation des syndromes dépressifs et
d'autres problèmes morbides. La montée en âge et le fait d'être une femme augmentent la fréquence des troubles.
Ils peuvent perdurer des mois, voire des années, après le décès du malade (Carter, 2005).
Pinquart et Sà¶rensen (2004) ont réalisé une méta-analyse à partir de 60 études sur le bien-être subjectif des
aidants en comparaison de celles sur les symptômes dépressifs des aidants. Le stress des aidants est très fortement
corrélé aux symptômes dépressifs. De nombreux aidants protègent leur bien-être aussi longtemps qu'ils ont
suffisamment de temps pour poursuivre les activités qui leur sont essentielles. Le niveau de dépendance du malade
n'a qu'un effet modeste sur le bien-être subjectif des aidants contrairement au niveau de soins. De ces deux
dernières assertions, les auteurs concluent que donner plus de soins n'a pas un effet forcément négatif sur le
bien-être des aidants, probablement aussi longtemps que leurs autres rôles et activités sociales, leur apportant
suffisamment de satisfaction, ne sont pas trop restreintes. Burton et al. (2008) montrent que le type de diagnostic
(cancer ou démence) et l'appréciation des aidants (sur le niveau de stress, les déficiences fonctionnelles et les
aspects positifs pour les aidants) ne sont pas prédictifs du sentiment de bien-être. Par contre, la courte durée de
l'aide est significativement corrélée à un haut niveau de dépression et de chagrin au moment du deuil, comme si le
soutien apporté dans la durée au malade préparait l'aidant à mieux supporter la perte. Enfin, un haut niveau de
dépression post-décès est associé à un niveau bas d'activité sociale, un faible réseau relationnel et une moindre
satisfaction dans les services apportés au malade ou à l'entourage.
Les conséquences physiques
Au-delà de la fatigue ou épuisement qui peuvent avoir plusieurs causes, Pinquart et Sà¶renson (2003) ont montré
que le niveau de santé physique est affecté chez les aidants par rapport aux non aidants mais dans une moindre
mesure que pour le niveau de santé psychologique.
Sur le plan physique, Schultz et Beach (1999) ont mis en évidence une surmortalité significative (+63%) chez les
conjoints aidants âgés par rapport à un groupe contrôle de non-aidants. L'augmentation de la morbidité (Pinquart,
Sorensen, 2003), notamment des problèmes cardiovasculaires (King et al., 1994 ; Schultz et al., 1997) est
documentée. Globalement, les aidants sont moins attentifs à leurs propres soucis de santé et s'engagent moins
dans des actions préventives ou de soins (Schultz et al., 1997).
Les aspects financiers
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 3/9

Les proches accompagnant un malade en fin de vie : quelles conséquences, quels supports ?
Les conséquences financières sont peu documentées dans la littérature. Barbara Hanratty et al. (2007) ont réalisé
une revue de la littérature concernant le stress lié à des soucis financiers en phase terminale de cancer. Cette
question est surtout traitée aux Etats-Unis au sein desquels un nombre significatif de personnes (patients ou aidants)
déclarent des problèmes financiers pendant la fin de vie. Kessler et al. (2005), en Angleterre, montrent une
aggravation des inégalités d'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables socialement et en fin de vie.
Les variations selon les aidants
Globalement, les femmes (Yee, 2000 ; Pinquart, 2003) et les conjoints, accompagnant un malade en fin de vie,
présentent davantage de troubles que les autres aidants (Hébert, Schultz, 2006). Pour les conjoints, cela peut
s'expliquer par la proximité affective et physique avec le malade et l'intensité des soins apportés. Ces derniers
peuvent également développer des effets néfastes du fait de leur grand âge qui peut diminuer leurs ressources
physiques et psychologiques. Les femmes sont, selon ces auteurs, davantage à risque car elles sont davantage
conscientes de leurs émotions, plus empathiques et ont moins tendance à faire valoir leurs sentiments négatifs.
L'essentiel des études anglo-saxonnes s'appuie sur les notions de stress et de coping (Hébert, Schultz, 2006). Dans
cette perspective, de nombreux autres facteurs influent sur les réactions de stress pour les aidants et sur les
conséquences sur leur santé : les supports sociaux, les attributs personnels, les pratiques religieuses, l'estimation de
la situation par l'aidant, les types de coping mobilisés par les aidants.
Accompagner un proche en fin de vie : quels supports pour les aidants ?
A l'heure du développement des soins palliatifs au domicile, accompagner, soutenir et faciliter le travail des proches
représente donc un enjeu des pratiques professionnelles et des politiques publiques. Des programmes sont
développés, en ce sens, dans les différents pays occidentaux (Ferris, 2002 ; Ringdal, 2004 ; Mac Millan, 2005 ;
Dobrof, 2006). Les études rapportées dans la littérature médicale mettent l'accent sur quatre types de besoins
(Hebert, Schultz, 2006) : le confort du patient, les besoins d'information, les besoins en services de soins, le soutien
émotionnel. Ferris et al. (2002) ont développé un modèle de pratique pour repérer les besoins des patients et des
aidants, et pour y répondre. Dans la littérature, les approches et les propositions pour répondre à ces besoins sont
de nature très diverses. Les méthodes d'évaluation plus ou moins rigoureuses rendent les résultats soumis à
caution (Harding et Higginson, 2003 ; Mc Millan et al., 2005 ; Hébert et Schultz, 2006). Les pages suivantes illustrent
la diversité des dispositifs de soutien proposés aux aidants ; ils sont soit ciblés sur un point particulier, soit envisagés
de manière plus « systémique ». Elles donnent des hypothèses (faute de résultats bien validés) quant aux bénéfices
apportés par telle ou telle action de soutien des aidants. Mais d'abord reconnaà®tre la place singulière des aidants
est un enjeu des pratiques professionnelles.
La place singulière des aidants
Les quelques recherches en sciences sociales consultées montrent la place singulière des familles dans
l'accompagnement d'un proche malade. Ewa Bogalska-Martin (2007) a réalisé une recherche au sein d'une unité de
soins palliatifs. Elle analyse la souffrance comme phénomène situé « au cÅ“ur d'un vaste système d'échanges qui
concerne autant les proches, les familles des malades, que les professionnels... ». Elle montre que même si les
équipes soignantes développent « des attitudes de compassion et de compréhension de la vulnérabilité des familles
face à la maladie de leur proche », la souffrance des familles est difficile à accueillir et supporter pour les
professionnels. Il peut être alors demandé aux proches de mettre leur souffrance de côté pour apporter leur soutien
au malade ; leur place au sein des services hospitaliers peut gêner, il existe peu d'espaces dédiés à leur présence.
Les proches entrent parfois en concurrence symbolique avec les soignants. Ils sont en tension entre leur place
auprès du malade et leurs tâches habituelles et doivent souvent réaliser des choix douloureux et insatisfaisants.
Dans un tout autre registre, Simone Pennec (2004) souligne les subtils ajustements entre les valeurs et normes de
santé des familles, des malades et des professionnels. Chaque partie se réfère à des règles et compose des ordres
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 4/9

Les proches accompagnant un malade en fin de vie : quelles conséquences, quels supports ?
de priorité qui peuvent entraà®ner ajustements, tensions ou conflits. La multiplicité des services et des
professionnels facilite la réponse à certains besoins et attentes tout en multipliant les risques d'incohérence. En
effet, les personnes malades, les différents membres de l'entourage et les différents professionnels développent des
logiques d'action qui ne peuvent pas être parfaitement concordantes (Bungener et col., 2006 ; Pennec, 2004). Du
côté des soignants (Thibaut, 2009), la présence des familles entraà®ne des modifications des pratiques soignantes
et médicales (sortir de la relation duelle ; accepter le regard d'un tiers sur les soins ; se situer face aux habitudes de
vie et de relations des familles...). Des formateurs sont sollicités pour travailler sur ces questions avec les soignants
(Thibaut, 2009). Ce travail a d'autant plus d'importance que les proches-aidants peuvent davantage mobiliser leurs
ressources lorsqu'ils perçoivent qu'ils partagent la responsabilité des soins avec les professionnels (Gysels et
Higginson, 2009).
Répondre à des besoins spécifiques
Expliquer que tout est fait au mieux pour le patient
A propos du confort des patients, les proches-aidants disent combien il leur est important de percevoir que tout est
fait au mieux pour le malade (Miettenen, 2001 ; Frattini et al. 2008). Dans l'étude de Fridriksdottir (2006), « Etre
assuré que les soins les meilleurs sont donnés au patient » représente le deuxième besoin exprimé par les aidants.
Schulz et ses collaborateurs ont montré que la perception de la douleur des patients par les aidants contribue à leur
dépression et leur épuisement ; ce, davantage que les handicaps physiques et psychiques ou que les troubles du
comportement et le temps passé à réaliser les soins (cité par Hebert, Schulz, 2006). En effet, « ... la peur de souffrir
ou de voir le patient souffrir est une forme très partagée de la souffrance » (Bogalska-Martin, 2007). Dans l'étude de
Marco et al. (2005), la satisfaction des membres de la famille porte d'abord sur les soins globaux apportés, et les
indices de non satisfaction d'abord sur la perception d'une incompétence professionnelle, ou d'une attitude de soins
inadaptée. Les explications, même courtes, permettant de faire valoir comment les professionnels sont attentifs au
confort du patient et aux signes de l'agonie, ont une fonction apaisante pour l'entourage.
Pouvoir sécuriser, informer, former
Une formation des aidants, au domicile, pour gérer les médicaments à donner à la personne en fin de vie a montré
que celle-ci permet un meilleur soulagement des symptômes pour le patient et un apaisement de l'anxiété chez les
proches (Anderson, Kralik, 2008). Il est à préciser que cette formation a été couplée à un dispositif de permanence
téléphonique pour les proches. Or, on sait que les réponses rapides en cas de crise diminuent, par ailleurs, l'anxiété
(Kessler, 2005). Plus largement, pour faire face et mobiliser leurs propres ressources, les aidants soulignent qu'il est
rassurant de pouvoir joindre, quoi qu'il arrive, un professionnel qui connaà®t la situation (permanence téléphonique),
et savoir qu'une hospitalisation sera possible même en urgence. Sans forcément y recourir, de telles ressources
permettent de « tenir » dans la durée, puisqu'une alternative existe si le proche se sent dépassé. En ce sens, en
France, les permanences téléphoniques mises en place par les réseaux de soins palliatifs sont utiles et appréciées.
Le filet constitué par le réseau social informel et les dispositifs disponibles à tout moment prennent, dans l'optique
de sécuriser les aidants, une valeur essentielle, bien avant le soutien psychologique spécialisé (Frattini, Mino, 2008).
En ce qui concerne l'information ou la formation des aidants, les besoins mis en évidence sont concordants mais les
résultats des dispositifs mis en place sont contrastés. Les aidants ont à réaliser de nombreux soins de confort et
peuvent, surtout au domicile, être seuls lors de l'aggravation des symptômes et de l'agonie, pour lesquels ils sont
particulièrement mal préparés (Gysels et Higginson, 2009). Harding et al. (2002) montrent les besoins d'information
des proches et proposent des dispositifs de soutien pour limiter l'angoisse. Des groupes ponctuels d'information et
de partage entre aidants, animés par des professionnels, ont montré leur intérêt : pouvoir s'identifier à d'autres
personnes vivant la même situation, partager, s'aider, s'encourager tout en bénéficiant des apports des
professionnels (Harding et al., 2002). Cependant, Hebert et Schulz (2006) arguent qu'il ne suffit pas d'augmenter le
niveau de connaissances des proches pour améliorer les résultats en termes psychologique et social. Ce sont les
programmes d'éducation, plus exigeants et donc moins accessibles, qui entraà®nent des effets positifs sur la fatigue,
les symptômes de dépression ou la sensation de bien-être. E. Bogalska-Martin (2007) déplace la question et
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 5/9
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%