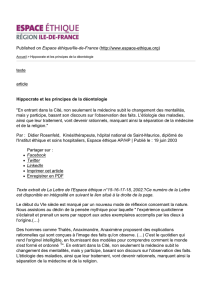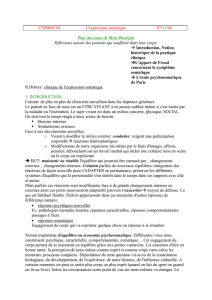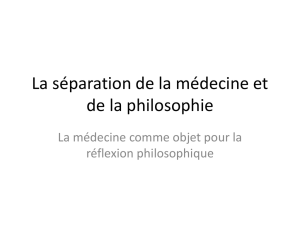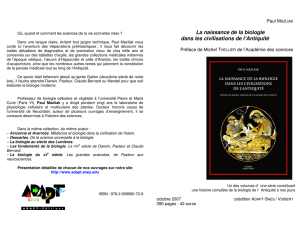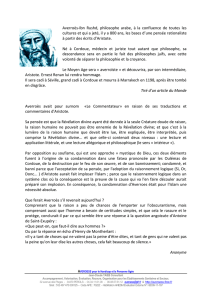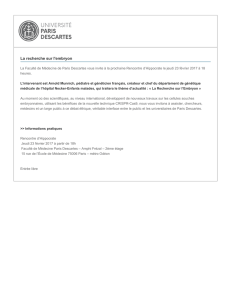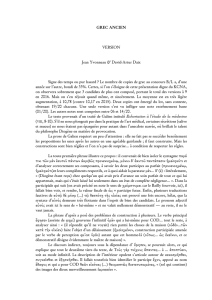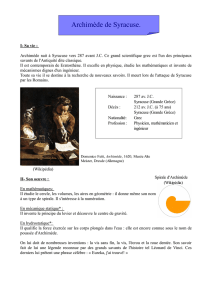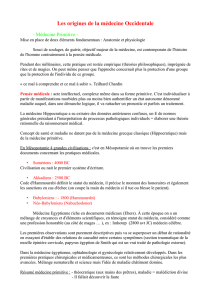Le rationnel et l`irrationnel dans le progrès médical : l`exemple du

HISTOIRE
78 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XIII - n° 2 - mars-avril 2010
Le rationnel et l’irrationnel
dans le progrès médical : l’exemple
du cancer de l’Antiquité à nos jours
J.L. Pujol*
* Médecin des hôpitaux, professeur de pneumologie, faculté de médecine de Montpellier ; unité de psycho-oncologie
et service des maladies respiratoires, hôpital Arnaud-de-Villeneuve, centre hospitalier universitaire, Montpellier.
“En médecine, on guérit généralement
par les contraires”
Aristote – Éthique à Nicomaque
Le progrès médical présente, pour nous méde-
cins de l’ère dite moderne, la principale qualité
d’être le fruit d’un raisonnement rationnel : sur
le modèle de la médecine expérimentale d’un Claude
Bernard, nous estimons qu’une hypothèse doive
recevoir une validation selon un plan d’étude appro-
prié, capable de répondre à une question, elle-même
à l’origine d’une autre hypothèse, et ainsi de suite.
La connaissance évolue par acquisitions successives,
ce qui est le principe même du positivisme (1) tel
que proposé par Auguste Comte (1798-1857). En
matière de cancérologie, comme dans beaucoup
d’autres domaines en médecine, ce modèle paraît
efficient, puisqu’il est à l’origine d’une accélération
prononcée de la connaissance physiopathologique
des diverses voies d’activation de la cellule cancé-
reuse, de l’organisation de ces voies, de leur redon-
dance et des possibilités de les inhiber ou de les
normaliser. Le caractère normatif de la connaissance
médicale acquise par l’expérimentation rationnelle
paraît tout à fait établi (2), et il n’est pas de mon
propos, ici, de le contredire.
Cependant, cette manière objectivante de penser
le progrès en cancérologie pourrait nous faire rapi-
dement oublier que l’acquisition de la connaissance
médicale n’a pas toujours été “un long fleuve tran-
quille”, et qu’il est bien des cas où l’irrationnel, voire
le surnaturel, se sont immiscés dans la pensée des
plus fortes personnalités qui ont fait la médecine. Ce
que je viens de dire nécessite, me semble-t-il, une
justification, car je ne voudrais pas laisser croire,
comme simple médecin intéressé par la philoso-
phie des sciences, que je tienne moi-même cette
façon d’exposer les choses pour irréprochable. Le
lecteur pourrait me faire observer que l’irruption de
l’irrationnel dans les concepts médicaux n’est pas
le domaine réservé du cancer, et que des théories
analogues émaillent l’histoire d’autres affections,
Résumé
La connaissance médicale évolue par acquisitions successives, ce qui est le prin-
cipe même du positivisme scientifique. En matière de cancérologie, comme dans
beaucoup d’autres domaines en médecine, ce modèle paraît efficient puisqu’il est
à l’origine d’une accélération prononcée de la connaissance physiopathologique.
Le caractère normatif de la connaissance médicale acquise par l’expérimentation
rationnelle paraît tout à fait établi. Cependant, cette manière objectivante de
penser le progrès en cancérologie pourrait nous faire rapidement oublier que
l’acquisition de la connaissance médicale n’a pas toujours été le seul fruit de la
raison, et qu’il est bien des cas où l’irrationnel, voire le surnaturel, se sont immiscés
dans la pensée des plus fortes personnalités qui ont fait la médecine. Le progrès
médical et les connaissances acquises en cancérologie résultent souvent d’une
désobéissance aux conceptions héritées du passé et d’un entêtement face aux faits
qui résistent. Il y aura toujours une part d’irrationnel. C’est pourquoi, le progrès
médical, contrairement au progrès de la physique ou des mathématiques, emprunte
bien souvent des voies détournées qui le font paraître comme peu clairvoyant, et
l’on serait très embarrassé de citer une découverte en cancérologie qui soit due
au raisonnement pur et simple.
Mots-clés : Cancer – Histoire – Science – Art – Philosophie.
Abstract
Medical knowledge evolves through successive acquisitions, which is the principle
of scientific positivism. In terms of cancer, as in many other areas of medicine, this
model appears efficient because it is causing a marked acceleration of pathophy-
siological knowledge. The normative nature of medical knowledge gained through
experimentation rational seems quite settled. However, this way of objectifying
thinking progress in cancer might make us quickly forget that the acquisition of
medical knowledge has not always been the only fruit of reason and that is the
case where the irrational, even the supernatural, have interfered in the mind of the
strongest personalities who made the medicine. Medical progress and knowledge
gained in cancer often result from disobedience to the concepts of past and deal
with a stubborn facts stand. There will always be an element of irrationality. There-
fore, medical progress, contrary to the advancement of physics or mathematics,
often borrows circuitous routes that make it seem as short-sighted and it would
be very embarrassed to mention a breakthrough in cancer that is caused by pure
and simple reasoning.
Keywords: Cancer – History – Science – Art – Philosophy.

HISTOIRE
ιστορία
medicus
vita
ιστορία
vita
Figure 1. Le mythe d’Héraclès. Vase athénien. Musée du Louvre.
La Lettre du Pneumologue • Vol. XIII - n° 2 - mars-avril 2010 | 79
telles que la tuberculose, pour citer l’une de celles
qui font notre culture commune de pneumologues.
Cependant, le cancer est porteur paradigmatique
de toutes les peurs archaïques, en cela qu’il réfère
à l’imaginaire collectif depuis l’Antiquité, sans qu’il
n’y ait eu de discontinuité historique ; il renvoie ainsi
à l’une des trois origines de la souffrance humaine
telles que Freud les définissait dans Malaise dans
la civilisation : la caducité du corps. En réalité, je
souhaiterais, dans cet article, illustrer de quelques
exemples célèbres les effets de l’irrationnel dans
la pensée médicale, en m’appuyant sur ce que les
interrogations autour du “cancer” ont généré dès les
premiers temps de la médecine antique. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait croire, ces effets n’ont pas
toujours été négatifs. La pensée irrationnelle a deux
principaux moteurs : tout d’abord, l’étonnement de
l’homme face à l’incompréhensible (3), lequel éton-
nement génère un nombre important de pensées
imaginaires, certaines d’entre elles portant le germe
possible d’une avancée médicale. C’est ensuite la
transgression de certaines règles établies : ainsi le
franchissement de l’interdit de la dissection d’un
cadavre humain, un interdit qui tenait à la notion
que l’âme humaine était matériellement rattachée
au corps et qu’elle en était, comme le considérait par
exemple Aristote, la cause formelle du corps ; cette
levée de tabou devait inaugurer l’ère des anatomistes
et déclencher la première révolution médicale.
Avant d’être une maladie, le cancer est une peur (4).
Elle est ancrée dans l’imaginaire collectif comme
un fléau frappant sans discernement apparent. Il y
a toujours eu, et il y aura toujours, un écart entre
une connaissance objective et médicale du cancer
et une connaissance subjective de cette maladie
pour celui qui en est atteint ou pour la société qui
en a peur. C’est l’inconnu du phénomène cancer qui
s’oppose le plus activement et le plus positivement à
une objectivation rationnelle (3). Dans ce domaine,
toute connaissance scientifique nouvelle se heurtera
à un préjugé, à une connaissance naïve autour de
la maladie. Mais l’objectivité dans l’analyse de la
connaissance médicale ne peut pas se substituer
à la subjectivité de celui qui souffre d’un cancer et
qui attend de son médecin, non pas de la connais-
sance, mais du secours. L’emprunte psychique de la
maladie, “la maladie du malade”, est difficilement
conciliable avec une médecine qui se veut science,
car cette emprunte résulte du clivage de la pensée
face à l’inconnu du vivant, l’irrationnel pouvant
prendre le pas sur le raisonnement. Si le cancer est
une peur collective, la connaissance naïve qu’en a
le groupe social est la fille de la peur. C’est pourquoi
le progrès médical, contrairement au progrès de la
physique ou des mathématiques, emprunte bien
souvent des voies détournées qui le font paraître
comme peu clairvoyant (5). On serait très embar-
rassé de citer une découverte en cancérologie qui
soit due au raisonnement pur et simple – et cette
réflexion aurait toutes les chances de s’appliquer à
de très nombreux domaines de la médecine. Le plus
souvent, les expériences qui sont tentées, même
aujourd’hui, finissent par nous montrer que la
manière d’opérer des cellules cancéreuses est préci-
sément celle à laquelle nous n’aurions jamais pensé.
C’est ce paradoxe que je voudrais illustrer dans les
pages qui suivent, en précisant aux lecteurs qu’elles
n’ont pas la prétention de faire œuvre d’historien ou
de philosophe, mais qu’elles sont plus modestement
celles d’un médecin curieux de connaître le sens que
l’on donne au concept de progrès médical.
L’Antiquité
Le cancer est connu comme tel depuis l’Antiquité
égyptienne, mais c’est l’Antiquité grecque qui fournit
le plus d’informations sur la relation de l’homme
à cette maladie, à une époque et en un lieu où la
philosophie était considérée comme la science
architectonique, et la médecine comme une simple
branche de la philosophie. L’un des premiers témoi-
gnages de l’étonnement de l’humain face à l’inconnu
du cancer est symbolisé par le mythe d’Héraclès
(figure 1), lequel, dans son combat contre l’Hydre
de Lerne, aurait (non intentionnellement) piétiné
Carcinos (du grec karkinos) venu prêter “pince forte”
à l’Hydre dans son combat. Héra, pour compenser
la faute commise par Héraclès, transforma Carcinos

HISTOIRE
ιστορία
medicus
vita
ιστορία
vita
1. Cette essence divine dont Hippo-
crate se réclamait n’a rien de cho-
quant, au sein d’une civilisation où
la frontière entre l’humain et le divin
n’était pas considérée comme infran-
chissable. Des traces de ces états
transitoires entre humain et divin sont
encore très perceptibles aujourd’hui,
quand les dieux nous sont proposés,
par exemple, groupés par quinze sur
des calendriers.
2. Peut-être le banc hippocratique,
qui était une technique d’immobili-
sation des fractures, ou la diététique
hippocratique, que ne renierait aucune
médecine naturelle aujourd’hui, peu-
vent-ils être sauvés du naufrage.
80 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XIII - n° 2 - mars-avril 2010
en une constellation, la constellation du cancer, d’où
Carcinos revient régulièrement se venger de l’huma-
nité. Lucien Israël (psychanalyste 1925-1996) disait
des mythes qu’ils “étaient des bouchons rassurants
qui viennent obturer les questions sans réponse”. En
cela, le mythe d’Héraclès est riche d’un enseignement
symbolique : (i) Carcinos devient la constellation du
cancer et le lien est fait entre le crabe et la maladie
qui sera de tout temps considérée par l’humanité
comme un intrus, comme un être à part, distinct
du malade. Je reviendrai plus bas sur cette question
ontologique. (ii) Héraclès commet une faute qui
réclame la médiation de Héra et qui sera suivie d’une
punition. Il y a donc dès l’Antiquité grecque la notion
d’une maladie-punition qui infère l’idée que le malade
soit également coupable. L’autre signifiant plus subtil
de ces mythes tient dans le caractère surnaturel et
cosmique de la genèse des maladies.
Grand médecin de l’Antiquité cinq siècles avant
J.C., Hippocrate de Cos (460-370 avant J.C.) avait
une conception analogue des maladies en général
et du cancer en particulier. Hippocrate se considé-
rait comme de lignage divin, puisqu’il avait reçu
un enseignement à Cos où il effectua sa forma-
tion médicale auprès des asclépiades, confrérie de
prêtres médecins vénérant Asclépios, le dieu grec
de la médecine1. Il lui revient d’avoir individualisé
la médecine des connaissances auxquelles elle était
traditionnellement rattachée (principalement la
philosophie). La conception hippocratique du corps
humain est un miroir du macrocosme : aux quatre
éléments du cosmos, l’eau, la terre, l’air et le feu,
Hippocrate détaille les quatre éléments constitutifs
du corps humain considéré par lui, non pas comme
un assemblage de tissus, mais comme un mélange
discret des quatre humeurs qu’étaient le sang, la
lymphe, la bile jaune et l’atrabile (6). Le médecin de
Cos considérait que la coagulation de l’atrabile était
à l’origine des cancers. Bien entendu, dans l’antiquité
grecque, il s’agissait surtout des patientes atteintes
de cancers de la matrice ou de cancers du sein. Cette
dyscrasie, ou mauvais mélange des humeurs, était
elle-même liée à l’influence du milieu extérieur, au
régime suivi par la patiente, voire à son caractère
psychique dominant (en l’occurrence atrabilaire).
Hippocrate était plus intéressé par le pronostic
que par le diagnostic des maladies, et la lecture du
livre de ses aphorismes montre la richesse de la
sémiologie qu’il utilisait afin de déterminer l’issue
favorable ou défavorable pour le malade, de ce qu’il
appelait la crise hippocratique. On a longtemps dit
que ses écrits n’étaient rien d’autre qu’une lente
méditation sur la mort. C’est méconnaître ce que
la médecine dans son ensemble doit à Hippocrate,
non pas en termes de technicité
2
mais en termes
praxéologique. Exercer la médecine dans la tradition
hippocratique pourrait reposer sur deux principes
essentiels : le premier est de faire la distinction
entre le possible et l’impossible. C’est le primum
non nocere qui signifie de facto que la cure a une
limite, même si le médecin doit rester secourable
par la palliation. La deuxième originalité de la parole
hippocratique est d’engager un dialogue avec le
malade, et, par là, Hippocrate fait référence aux
premières notions de psychologie.
Il y a du socratique dans la dialectique que le
médecin de Cos engageait avec le patient aux fins
de déterminer par le raisonnement une approche
du vrai, c’est-à-dire de la réalité de la maladie, de
son sens. Le lien entre la philosophie platonicienne
et Hippocrate est évident.
Il est d’ailleurs cité par Platon dans le dialogue de
Protagoras. Pour Hippocrate, “toutes les maladies
sont divines et toutes sont humaines”, et le micro-
cosme humain est le miroir d’un macrocosme. Nous
retrouvons ici la supériorité hiérarchique de l’idée sur
le monde sensible, la recherche de l’Un, tel qu’elle
était poursuivie par Platon dans la métaphore de
la caverne.
D’Hippocrate et de l’Antiquité grecque, le cancer a
hérité d’une conception ontologique propre de la
maladie. Tout se passe comme si le cancer était un
être à part, venu habiter un malade lui aussi un être
en tant qu’être mais d’une ontogenèse distincte.
Cette contingence de deux êtres, l’un venu envahir
l’autre, sera le principal objet de résistance contre
toute approche physiopathologique de la maladie.
Elle reste ancrée dans l’imaginaire collectif où le
cancer conserve l’image de l’intrus. La rétention
actuelle d’une telle conception est frappante dans la
description faite par Jean- Luc Nancy dans L’Intrus (7).
Dans ce court récit autobiographique, il qualifiait le
lymphome qui l’affectait de : “[…] figure ravageuse
de l’intrus, étranger à moi-même et moi-même
m’étrangeant”. Cela renvoie à la notion de l’intrus
persécuteur, qu’il lui faut nommer et qu’il lui faut
représenter en lui donnant une figure imaginaire.
D’Hippocrate à Galien
Cinq siècles séparent Hippocrate et Galien (129-200,
en latin Claudius Galenus ou plus exactement
Clarissimus Galenus, le clairvoyant), bien que le
deuxième se réclame ouvertement du premier. Mais
la conception de la connaissance selon Galien s’ap-

HISTOIRE
3. Le lecteur intéressé d’approfondir
ce chapitre pourra utilement se référer
à l’excellente synthèse publiée par
E. Attias et H. Labarthe dans le numéro 7
de la revue Médecine Et Culture
(décembre 2007 accessible à l’adresse
suivante : http://medecineetculture.
typepad.com). Cette synthèse fait une
analyse précise des apports médicaux et
philosophiques des figures marquantes
de la période médiévale et de la Renais-
sance, encore que la distinction des
connaissances médicales et éthiques
soit un peu artificielle, compte tenu
de l’interpénétration des avancées des
unes et des autres.
La Lettre du Pneumologue • Vol. XIII - n° 2 - mars-avril 2010 | 81
puie beaucoup plus sur l’ordre du sensible que sur
une recherche de l’Un en tant que vérité absolue et
monadique, et l’observation est le point de départ du
raisonnement médical. En cela, on pourrait considérer
Galien comme plus aristotélicien que platonicien. La
philosophie d’Aristote appliquée à la médecine se
résume ainsi : “On doit croire à la raison tant que ses
démonstrations s’accordent avec les faits perçus par
les sens ; mais lorsque le fait apparaît suffisamment
prouvé par eux, il faudra leur accorder plus de créance
qu’à la raison.” Suivant l’enseignement du philosophe
de Stagire, Galien fait de l’expérience sensible le point
d’ancrage de toute son œuvre. À son actif, il y a tout
d’abord la tentation de l’anatomie. Certes, la dissec-
tion du corps humain est toujours frappée d’interdit
au II
e
siècle, c’est pourquoi Galien dissèquera des
porcs et des singes, ce qui le conduira à transposer,
de manière erronée, chez l’homme, des observations
anatomiques faites chez le porc. Cette même tenta-
tion de l’anatomie le pousse à devenir médecin des
gladiateurs, puisque d’une certaine manière dans
ce métier, les exécutants se disséquaient les uns les
autres. Galien dira qu’il voyait dans chaque blessure
une fenêtre ouverte sur le corps humain. Il est à l’ori-
gine d’une ébauche de la physiologie, mais aussi des
vrais débuts de la pharmacologie ; c’est pourquoi les
docteurs en pharmacie prêtent encore aujourd’hui
le serment de Galien. Son œuvre, qui comporte plus
de cinq cents traités de médecine et de philosophie
ou d’éthique, lui faisait employer vingt scribes, dont
certains ont eu le matériel suffisant pour poursuivre
ses publications jusqu’en 207, soit sept ans après
sa mort. Mais il ne se contentait pas de penser la
médecine, il la pratiquait, inaugurant les premières
interventions de la cataracte.
Pourtant Claudius Galenus continuait à s’interroger
sur la physiopathologie du cancer, tout en le consi-
dérant “contre nature”. En effet, il est le premier à
introduire la notion de tumeur, les classant selon
trois ordres : les tumeurs selon la nature (la gros-
sesse), les tumeurs dépassant la nature (les cals
osseux) et les tumeurs contre-nature réservées aux
cancers. Ce que le vocable de cancer recouvrait pour
Galien a peu d’importance ; ce qu’il faut comprendre,
c’est qu’au IIe siècle après J.C., nous trouvons ici un
relais d’une conception surnaturelle et hors nature
du cancer, maladie sans lien avec la vie normale
dans l’esprit d’un médecin qui fut pourtant précur-
seur de la physiologie. Comme Hippocrate, Galien
met l’irruption du cancer sur le compte de l’atra-
bile, laquelle est également responsable pour lui de
la mélancolie. Il y a donc trace au deuxième siècle
d’une première théorie psychogénétique de l’irrup-
tion des cancers, puisque leur développement est
consubstantiel au chagrin. La psychogenèse réfère
à une vieille théorie régulièrement réactivée jusqu’à
l’époque la plus récente, selon laquelle les personnes
qui sont atteintes de cancer ont des caractères
stéréotypés, et que c’est ce trait de caractère qui
fait le lit du cancer. Bien que plusieurs méta-analyses
aient aujourd’hui démontré l’absence de lien entre
dépression et cancer, ou trauma et cancer, la théorie
psychogénétique est conservée dans la tradition de
nombreuses cultures, ce qui vérifie, comme Freud
l’affirmait dans la nouvelle introduction à la psycha-
nalyse, “qu’une théorie abandonnée par la science
persiste sous la forme d’une croyance populaire”.
La médecine médiévale
arabo-musulmane :
un pas vers le rationnel
L’héritage des connaissances accumulées depuis
l’Antiquité a été, d’une certaine manière, réprimée
pendant une longue période s’étendant jusque
vers le VI
e
siècle de l’ère chrétienne. L’empire latin
chrétien considérait qu’il fallait éradiquer la philo-
sophie païenne et, bien entendu, solder avec elle
les conceptions médicales antiques. Il y a alors une
extension de la science médicale vers l’Orient où elle
rencontre la culture arabo-musulmane, comme en
Iran avec Avicenne (980-1037), ou en Andalousie
avec Averroès (1126-1198). L’émergence de grands
penseurs de la médecine depuis cette culture tient
en grande partie à leur rôle de transmetteurs de la
métaphysique d’Aristote et de son commentaire par
Al-Fārābī (872-950). L’Orient musulman a servi de
creuset à l’art et à la philosophie, sans qu’il faille y
voir pour autant une empreinte religieuse particu-
lière. L’héritage d’Avicenne, d’Averroès ou d’Avenzoar
(1073-1162) est bien sûr celui de médecins forte-
ment ancrés dans leur foi, mais en même temps de
grands exégètes et, d’une certaine façon, de bons
conservateurs de la philosophie antique3.
Avicenne (ou Ibn Sīnā) étudia Aristote et Platon à
Boukhara. Grand lecteur de la métaphysique d’Al-
Fārābī, il fait une approche critique de la médecine
antique d’Hippocrate et de Galien. Son rôle dans
le développement du rationalisme en médecine
laissera un héritage considérable sous la forme du
célèbre Canon de la médecine, ouvrage en quatre
volumes qui sera réédité et enseigné jusqu’à la fin
du XVIIe siècle (un succès de librairie médicale qui
nous rend tous très modestes). Cette bible médi-
cale contient un grand nombre d’avancées tout à

HISTOIRE
ιστορία
medicus
vita
ιστορία
vita
82 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XIII - n° 2 - mars-avril 2010
fait extraordinaires pour les moyens du XI
e
siècle,
puisqu’elle porte en germe des notions d’anatomie,
d’infectiologie, de transmission des maladies par
des micro-organismes, toutes représentations qui
ébauchent la médecine moderne.
Avicenne prône un lien essentiel entre santé mentale
et somatique. Bien que sa conception de l’homme
soit typiquement aristotélicienne, puisqu’il considé-
rait que l’âme était la perfection du corps, c’est-à-dire
la chose qui fait vivre et réagir (8), il va nettement
envelopper cette pensée d’une inspiration néopla-
tonicienne en exprimant l’idée d’un intellect agent,
substance immatérielle émanant d’un intellect
absolu divin, lui aussi immatériel. C’est une entorse
à la pensée d’Aristote, qui considérait que l’âme ne
pouvait être pensée comme une forme séparée du
corps mais, Avicenne faisait par là une concession
qui rendait sa philosophie plus compatible avec les
écritures, c’est-à-dire avec l’idée d’une première
intelligence, l’Un, intelligence suprême influençant
l’intellect agent par une succession de hiérarchie
d’intelligences intermédiaires, chaque individu ayant
à sa charge l’intelligence de son perfectionnement
par le raisonnement. Avicenne est donc un penseur
essentiel du rationnel en médecine.
La recherche du perfectionnement de l’intellect
humain, de la compréhension du langage, est
la préoccupation centrale de l’œuvre d’Avicenne
comme celle d’Averroès (ou Ibn Rushd, “le fils du
sage”). Mais ce qui différencie ce dernier, qui fut
cadi de Cordoue, de son illustre aîné est le caractère
radical de sa philosophie de la médecine. Exégète
inconditionnel d’Aristote, il n’aura pas la prudence
tactique d’Avicenne et s’opposera aux théologiens
tels que Al-Ghazālī, qu’il n’hésitera pas à taxer de
mysticisme bien qu’il fût son guide religieux. Dans
une tentative de réconciliation de la religion et de
la philosophie, Averroès prônera l’aphorisme : “la
vérité ne peut contredire la vérité”. Par là, il concède,
d’une part, aux théologiens la vérité d’une révélation,
mais, pour lui, la pensée, c’est-à-dire la raison, naît
du cerveau dont il met en évidence les fonctions
motrices et les quatre forces spécifiques : l’imagi-
nation, la réflexion, la mémoire d’évocation et la
mémoire de fixation. Cela ancrera définitivement
Averroès dans la stature d’un rationaliste au sein
de la terre d’Islam car il prône l’indépendance de la
prééminence de la pensée adoptant la définition aris-
totélicienne de l’homme, “animal doué de raison.”
Cette raison est pour Averroès répartie en deux
niveaux hiérarchiques d’intellect : l’intellect agent-
actif, d’essence divine, qui est immatériel – c’est dans
celui-ci que glisse la pensée des hommes au moment
où le corps devient caduc “comme une goutte d’eau
dans la mer vers l’intellect général et universel –” ;
et l’intellect passif, qui est, lui, particulier – il est
apte à recevoir des concepts du premier intellect
et cela se transmet par les intelligibles, c’est-à-dire
les raisonnements qui ont ici le même rôle que les
sensibles (les faits cliniques observés) ont pour les
organes des sens. Averroès, en cela, suit le principe
d’Aristote : “Celui qui ne sent rien, n’apprend rien
et ne comprend rien”. C’est pourquoi la médecine
d’Averroès est teintée d’une grande modestie : elle
prônait la concertation entre médecins, elle ne faisait
confiance qu’au raisonnement, elle hiérarchisait les
techniques de secours aux malades (“en médecine, il
y a d’abord la parole, ensuite il y a l’herbe, ensuite il
y a le bistouri”). Averroès, par son opposition de prin-
cipe à la théologie, fait progresser la raison comme
moteur de la connaissance médicale.
Maïmonide (1135-1204), de confession juive, eu en
partage une conception médicale et philosophique
de l’humain très proche de celle d’Averroès, dont il
fut le contemporain. Sa naissance dans un Cordoue
sous domination maure, le contraignit, avec son
père et son frère, à trouver refuge à Grenade puis
au Maroc. Son œuvre est surtout d’essence philoso-
phique, car la vocation médicale fut tardive et même
contrainte lorsqu’il dû gagner sa vie après la dispa-
rition de son père puis de son frère. Ses écrits philo-
sophiques et religieux essayent de concilier les écrits
d’Aristote avec le Livre sacré, comme l’avait avant lui
tenté Averroès pour la confession musulmane. Nous
retrouvons ce grand écart entre raison et révélation,
très mal accueilli par la plupart des contemporains
qui exigent une lecture textuelle des écrits sacrés
là où il enseigne une lecture comme attributs allé-
goriques des écrits bibliques. Sa conception d’une
âme, cause formelle du corps, est très proche de la
pensée aristotélicienne ; dit plus simplement : pas
de corps sans âme et pas d’âme sans corps ! Tout
son exercice de médecin – peu original par rapport à
Avicenne – repose sur ces deux principes : le respect
de son propre corps en tant que siège de l’âme et
des intellects actifs et passifs, et une lutte acharnée
contre toutes les formes de superstition. Le dieu de
Maïmonide est ontologique, être en tant qu’être,
et non pas théologique, car il considère que toute
utilisation de mots pour le définir est une trans-
gression, une superstition, la connaissance humaine
étant toujours le fruit de la raison et seulement
applicable au monde sensible. Dans les pratiques
humaines, la connaissance, comme pour Aristote,
conduit à l’adoption de toute conduite modérée telle
que préconisée dans l’Éthique à Nicomaque : “Il n’y
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%