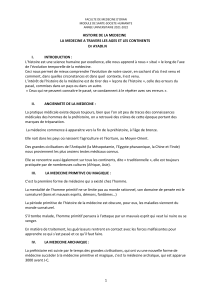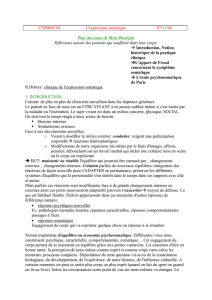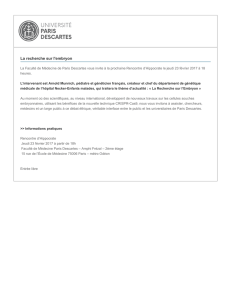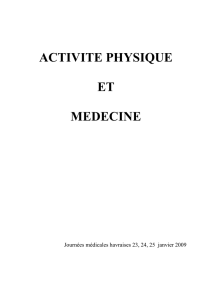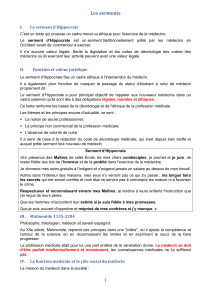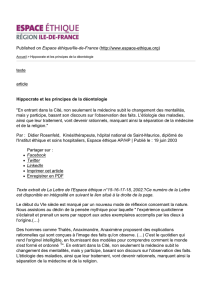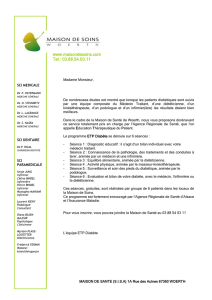la medecine

LA MEDECINE
(MEDECINE : Science qui a pour objet le traitement des malades et des maladies)

L’HISTOIRE DE LA MEDECINE
(HISTOIRE : Récit des événements relatifs aux peuples en particulier, à l’humanité en général)
(MEDECINE : Science qui a pour objet le traitement des malades)
INTRODUCTION
L’histoire de la médecine est indissociable de celle de l’humanité. L’homme s’est probablement
préoccupé très tôt non seulement de se nourrir, de se défendre, mais aussi de porter remède à ses maux.
Pendant des siècles, médecine et religion furent confondues ; c’est la période mythique : toute force
mystérieuse, toute idée maîtresse était figurée et représentée par une divinité et constituait un mythe
source du « pourquoi ». Ce n’est qu’après Hippocrate qu’interviendra le raisonnement (le « comment ») et
que le médecin se séparera du prêtre.
LA PREHISTOIRE
La médecine a longtemps été un art sacré et magique. L’homme primitif projetait dans l’Univers ce
qu’il sentait en lui. Il avait conscience de sa pensée, de sa volonté, de sa force, et croyait tout
naturellement que les manifestations extérieures qu’il observait étaient dues à des pensées, à des
volontés, à des forces supérieures à la sienne, invisibles, insaisissables, qu’elles étaient l’incarnation
d’esprits surnaturels qu’il élevait au rang de divinités. Il s’adressa d’abord aux dieux ou à leurs
représentants pour se protéger contre les dangers qui le menaçaient, dont la maladie. Dans ces temps
lointains, l’homme ne cherchait pas le « comment » mais le « pourquoi ». Il supposait que toutes les
menaces qu’il devait affronter étaient la punition d’une faute commise. Pour guérir, il fallait dons apaiser le
courroux des dieux. Les premiers médecins étaient des sorciers ou des prêtres. Les sacrifices d’animaux
s’inscrivaient dans la même conception.
L’ANTIQUITE
En Mésopotamie, en dépit d’un haut degré de culture régnait une conception astrologique et
cosmique des phénomènes vitaux. La maladie était considérée comme possession diabolique ou punition.
Elle était la conséquence d’une faute morale ou religieuse. Il existait alors deux types de médecine : l’une
pratiquée par un magicien à l’aide d’amulettes et d’incantations et l’autre qui était constituée de
traitements à base de plantes ou d’actes chirurgicaux sommaires. La médecine n’était donc pas séparée
de la religion. Le caducée représente un serpent enroulé autour d’un bâton surmonté d’un miroir ; il
symbolise la prudence, la ruse et la prévision. En Chine, en 2000 av J.C, l’homme est à la fois Yin et Yang,
deux énergies complémentaires indissociables ; il est en bonne santé s’il y a équilibre entre ces deux
forces. En Grèce, en 500 av J.C, naquit l’esprit rationnel. Pour la première fois, on se préoccupa plus du
comment que du pourquoi. Le raisonnement remplaça en partie l’imagination. L’esquisse d’un lien entre
l’esprit et le corps est reconnue comme possible. La maladie est conçue non comme un péché qui
corrompt la personnalité mais comme une déviation à la fois somatique et psychique. Platon considérait
quant à lui que le régime et l’épanouissement étaient les meilleures thérapeutiques. Démocrite fut le
précurseur de la physique moderne en concluant que tout obéit à des lois nécessaires et éternelles
(intuition de l’atome).
Hippocrate (600 av J.C) est appelé le père de la médecine : il en élimina les explications
surnaturelles. Son œuvre est immense, elle est doctrinale mais aussi pratique, elle s’appuie sur des faits et
non des hypothèses. Il fut le premier à proclamer que la médecine est un phénomène naturel et non pas
divin. Hippocrate s’attacha à l’étude de l’influence du milieu sur le patient. Il individualisa la maladie et la
conçut comme un phénomène comprenant une cause, une pathogénie, une évolution et par suite un
traitement adapté rationnel. Selon lui, la médecine est un savoir positif qui doit être distingué de la
mythologie et de la philosophie. De divination et culture du prodige, elle se mua en observation, recherche
et analyse logique. Il formula également des principes de sagesse qui président toujours à la médecine
curative (« D’abord, ne jamais nuire ») et des règles d’hygiène. On lui doit aussi les préceptes de
déontologie inscrits dans le serment. Celui-ci fait état des devoirs du médecin envers le malade, envers ses
confrères et ses élèves et de réflexions philosophiques dont la plus célèbre est : « La vie est courte, l’art est
long, l’occasion est prompte à s’échapper, l’expérience trompeuse, le jugement difficile ». Dans le contexte
de l’époque, la légitimité de l’attitude rationnelle était difficile à établir. Il faut bien avouer que les succès
médicaux étaient minces. On continua à penser que le malade était victime de la colère des dieux.

En Egypte, en 300 av J.C, furent pratiquées les premières dissections sur l’homme. Le fait que le
corps humain soit un tout (notion chère à Hippocrate) fut oublié et une certaine spécialisation vit le jour
(gynécologues, occulistes …). Quant aux Romains, ils furent d’excellents hygiénistes mais de bien piètres
médecins. L’œuvre de Galien (200 av J.C) fut considérable ; il poursuivit celle d’Hippocrate, mais
observateur et penseur, il imprima à la science une tendance plus analytique, moins synthétique et moins
générale.
LE MOYEN - AGE
Au 4è siècle, la fin de l’Empire romain et sa division en empire d’Orient et d’Occident représente
une époque troublée, guère propice aux arts et aux sciences. La médecine de langue arabe connut son
apogée entre le 10è et le 12è siècle. Les principaux médecins furent Rhazès, Avicenne, Averrhoes et
Maimonide. Averrhoes fut le précurseur de la médecine expérimentale. Avec lui commence la médecine
scientifique et la diffusion en Europe de connaissances grecques. Les médecins de langue arabe ignoraient
l’anatomie et la physiologie car ils ne pouvaient ni disséquer, ni opérer, mais ils furent de grands praticiens
et de grands thérapeutes. Un des grands apports de la médecine arabe est certainement la conception de
l’hôpital, à la fois lieu de soins et d’enseignement, alors qu’à la même époque, en Europe, ils étaient des
asiles pour pauvres. En Occident, il n’y avait pas d’unité, les échanges intellectuels diminuaient, bridés par
l’Eglise car s’opposant aux idées révélées immuables, éternelles. Durant douze siècles, l’élan de la
médecine fut véritablement pétrifié. De plus, l’hygiène régressa : famines, épidémies …) On tomba dans
l’abstrait, la dissertation et la métaphysique.
LES TEMPS MODERNES
Une des caractéristiques du 16è siècle fut l’affirmation d’un esprit critique vis-à-vis de l’inconnu et
du prétendu connu. Artistes, savants et médecins remplacèrent les constructions de l’esprit et le
dogmatisme par l’observation des faits, l’empirisme, l’analyse. Par ailleurs, la diffusion des sciences fut
facilitée par l’existence d’une langue commune, le latin, et par l’invention de l’imprimerie. La physiologie se
trouva négligée face à l’anatomie, ce qui contribua à la stagnation de la médecine. Le 17è siècle fut non
seulement une grand siècle politique, artistique, littéraire, mais aussi scientifique. On s’interrogeait sur les
phénomènes et pour la première fois, on se préoccupait des mesures. Ainsi furent inventés le thermomètre
et le microscope. Grâce à ce dernier, M. Malpighi découvrit que les organismes vivants étaient constitués
de tissus, eux-mêmes constitués de cellules et ouvrit la voie à la bactériologie. Le 18è siècle fut appelé
« siècle des Lumières » car dans tous les domaines, on s’efforça de faire reculer les préjugés et
l’intolérance et de vulgariser le savoir (Montesquieu, Voltaire, Newton, Lamark …). Les méthodes de
raisonnement scientifique commencèrent à pénétrer dans la médecine. L’éducation, les réformes sociales,
les mesures d’hygiène et de prévention progressèrent. Un autre événement marquant fut la naissance de
la psychiatrie. L’obstétrique devint une spécialité médicale et les premières maternités furent crées.
La médecine moderne. On a assisté à trois modifications majeures : unification du doctorat en
médecine tant au niveau de l’enseignement que de la pratique, francisation grâce à laquelle le médecin et
son malade peuvent s’entretenir, et enfin, la laïcisation du domaine médical. En fait, l’évolution de la
médecine s’est faite par phases successives durant lesquelles des voies de recherche et de nouvelles
conceptions s’ajoutent aux précédentes et les corrigent sans les effacer. D’autre part, on s’intéressa à
l’étude de l’infiniment petit et la psychiatrie concentra ses efforts sur l’élaboration organique des troubles
psychiques. De plus, grâce à la découverte des rayons X au début du 20è siècle, et au perfectionnement
des techniques d’imagerie médicale, le corps du malade devint « transparent ». Il fut ainsi possible de
devancer les symptômes en découvrant une lésion. A partir de la physiologie se construisit la réflexion sur
la genèse des maladies : la pathogénie. Claude Bernard étudia entre autre le rôle du pancréas et
l’importance des nerfs vasomoteurs. Les causes de maladies restèrent longtemps inconnues. L’idée de
spontanéité morbide retarda le progrès. La notion de contagion ne s’imposa que très tard. On ignorait
l’existence des microbes. Pasteur insista sur les mesures d’hygiène (19è siècle) mais se heurta à
l’incrédulité de ses confrères. Puis, antisepsie, asepsie et anesthésie firent progresser la chirurgie à grands
pas. L’étude des maladies d’origine endogène remit en question deux principes des siècles précédents, à
savoir que les signes d’une maladie peuvent résulter d’un simple trouble fonctionnel (maladies génétiques,
carences …) et que l’unicité de chaque individu demande une attention particulière.
Aujourd’hui, à l’expérimentation au laboratoire et à l’examen clinique sont venues s’ajouter des
techniques d’exploration et de traitements. Notons aussi que la biologie cellulaire, la biologie moléculaire
et le génie génétique constituent des étapes vers la connaissance des processus fondamentaux de la vie :
reproduction, hérédité, psychisme. Les techniques de plus en plus perfectionnées du diagnostic et de la
thérapeutique ont bouleversé la pratique médicale et ont des conséquences sociales et économiques.

L’HISTOIRE DE L’EXAMEN CLINIQUE
L’ENTRETIEN AVEC LE PATIENT
Un corps humain est tout sauf neutre.
L’examen clinique est l’observation du patient sur sa personne ; il doit être entendu au sens large
comme un entretien entre deux personnes.
L’entretien permet au médecin de recueillir de nombreuses données : antécédents personnels et
familiaux, conditions d’existence, personnalité, socle socioculturel… Ainsi le médecin va apprendre ou
découvrir le motif apparent ou réel de l’entrevue, la nature et la source des plaintes, les attentes du
malade.
Des règles président à chaque entretien. Le médecin ne doit pas couper la parole au patient qui
pourrait alors omettre de mentionner un détail important. Parfois, le symptôme avoué en premier n’est
qu’un prétexte pour consulter. Le médecin en arrive parfois à découvrir l’essentiel, la cause cachée qui
permet de poser le bon diagnostic s’il considère le patient dans sa globalité.
L’examen clinique au sens strict du terme permet de constater la normalité ou l’anomalie. Il se doit
d’être rigoureux, méticuleux et complet. Cette exploration du corps va confirmer l’impression du début ou la
compléter. Pour bien examiner le patient, il faut qu’il soit dévêtu. Dans certains pays, selon la culture du
corps, il existe une résistance à se dévêtir.
LES FAIBLESSES DE LA MEDECINE ACTUELLE
La médecine est depuis longtemps et reste aujourd’hui encore à la limite du rationnel et de
l’irrationnel. La spécialisation excessive des domaines médicaux constitue peut être l’erreur majeure de la
médecine actuelle. On ne considère plus un organe mais une partie de cet organe. Or, plus on se
spécialise, plus on réduit le champ de son art et moins l’individu existe dans sa globalité. L’exercice
médical a toujours été grandement conditionné par l’état des connaissances. Or, actuellement, ces
connaissances évoluent très rapidement car de très nombreux domaines convergent vers la médecine.
D’HIPPOCRATE A LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Hippocrate, né au Vè siècle av. JC à l’époque de l’apogée grecque (siècle de Périclès) comprit qu’il
fallait examiner le patient attentivement et le questionner sur son environnement. Sans sous-évaluer la
dualité du corps et de l’esprit, il lança les prémisses d’une médecine éthique et scientifique en rompant
avec les pratiques magico-religieuses. Le serment qui porte aujourd’hui son nom pose les bases du secret
médical. On peut y voir la prohibition de l’euthanasie : « Je ne remettrai à personne du poison ».
Galien vécut au 2è siècle après JC. Comme Hippocrate, il chercha l’origine des maux. Il publia de
nombreux ouvrages. Il chercha à apporter un remède à chaque symptôme et développa pour cela de
nombreuses potions. Mais il se heurta au fait que chaque symptôme peut être la traduction de diverses
pathologies. Il faut comprendre la cause du symptôme avant de le traiter.
Le Moyen-âge marqua une période de reflux et de régression. Pendant mille ans, l’examen clinique
va disparaître. La cause en est la détention du pouvoir par les clercs et la non circulation des ouvrages de
Galien.
A la Renaissance, le retour au classicisme redonne de l’importance au corps. Celui-ci n’est plus
« interdit » mais valorisé. L’examen déshabillé redevient possible. Morgagni déniche clandestinement des
cadavres dans les cimetières, voyant en la connaissance de l’anatomie, la clef de la médecine. C’est
seulement au 18è siècle que la circulation sanguine est découverte et 19è siècle que les dissections sont
autorisées ! Or, que pouvait faire un médecin s’il ignorait l’existence même de la circulation sanguine et ne
maîtrisait pas l’anatomie ?
Puis, l’enseignement de la médecine se développa dans les facultés et auprès des patients.
Notons qu’aujourd’hui, les étudiants Allemands et Italiens font cinq ans d’études purement théoriques
avant d’entrer en contact avec les patients.
On doit la méthode anatomo-clinique à l’autorisation de disséquer les morts et à la mise en
relation des signes de la maladie lors du vivant du malade et les observations lors des dissections.
LA MEDECINE ACTUELLE (FIN DU XXè SIECLE)
La pénicilline fut introduite en France lors de la Seconde Guerre mondiale par les Américains. Cela
marque le début de l’utilisation des antibiotiques et des progrès microbiologiques.

Les techniques deviennent de plus en plus performantes, à tel point que l’examen clinique paraît
désuet La parole a ainsi progressivement été remplacée par l’image et les chiffres. Le malade se
sent »chosifié », ce qui est désagréable pour lui mais qui peut sembler plus confortable pour le médecin.
Le vocabulaire spécifique du médecin ne fait qu’accroître l’angoisse du malade. Un patient peut
avoir recours à une attitude de déni, à tel point qu’il en oublie le discours et les explications du médecin. Il
refoule ses appréhensions et il faut savoir détecter un tel comportement afin de mettre le patient en
confiance.
La médecine actuelle a oublié qu’elle est un art. Celui d’expliquer et de comprendre. Aucune
machine ne pourra jamais remplacer l’écoute, la compréhension et le regard, éléments primordiaux à toute
relation médecin-malade. Les patients de mieux en mieux informés n’acceptent plus les médecins trop
pressés. Pourtant, certaines spécialités techniciennes comme la radiologie peuvent se passer en partie de
la relation médecin-malade.
L’EXAMEN CLINIQUE A PROPREMENT PARLER
S’entretenir avec un patient, c’est prendre le temps de l’écouter. C’est s’asseoir à côté de lui et
l’inviter à parler. C’est tout écouter : l’histoire de sa maladie, ses craintes, ses peines, ses révoltes et ses
doutes avec une grande disponibilité d’esprit. C’est saisir le moment propice, se laisser guider par le
malade.
Il faut regarder le malade. On peut lire beaucoup sur le visage d’un patient ; le teint, la mimique, la
douleur, l’anxiété… Il faut se garder de porter tout jugement. C’est le regard, mieux que le visage qui nous
dira si le malade souffre.
Enfin, il faut palper, ausculter. Approcher le corps de l’autre a toujours été vécu comme une
menace. Néanmoins, les malades apprécient le contact avec le médecin pourvu qu’il soit pratiqué avec
délicatesse et équivoque. C’est souvent à l’occasion de ce contact direct que la mémoire se ravive et que le
malade peut livrer des faits d’importance majeure. Il importe d’explique au malade ce que l’on fait et
pourquoi on le fait. L’art, c’est en fait de trouver la bonne distance.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%