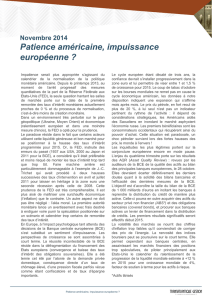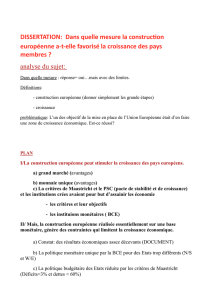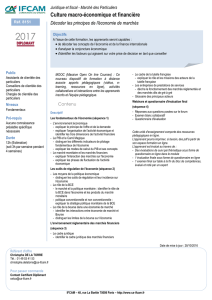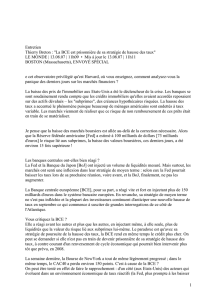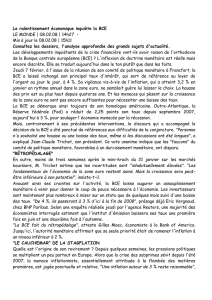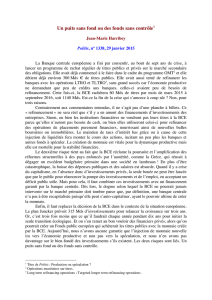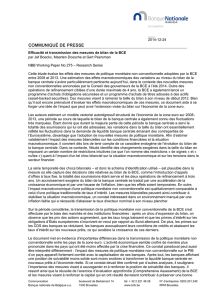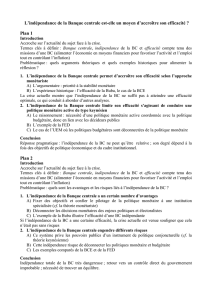"Les «sages de Francfort», amis ou ennemis?" dans Le

"Les «sages de Francfort», amis ou ennemis?" dans Le Soir (27 décembre 2001)
Légende: Dans cet article du quotidien belge Le Soir, on retrouve les arguments des défenseurs et des détracteurs de la
politique monétaire poursuivie par la Banque centrale européenne afin d'atteindre son objectif: maintenir la stabilité des
prix.
Source: Servaty, Philippe, Les « sages de Francfort », amis ou ennemis ?. Le Soir en ligne: Les dossiers - L'euro -
Archives. [EN LIGNE]. [Bruxelles]: Rossel et Cie SA, [10.01.2002]. Disponible sur
http://dossiers.lesoir.be/leuro/archives/A_0202BB.asp.
Copyright: (c) Rossel & Cie SA - LE SOIR, Phodoc, Brussel, 2008
Le présent article est reproduit avec l'autorisation l'Editeur, tous droits réservés. Toute utilisation ultérieure doit faire
l'objet d'une autorisation spécifique de la société de gestion Copiepresse [email protected]
URL: http://www.cvce.eu/obj/les_sages_de_francfort_amis_ou_ennemis_dans_le_soir_27_decembre_2001-fr-
b0f33c2b-d616-4cd9-82da-b5560affedd2.html
Date de dernière mise à jour: 20/12/2013
1 / 3 20/12/2013

La politique monétaire de la Banque centrale européenne est loin de faire l'unanimité
Les « sages de Francfort », amis ou ennemis ?
Pour les uns, la Banque centrale européenne (BCE) n'a pas assez soutenu la croissance économique du
Vieux Continent. Pour les autres, elle a bien fait de ne pas suivre les excès de sa consœur américaine.
Mais tous critiquent sa façon de communiquer.
PHILIPPE SERVATY
La Banque centrale européenne (BCE) a tout hérité de la Bundesbank. Aussi bien le tangible : son siège à
Francfort, sa mission (la stabilité des prix) et sa structure fédérale. Que l'immatériel : les préjugés visant son
attitude monétariste supposée « pure et dure ». Elle a hérité de tout, sauf de l'essentiel : sa réputation. Une
banque centrale en a encore davantage besoin que les jeunes filles du temps jadis. Sa seule existence lui
permet d'éloigner les importuns, en l'espèce les spéculateurs, ce qui limite les risques d'erreurs
d'interventions.
Cette absence de réputation est le défaut originel de la BCE. Depuis 1999, elle s'efforce de la construire face
à des marchés, dominés par une pensée anglo-saxonne perclue de préjugés à son égard. Un exercice d'autant
plus délicat que la nouvelle institution monétaire a été plongée d'emblée dans une conjoncture économique
virevoltante. Le 1er janvier 1999, les retombées de la crise financière russe faisaient encore craindre une
récession mondiale sévère. Douze mois plus tard, il n'était plus question que de surchauffe (le « plein
emploi » était annoncé sérieusement, rappelez-vous, pour bientôt).
Dans un tel brouillard conjoncturel, la BCE n'a pas voulu jouer au plus fin. Elle ne s'est fixé qu'un phare : sa
mission de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro. A vrai dire, elle n'avait guère le choix. Alors que
la Réserve fédérale américaine, la « Fed », poursuit deux objectifs concomitants – la stabilité des prix et la
croissance économique durable –, les « sages de Francfort » doivent d'abord s'assurer que la première est
atteinte avant de se préoccuper de la seconde.
[...]
A l'heure de tirer un premier bilan sur ses trois premières années opérationnelles, la BCE doit donc d'abord
être jugée à cette aune inflationniste. Objectif atteint : la zone euro n'a connu de surchauffe des prix – une
expression un peu forcée pour parler de hausse à peine supérieure à 3 % – que par l'entremise de la flambée
du prix du pétrole, une donnée hors d'atteinte de la BCE.
Pour les critiques de l'équipe de Wim Duisenberg (président de la BCE), cette absence de menace
inflationniste devait d'autant plus l'inciter à veiller à soutenir la croissance en réduisant ses taux d'intérêts au
premier signe de faiblesse économique. De fait, la BCE n'a jamais su réagir « au quart de tour ». Cette
année, elle a attendu le mois de mai pour desserrer l'étau monétaire, alors que la Fed l'avait fait dès janvier,
aux premiers frimas conjoncturels. Aujourd'hui, le taux de référence monétaire européen est de 3,25 % alors
qu'outre-Atlantique, il a été abaissé à 1,75 %. Il est vrai que la chute de l'activité économique a été plus forte
aux Etats-Unis que dans la zone euro.
C'est ici qu'interviennent les avocats de la BCE. La politique de la Fed, qui colle à la conjoncture et à
l'évolution des marchés boursiers, a sans doute contribué, disent-ils, à ce que l'économie américaine joue aux
« montagnes russes » ces deux dernières années : l'envolée des cours boursiers, dont la chute a favorisé la
récession actuelle, n'a pas été jugulée par la Fed; et à présent, elle ferraille pour remettre l'économie
américaine sur les rails. De 1999 à aujourd'hui, les taux de la Fed sont tombés de 6,5 % à 1,75 %, un écart de
4,75 %, alors que la différence entre le plus haut (4,75 %) et le plus bas (2,5 %) du taux de référence
européen est, pendant ce laps de temps, moitié moindre (2,25 %). Preuve de la démarche moins agressive de
la BCE.
Pour l'OCDE, le club des pays riches, cette approche « soft » n'a pas été néfaste : La politique de la BCE a
2 / 3 20/12/2013

laissé toutes ses chances à la croissance; les conditions monétaires au sens large sont restées relativement
accommodantes.
Les partisans et les pourfendeurs de la BCE se rejoignent, en tout cas, sur ce point : Wim Duisenberg et ses
collègues expliquent mal leurs décisions. Un comble pour une institution qui, contrairement à la Fed,
accompagne le plus souvent ses communiqués d'une conférence de presse assez longue. Mais les banquiers
centraux européens doivent se rendre à l'évidence : ils n'excellent pas dans l'improvisation orale.
Ce déficit de communication mis à part, le procès instruit à charge de la BCE paraît donc pétri de mauvaise
foi. Surtout que, depuis quelques mois, l'Europe est la zone mondiale où l'économie a le mieux résisté à la
crise. Pas mal pour une région toujours accusée de sclérose économique.
Et si, ces trois dernières années, la croissance américaine reste en moyenne (largement) supérieure, il faut
l'attribuer davantage au manque d'intégration des marchés européens – une responsabilité du politique – qu'à
une supposée politique timorée de la BCE... Mais un banquier central aura toujours bon dos. Il l'a en général
large et rebondi.
Le Soir du jeudi 27 décembre 2001
© Rossel et Cie SA, Le Soir en ligne, Bruxelles, 2000
3 / 3 20/12/2013
1
/
3
100%