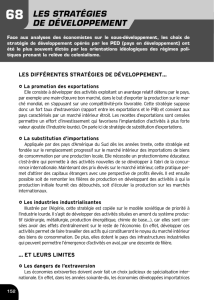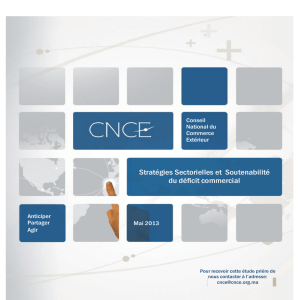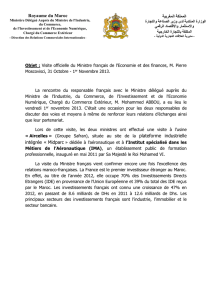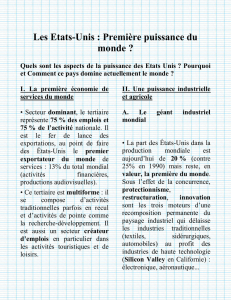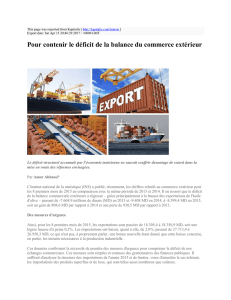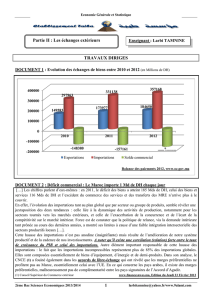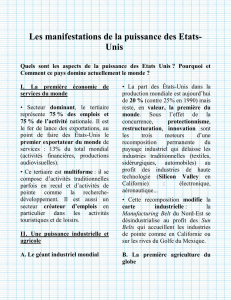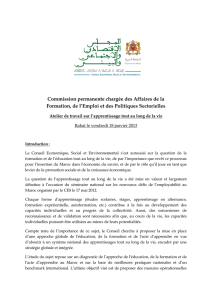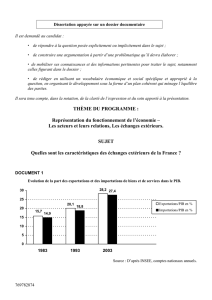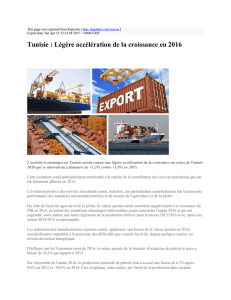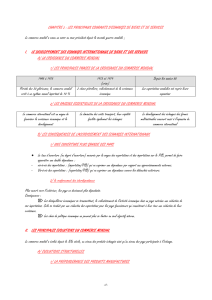Stratégies sectorielles et soutenabilité du déficit commercial

2
Synthèse
Un constat a constitué le point de départ de cette étude : le déficit
commercial du Maroc ne date pas d’aujourd’hui. Il est structurel depuis le
milieu des années 60. Il résulte de plusieurs facteurs endogènes et exogènes.
Pour les comprendre, à l’aune des dernières évolutions de l’économie
mondiale, il a fallu décrypter les mécanismes à l’œuvre de l’évolution du
commerce mondial en particulier le fort accroissement du commerce des biens
intermédiaires .Celui-ci a renouvelé l’approche traditionnelle de la spécialisation
internationale basée sur des processus de production « complets » localisés
dans un pays en fonction de ses coûts de production. La réorganisation des
processus de production sur une base globale s’est traduite par un
fractionnement des chaînes de valeurs et donc par une spécialisation des sites
par segments de valeur ajoutée
Le choix de l’ouverture du Maroc et la signature de nombreux accords de libre-
échange multilatéraux et bilatéraux, Nord -Sud et Sud -Sud , ont impliqué une
intégration du Maroc dans le marché mondial, plus par les importations que par
les exportations ; en effet, les importations des biens intermédiaires (206
Milliards de DHS en 2012) représentent plus de la moitié du total des
importations (390 Milliards de DHS)
Cette évolution suscite une lecture renouvelée du déficit commercial. Jusqu’au
diagnostic du CNCE établi en 2011, le curseur a été mis sur la question de
l’augmentation des exportations à travers le développement de l’offre
exportable. Cette appréciation reste, sans nul doute, valable mais elle n’est
plus suffisante pour éviter une analyse erronée du déficit commercial. Pour ce
faire, l’approche du CNCE s’est voulue séquentielle. La première phase a
concerné un diagnostic du commerce extérieur sur une longue période
d’observation 2001-2011. Le constat de la dépendance du système productif à
l’égard d’intrants importés, compressibles et incompressibles, productifs ou non
productifs, a soulevé au moins deux questions :

3
1. Comment promouvoir une diversification productive du tissu
entrepreneurial local afin de favoriser son intégration et partant une
augmentation de la valeur ajoutée locale ?
2. Les différents plans sectoriels sont-ils en mesure d’apporter une
réponse à cette question clé ?
Ce premier numéro de Théma apporte un éclairage quant à l’effet des plans
sectoriels sur les échanges extérieurs. Pour ce faire, un modèle quasi-comptable
de simulation d’impact des politiques économiques a été élaboré. De même, une
lecture des stratégies sectorielles à la lumière de leurs effets sur les échanges
extérieurs a été opérée avant de conduire des simulations de leurs impacts sur le
déficit commercial.
Il ressort de ces analyses quatre conclusions majeures:
- Les stratégies sectorielles contribueront certainement à contenir le
déficit commercial mais ne pourront pas le réduire à elles seules ;
- Les politiques de relance économique par la demande finale coûtent
cher à l’économie marocaine et si elles sont reconduites, elles risquent d’aboutir à
une situation insoutenable du déficit commercial ;
- La stratégie énergétique est une chance que le Maroc doit saisir et
renforcer en évitant notamment de substituer les importations des produits
pétroliers par des « intrants photovoltaïques » importés;
- L’amélioration de la compétitivité de l’offre marocaine est une voie
incontournable à la réduction du déficit commercial à des niveaux soutenables et
pourquoi pas à son élimination. Les politiques publiques visant cet objectif doivent
être mixées nécessairement à des politiques d’encouragement de l’intégration du
tissu économique. Elles doivent gérer également les effets des politiques de
relance par la demande qui ont un effet important sur les importations.

4
1. Structures productives, politiques économiques
et déficit commercial
L’appréciation du déficit du commerce extérieur marocain, réalisé par le CNCE en 2011, a
nécessité un diagnostic sur une longue période d’observation afin de cerner les évolutions
structurelles de ses deux composantes: exportations et importations. Cet examen a été
complété par une analyse comparative avec les pays concurrents.
Cet exercice a permis de dégager que la
fragilité de l’équilibre du commerce extérieur
résulte plus de la progression soutenue des
importations que des faibles performances à
l’exportation. En effet, le trend des exportations
marocaines de biens et services est
ascendant avec un rattrapage du rythme de
croissance des pays concurrents pour les
exportations de biens et même un dépassement
en termes des exportations des services.
Cependant, même si le rythme décennal
d’évolution des exportations (11%) est plus
important que celui des importations (8%), il
reste insuffisant pour réduire le déficit. Ce
constat a milité pour un examen plus
approfondi du comportement des importations.
L’analyse de cette variable a été opérée à un niveau
global et affinée d’une part, par sa ventilation en
importations compressibles et incompressibles et d’autre
part, en produits destinés à satisfaire la consommation
intermédiaire et la consommation finale.

5
1. Structures productives, politiques économiques
et déficit commercial
Au niveau global, l’examen a permis de constater un triplement des importations en une
décennie en passant de 133 Mrds DHS en 2001 à 399 Mrds DHS en 2011.
L’analyse de cette dynamique révèle un fort
contenu de la croissance économique en
importations. En effet, la tendance des
importations en volume emprunte la même
trajectoire ascendante que le PIB. Or le Maroc a
connu un regain de dynamisme de l’activité de
production au cours de la décennie en particulier
au cours de la période 2005-2010 avec,
notamment, un fort investissement dans les
infrastructures et la mise en œuvre des
stratégies sectorielles. Ces programmes,
conjugués aux politiques de relance de la
demande intérieure, ont suscité des importations
plus que proportionnelles que la croissance
économique. Les estimations économétriques
ont établi une élasticité de la croissance des
importations par rapport au PIB de l’ordre de
1,5: quand le PIB augmente de 1%, les
importations augmentent de 1,5%.
L’analyse affinée des importations a dégagé une
dépendance de plus en plus marquée des processus
productifs d’intrants importés et induisent une
accélération de la pénétration du marché intérieur par les
produits étrangers. Elle a permis d’apprécier la
dépendance à l’égard des importations moyennant une
évaluation des importations incompressibles, lesquelles
représentent 85% des importations totales. Près des
trois quarts de ces importations concernent l’énergie, les
biens finis d’équipement et les demi-produits.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
1
/
67
100%