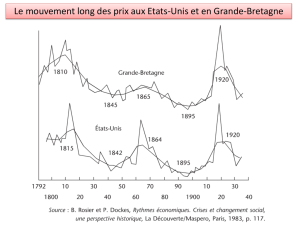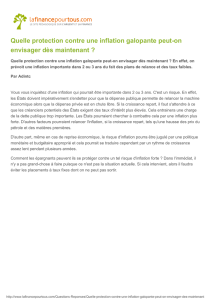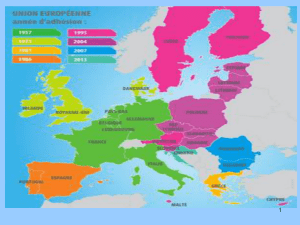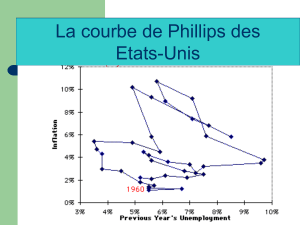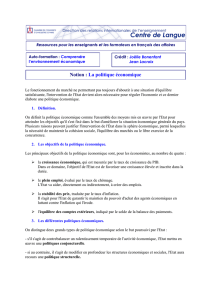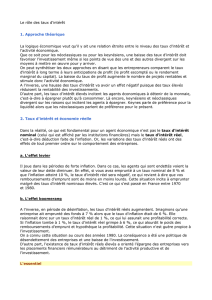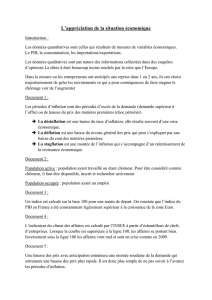L`i nflation ré éelle, l`inf flation pe rçue : où est le biai is

IA
C
s
c
o
l
’
(
n
p
t
e
I
C
E‐CTVIE2
0
Lete
r
ervices. Le
t
c
onsommatio
- Sile
t
- Sile
t
- Entr
e
- Aud
e
EnT
u
o
uverte.L’i
n
’
inflation po
r
nourriture,t
a
n
iveau de l’i
p
remièreme
n
e
mpsdedre
s
. Des
o
1. Les
o
L’infl
a
- Infla
t
direc
t
mon
t
cons
é
dem
a
mon
é
- Infla
t
que l
dem
a
l'éco
n
- La
s
méc
a
uneh
a
quia
u
spiral
- L’infl
a
résul
t
finis
o
- Inflat
aug
m
0
13©
r
meinflatio
n
t
aux d'inflati
o
n(IPC).Diff
é
t
auxd'inflati
o
t
auxd’inflati
o
e
5et10%d
e
e
làde20%o
n
u
nisie,sidur
a
n
flationreflét
r
tesurles
p
a
bac,éducat
i
ndicateur a
g
n
t,àidentifie
s
serl’étatde
s
o
riginesau
o
riginesdel’
a
tionpeutêt
r
t
ioninduite
t
ement (ou
s
t
ant de mo
n
é
quence dir
e
a
nde et par
s
é
taireencirc
u
t
ioninduite
es producte
u
a
ndevacon
d
n
omie,oupl
u
s
piraleinfl
a
a
niquement,
e
a
ussedessal
a
u
gmentelesc
o
e.
a
tionimport
é
t
entdel'aug
m
o
udeprodui
t
ioninduite
p
m
ente. C'est
p
0
2
4
6
8
10
L’i
n
désigneune
o
n est géné
r
é
rentsniveau
o
nestinférie
o
nestde3à
4
e
hausse(ave
n
parled’Infl
a
Evolution
d
a
ntl’année2
éeparl’IPC
t
p
roduits et
i
on)celui‐ci
p
g
régéquia
r les différe
n
s
lieuxdel’in
xrégulatio
inflation
r
eexpliquée
p
parunexc
è
s
uffisammen
n
naie nouvel
e
cte du gon
f
s
uite des pri
x
u
lation.
parladem
a
u
rs ne peuv
e
d
uireàl'aug
m
u
sspécifique
m
a
tionniste:
e
tsionveut
c
a
iresalasuite
o
utsdeprodu
c
é
e:Onditq
u
m
entationd
e
t
sfinis.Cette
p
arlescoûts
p
ar exemple
1990
1991
1992
1993
1994
nflationr
é
augmentati
o
r
alement me
s
xd'inflation
urà2%,On
p
4
%paran,l’
I
cdespointe
s
a
tiongalopa
n
d
utauxd’infl
a
012,ilaété
f
t
raduitmall’
i
services uti
l
p
erçoitdefa
ç
affiché en
n
ts facteurs
flationenTu
ns«possi
b
p
arplusieursf
a
è
sdemasse
m
t)àinjecter
le; Dans c
e
f
lement mo
n
x
. L'inflation
a
nde:
Sila
d
e
nt ou ne ve
u
m
entationde
m
entunmar
c
Si le prix
c
orrigerlasi
t
desrevendic
a
c
tionpourles
e
u
'ilyainflati
o
e
sprixdesbi
e
augmentati
o
:L'inflation
lecasquan
d
1994
1995
1996
1997
1998
é
elle,l’in
f
L’inflati
o
o
ndurable,g
s
uré par le
t
sontgénéral
e
p
arledeStab
I
nflationest
q
s
à20%),l’In
f
n
teoud’hyp
e
a
tionenTun
i
Source:IN
S
f
aitétatdep
r
i
nflationress
l
isés quotidi
e
ç
ontrèsnett
e
mars 2013
qui peuven
t
nisie.
b
les»del'i
n
a
cteurs:
m
onétaire:
dans le cir
c
e
tte situatio
n
n
étaire se m
apparait co
m
d
emanded'u
n
u
lent augme
n
sprix.Le p
h
c
héouunpr
o
d'un éléme
t
uationnefa
i
a
tionsdessala
r
e
ntreprisesq
u
o
nimportée
e
nsimporté
s
o
ndesprixp
o
est dite ind
u
d
les salaire
s
1999
2000
2001
2002
f
lationpe
o
nréelle,l’i
n
énérale,eta
u
t
aux de croi
s
e
mentavanc
é
ilitédesprix
q
ualifiéede
r
f
lationestdi
t
e
rinflation.
sieentre19
9
S
r
essioninfla
entieparles
e
nnement o
u
e
sonimpact
a
plus que 6
t
êtreàl’ori
g
n
flation
Dufaitducr
é
c
uit économi
n
, en l'abse
n
anifeste sou
m
meundé
s
n
produitou
n
ter immédi
a
h
énomèned'
e
o
duit.
nt essentiel
i
tqu’empire
r
r
iesquineve
u
u
iréagissente
n
lorsquel'on
v
s
,qu'ils'agiss
o
uvantêtrel
i
u
ite par les
c
s
augmenten
t
2003
2004
2005
2006
2007
rçue:où
n
flationper
ç
u
to‐entreten
u
s
sance annu
e
é
sparleséc
o
;
r
ampante;
t
eouverte;
9
0‐2013(%)
tionniste,au
j
ménagesau
u
fréquemm
a
lorsqu’elle
%. Nous c
h
g
ine de l’infl
a
é
dit,sil'acti
v
que des bie
n
n
ce de créa
t
s la forme
d
s
ordre attri
b
d'unservic
e
a
tement la
p
e
xcès pouva
n
augmente,
r
:
lahaussed
e
u
lentpasperd
n
augmentant
v
eutsoulign
e
edematière
s
i
éeàungliss
e
c
oûtssiuné
l
t
plusviteq
2007
2008
2009
2010
2011
estlebia
i
ç
ue:oùestl
e
u
edesprixd
e
l de l’Indic
e
o
nomistes:
j
ourd’huil’in
quotidien.E
n
ent par le
c
serafaiblem
e
h
erchons d
a
a
tion et dan
s
v
itéfinancée
n
s nouveaux
t
ion de rich
e
d
'une augm
e
b
uéàl'enflu
r
e
essentiele
x
p
roduction, a
l
n
tconcerner
tous les
a
e
sprixcondui
t
d
redeleurspo
lesprix,etali
e
rquelesha
s
premières,
e
mentduta
u
lément esse
n
ue la produ
c
2012
2013
i
s?
e
biais?
esbiensetd
e
e
desprixà
flationestdi
n
effet,lorsq
u
c
onsommate
u
e
nttraduite
a
a
nscetteno
s
undeuxiè
m
n
econduitp
a
àhauteur
d
e
sse réelle,
e
ntation de
r
e de la mas
s
x
cèdel'offre,
l
ors l'excès
d
l'ensemble
d
a
utres suive
n
t
généralemen
t
uvoird’achat
m
ententainsi
ussesdeco
û
debiensse
m
u
xdechange.
n
tiel des co
û
c
tivité(leco
û
e
s
la
te
u
e
u
r
a
u
te
m
e
a
s
d
u
la
la
s
e
et
d
e
d
e
n
t
t
a
ce
la
û
ts
m
i‐
û
ts
û
t

IACE‐CTVIE2013© L’inflationréelle,l’inflationperçue:oùestlebiais?
salarialparunitéproduiteaugmente)oulorsquelesmatièrespremières ou l'énergie de base se
renchérissentcommependantlespremiersetdeuxièmeschocspétroliers.Lahaussedescoûtsserépercute
alorsdanslesprixderevient,puisdanslesprixdevente,d'oùunehaussedesprix.Onparleainsid'«effet
desecondtourdel'inflation».
- Lapaniquemonétaire:Lamanipulationdelamonnaieatoujoursétébaséesurlaconfianceensavaleur;
Si, à tort ou à raison, les agents économiques se persuadent quelamonnaievaperdredesavaleur,ils
voudrontl'échangercontredesbiens(provoquantuneinflationparlademande)oudesdevisesétrangères
(chutesurlemarchédeschanges,hausseduprixdesproduitsimportés,inflationimportée),cequinourrira
l'inflation,valideral'anticipationinflationnisteetlarenforcera.
- Inflationinduitepardesélémentsstructurels:L'inflationpeutêtreinduiteparunétatdonnédelastructure
desmarchés,cequisignifiequelahaussedesprixs'expliqueparlesconditionsdeformationdesprixsurles
marchésoudanslessecteurséconomiques,(monopoles,…).
- Lesanticipations:Lorsdesnégociationscontractuelles,lesagentséconomiquesessayerontd’indexerleurs
revendications sur les prix de différents biens et services et vont ainsi diffuser de façon mécanique le
phénomène de hausse des prix et le transférer en direction d'activités ou de secteurs initialement non
concernésparlesnégociationsetlavariationdeprix.
- Lanaturedesmarchés:Lesenseignementsmicroéconomiqueslaissentmontrerqu’ensituationdeconcurrence
pureetparfaiteleconsommateurachètegénéralementplusdequantitéàdesprixrelativementinferieurspar
rapportàunesituationdeconcurrenceoligopolistiqueoùilachètemoinsetàdesprixplusélevés(pertede
surplusduconsommateur).
2. Régulationspossibledel’inflation
Lathéorieéconomiquedisposedeplusieursinstrumentspourinfluersurl'inflation,ousinécessairemettre
finàunehyperinflation.Pourunemeilleureefficacité,ilfautcoordonnercespolitiques.
- Lapolitiquemonétaire:Lapolitiquemonétaireestdenosjoursleprincipaloutilderégulation de
l'inflation. Pour éviter la déflation, les autorités monétaires (banques centrales en général) optent en
généralpouruneinflationfaiblemaisnonnulle;pouraugmenterlamassemonétaireetdoncleniveau
d'inflation,ilsinjecterontdesliquiditéspardifférentesméthodes(plancheàbillet,achatdetitre,baissedu
tauxdirecteur);pour fairebaisserl'inflationelles agironten sens inverse. Une hausse du taux directeur
entraineunralentissementdelademandecarl’investissementetlaconsommationdiminuentetdoncles
prix augmentent; inversement la baisse dutaux directeur favorise l'endettement, stimule la demande et
peutconduireàlahaussedel'inflation.Enrégimedelibéralisationfinancièreunehaussedutauxdirecteur
destinéeàfreineruneéconomieensurchauffepeutgénérerdeseffetsperversquicontrarientlesobjectifs
visés. La hausse des taux d'intérêt attire les capitaux étrangers à la recherche de meilleurs rendements.
Cetteabondancedecapitauxcontrarielefreinagesouhaité.Inversementunebaissedestauxdirecteursest
susceptibledefairefuirlescapitauxlocauxouétrangersetlimiterlescapacitésdecréditsquel'onvoulait
favoriser.Ils'agitlàd'undescasduthéorèmed'impossibilitéévoquéparMichelAglietta.Onnepeutavoirà
lafoisunsystèmenationaldecontrôleprudentiel,unmarchémondial de capitaux et une inflation
contrôlée.
Comme mesures de régulations en Tunisie, on peut citer la décision de la BCT de relever son taux d’intérêt
directeur à 3,16 % fin août 2012 ; ce taux été maintenu inchangé jusqu'à mars 2013. Constatantlespressions
inflationnistes menaçant la compétitivité de l’économie le Conseil d’Administration de la BCT réuni le 27
mars2013adécidédereleverletauxd’intérêtdirecteurdelaBanquecentralede25pointsdebasepourle
porterà4%etaaussiprislesdécisionssuivantes:
ledéplafonnementdutauxderémunérationdesdépôtsàterme;
lerelèvementdutauxminimumderémunérationdel’épargne;
larevuedesmesuresprisesenoctobre2012portantsurlarationalisationdescréditsàla
consommation(laréductiondutauxdelaréserveobligatoire).
- Lapolitiquebudgétaireetfiscale: Il s'agit d'une politique visant à exacerber les forces naturelles du
marché.L’Etatintervientenstimulantlaproduction(quandcelaestpossible)danslessecteursoùlesprix
augmentent(onparledepolitiquedel'offre),ilestparfoispossibled'augmenterl'offre,etlimiterainsila
haussedesprix;Inversement,l’Etatintervientenrationnantencoreplusfort(parunefiscalitéaugmentée)
ladisponibilitédeproduitsdontiln'estpaspossibled'augmenterl'offre(exemple:produitspétroliers).
A ce niveau et pour contenir les tensions inflationnistes, l’Etat tunisien est intervenu à maintes reprises
pourinonderlemarché(importationdelait,moutonsdel’Aïd,….)

IACE‐CTVIE2013© L’inflationréelle,l’inflationperçue:oùestlebiais?
- Lapolitiquedechange:Lapolitiquedechangeconsisteenunedévaluation(dépréciation) ou
réévaluation(appréciation)de la monnaienationaleparrapportaunedeviseouunpanierdedevise.la
politiquedechangepeutavoirdeseffetssurl'inflation,parlebiaisdelabalancecommerciale.Eneffet,en
jouantsurlavaleurdeladevisenationale,l'étatpeutfavoriserl'exportation(endépréciantsamonnaie)ou
rendre l'importation moins coûteuse (en appréciant sa monnaie). Cette dernière solution peut être utile
pour diminuer l'inflation, surtout lorsqu'il s'agit d'inflationimportée.Apprécierlamonnaiepeutaussi,
théoriquement,agirsurlademandeenfreinantcelle‐ci,quipeutentraînerunediminutiondesprix(etdonc
unebaissedel'inflation)sil'inflationestcauséeparunedemandetropforte.
Dans ce cadre on peutciter les tristes records enregistrés par le dinar tunisien ces derniers mois qui ne
cesse de se déprécier par rapport à l’euro et au dollar américain, nos principales monnaies d’échanges.
SelonlecoursdedevisescommuniquéparlaBanquecentraledeTunisie,l’euroestéchangéà2,13dinars,
alorsqueledollarestéchangéà1,62dinar.Ilyadeuxans,àladatedu9mai2011,l’eurovalait1,97dinar,
alorsqueledollarvalait1,37dinar.Avantlarévolution,etàladatedu10mai2010,l’euroétaità1,88dinar.
Cette dépréciation qui été accompagnée par une baisse des recettes en devises, des restrictions à
l’importation,delapertedelavaleurdel’investissementetdel’aggravationdel’inflation.
- Lecontrôledesprix,dessalaires:Lecontrôledesprixetdessalairesestunemesurequiauneportée
plusvasteetplusgénéralequelecontrôledel'inflation,maisilaaussiétéutiliséspécifiquementpour
combattrel'inflation.Uncontrôledesprixetdessalairesaplusdechancedefonctionners'ilestacceptépar
lasociété(notablementlessyndicats),maiscelaresteunemesureimpopulaire,difficileàmettreenœuvre.
- Changementdemonnaie:Unchangementcompletdemonnaiepeutêtreunesolutionàlaforteinflation.
Lanouvellemonnaiedoitavoirunevaleurstable,cequ'onpeutréaliserenl'adossantàdesactifsréelset
reconnus.
A ce niveau on peut citer la décision de la Banque centrale de Tunisie de retirer les billets de 30 dinars
(1997), et de remplacer ceux de 20 dinars (1992) et de 50 dinars (2008). La Banque Centrale est‐elle
persuadéequ’ilyadescitoyensquicachentleursfortunesdansousousleurmatelas.Etellepenserait,
grâceàcetteactionduchangementdesanciensbilletsdefaireressortirces«fortunes»?
II. Etatdeslieuxdel’inflationenTunisie
1. Leconstatdel’inflation
Leschiffresofficielspubliésparl’INSrévèlentuntauxd’inflationdépassant6%début2013,cetauxaété
calculé sur la base d’un panier de biens de consommation, majoritairementcomposédeproduits subventionnés
dontlesprixn’évoluentpasd’uneannéeàuneautre.Lahaussedutauxd’inflationobservéerésulte,principalement,
d’uneaugmentationdesprixdelacatégorie‘’alimentationetboissons’’,fortementpondéré,dontletauxdépasse8
%.Cetauxestdûessentiellementàlahaussedesprixdesviandesde13.3%,deshuilesalimentairesde12.7%,des
légumes de 11.2%, des fruits de 11.2%, du lait et dérivés et œufs de 9.3%, et les boisons de 5.5%. Les groupes
transportetlogementreprésentantsuccessivement11.329%et14.0365dupanierduconsommateurexpliquenten
partiel’évolutionduniveaugénéraldesprixsuiteauxaugmentationsde5.5%desprixducarburantet4%desprix
dulogementetdel’électricité.
Tauxd’inflation(base100en2005)
Pondération 2012/11 2013/12
Indicegénéral 100 5.06 6.04
Alimentationetboisson 32.707 6.54 8.66
Habillement 9.217 6.27 7.70
Logement,eau,électricité 14.036 4.75 3.02
Meubles 7.755 5.16 6.19
Sante 6.291 1.84 1.72
Transport 11.329 1.72 3.68
Télécommunication 3.472 0.11 0.53
Loisirs 4.651 6.18 6.24
enseignement 2.331 9.69 1.84
Restaurantethôtels 4.229 5.98 9.33
Biensetservicesdivers 3.982 3.49 4.78
Source:INS
2. Lescauses«probables»del’inflationenTunisie
Lahaussedutauxd’inflations’expliqueparlamultiplicationdesréseauxdecontrebande,ledéséquilibre
entrel’offreetlademande,l’absencedecontrôleéconomiqueetparl’inflationimportée.
- Coûtdeproduction:Selonlanoteconjoncturelledel’INSpubliéeenavril2013,latendancedesprixàla
production a connu en mars 2013 un décrochage par rapport à la tendancedesprixàl’importation;ce
décrochage est le résultat de l’augmentation des coûts de production fin 2012 (dépenses d’énergie,

IACE‐CTVIE2013© L’inflationréelle,l’inflationperçue:oùestlebiais?
salaires….). Les entreprises tunisiennes ont dès lors mécaniquement répercuté cette hausse des coûts de
productionsurleprixdeventedenombreuxproduits.
- Facteurmonétaire:Ladépréciationdudinarvis‐à‐visdudollaretdel’Euro‐Leseuilsymboliquededeux
dinarspouruneuroaétéatteintvoilailyauneannée,etletauxdechangedudinarparrapportaudollarse
retrouveàsonplusforttauxhistoriques’élevantà1,6dinarspourundollar‐agénérémécaniquementde
l’inflationquis’estaccélérésuiteàlabaissedenosréservesdechange.Deplus,cettedépréciationdutaux
dechangeaffectefortementlafactureénergétiqueetalimentairequirisquedepesersurlebudgetdel’état
(directementparlesdépensesdefonctionnementetindirectementauxtraversdelacaissecompensation).
- Lacontrebande:Lacontrebandeetl’exportationillégaleauxfrontièrestuniso‐libyenneontentrainédes
pénuries de plusieurs produits alimentairesdebase.Bienqu’onassisteàunretouraucalmeenLibye,
certainstunisiensétaientenclinàvendredesproduitsauxlibyensàdesprixsupérieursaumarchétirant
les prix vers le haut au niveau national. Ces exportations illégales, pour la plupart des produits
subventionnés,étaienttoujoursévoquéescommemoteurpotentieldel’inflationdepuis2012.
- L’inflationimportée:Cetteinflationestcauséeprincipalementparlahaussedesprixdesbiensimportésqui
serépercuteassezsouventsurlesprixintérieurs.Siunbienimportéjoueunrôlefondamentaldansla
productionlocale,lahaussedesonprixpeutavoirunimpactinflationniste.Demêmeladépréciationdela
monnaiefaitaugmenterleprixdesbiensimportés.
3. Versunerégulationeffectivedel’inflationenTunisie
Concrètement,enTunisie,plusieursmesuresderégulationontétémisesenplace1:
- L’augmentationdelaproductiondesproduitsagricolessensiblesetlagarantiedel’approvisionnementdu
marchéàtraverslaproductionnationaleetl’importationdeproduitsétrangerssicelaestnécessaire.
- Lamiseenplaced’unprogrammedeformationdestocksd’ajustementautitredel’année2013 pourdes
produitscommelespommesdeterre,lelait,lesviandesrougesetblanches
- L’importationde9.000têtesdevachesfécondesetlamiseenplaced’unprogrammed’encouragementpour
leséleveurs.
- Lerenforcementdesréseauxd’espacedevente"duconsommateurauproducteur".
- Une meilleure orientation des subventions de consommation au bénéficedesfamillesenproposantdes
emballagesspéciauxpourcertainsproduitscommelelait,lesucre,l’huiledesoja,lestomatesconcentrées
etlesbouteillesdegaz.
- La fixation de prix plafond de certains produits de consommation (légumes, fruits, viandes, produits
ménagers,produitsagroalimentaires).
- Ledéplafonnementdutauxderémunérationdesdépôtsàterme;
- Lerelèvementdutauxminimumderémunérationdel’épargne;
- Larevuedesmesuresprisesenoctobre2012portantsurlarationalisationdescréditsàlaconsommation
(laréductiondutauxdelaréserveobligatoire).
Malgré ces mesures, la perception de l’inflation est une vérité et la poursuite des tensions inflationnistes
mesuréesparl’IPCresteprobablepourlesprochainsmois.Ilsemblequeleproblèmen’estpasunproblèmede
régulationetdeciblagemaisplutôtunproblèmedemesure:l’IPC semble ne pas refléter la réalité et l’inflation.
4. LeçonsetRecommandations
Nousvenonsdepassercidessusuncertainnombredefacteurscontribuantàexpliquerl’inflationobservée
enTunisielespremiersmoisde2013.Toutefois,cesfacteursliésengrandepartieauxévènementsquiontsecouéle
paysnepermettentpasdeconfirmeroud’infirmersicetteinflationobservéeestdurableetpersistante.L’inflationa
unimpactnonseulementsurlepanierdelaménagèremaisaussisurl’entreprise:Elleaffaiblilesentreprisesenleur
donnant l'illusion de réaliser des profits, elle fausse l'estimation de leur valeur patrimoniale et elle nourri
l’instabilitésociale.Afindecerneretciblerl’inflation,ilestsouhaitabledeprendreenconsidérationlacomposition
del’IPCetleschangementscomportementauxdesconsommateurs.
- Leslimitesdel’IPC:L'indicedesprixàlaconsommationmesurel'évolutionduniveaumoyendesprixdes
biensetservicesconsommésparlesménages,pondérésparleurpartdanslaconsommationmoyennedes
ménages.Commeindicateurdemesuredel’inflation,l’IPCprésenteleslimitessuivantes:
C’estuninstrumentquisefondesurlepanierduconsommateurmoyen.Enfaisantfréquemment
desachats,leconsommateurtunisienaunebonneconnaissancedesprixets’aperçoitrapidement
1Conseildesministresdu22mars2013etCommuniquéduconseild'administrationdelaB.C.Tréunile27mars2013.

IACE‐CTVIE2013© L’inflationréelle,l’inflationperçue:oùestlebiais?
del’augmentationducoûtdelavie.Sonpassagehebdomadaireouquasiquotidienaumarchélui
permet de ressentir directement et immédiatement la hausse des prix des denrées alimentaires,
unehaussequin’apparaitpasclairementdansl’IPC.Ils’ensuitquelorsquel’inflationportesurles
produits et services utilisés quotidiennement ou fréquemment par le consommateur tels que
nourriture, tabac, éducation, celui‐ci perçoitde façon très nette leur impact alors qu’elles seront
faiblementvisiblesauseindel’indicateuragrégé.
Laconstructiondel'IPCneprend pas en considération l'évolution de la qualité des biens, le
changementdesgoûtsdesconsommateursoulesfluctuationsducoursdechange.
l'apparition d'un nouveau produit ou service ou d'une nouveautédansunancienproduit
(innovation)n’apparaitpasdansl’indice.
lechangementdanslarépartitionintertemporelledesachatsdesconsommateursn’estpasprisen
considération par l’IPC: la hausse duprix relatif peutconduireàunreportdelaconsommation
présente(substitutiondubienenquestionpard'autresbiens).
- Versunerévisiondel’IPC: Parallèlement aux mesures prises par les autorités commerciales et
sécuritairesenvuederenforcerlecontrôleàlafoisdesprixetauxfrontièresetafindemieuxappréhender
l’impactdel’inflationsurlasociétéilestnécessaired’enaffinersamesure.Uneffortdecommunicationdoit
êtrefaitautourdel’inflationdupanierdelaménagère.UnIPCfondésurlepanierduconsommateurmoyen
reflètemall’inflationressentieparlapopulation.Vulafortedisparitérégionaleetlesinégalitéssociales;
onnepeutpasparlerd’unindiced’inflation(IPC)maisdeplusieurs indices d’inflation qui tiendraient
comptedecesdisparités.Cesdifférentsindicesdesprixàlaconsommationpourraientinclure:
unindicedeprixpourlesménagespauvres,
unindicedeprixparrégion
unindicedupanierdelaménagère.
- Versunepriseenconsidérationdeshabitudesdesconsommateurs:Lesmutationsquesubissentles
habitudes de consommation ainsi que l’apparition de nouveaux produits et services ne sont pas pris en
considérationaveclaméthodeactuelledecalculdel’IPC;Cetteméthodenepermetpasdecomprendreen
particulier si ce sont les prix qui influencent les choix de consommation, ou si ce sont les choix de
consommationquiinfluencentlesprix.
- Pourunindicedecoûtdelavie:Lestunisiensressententdeplusenplusledécalageentrel’évolution
desprixannoncésetlaréalité.Ilestplusquejamaisnécessaired’imposerlamiseenplaced’unvéritable
indiceducoûtdelavie. Lecoûtdelavieestuneévaluationducoûtmoyendesdépensesdeconsommation
desménages.Lesindicesutiliséspourmesurerl’inflationnepermettentpasdemesurerl’évolutionducoût
delavie.Pourmesurerl’évolutionducoûtdelavie,ilfautinclurelavariationdesquantitésconsommées.
- Lelancementd’unsimulateurd’inflation:Afin d'illustrer l'importance de l'effet de la composition en
biens et services du panier moyen pour chaque consommateur prisindividuellement,l’IACElancera‐à
l’instardelaFrance‐unsimulateurd'inflationpersonnalisésursonsiteofficiel.Lesimulateurpermetà
chacunenfonctiondesapropreconsommationd'évaluerl'inflationqu'ilsubit.Ilseraquestionàceniveau
pourchaquepersonnephysiqueoumoraled’intervenirsurlaplateformevirtuelledel’IACE–toutechose
étantégaleparailleurs‐pouraffectersonrevenuselonlapartdedépenseeffectivequ’ilconsacreàchaque
groupe de produit voire à chaque produit et non conformément à la pondération du ‘’consommateur
moyen’’avancéeparl’INS.
1
/
5
100%