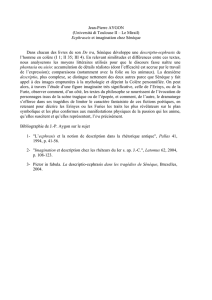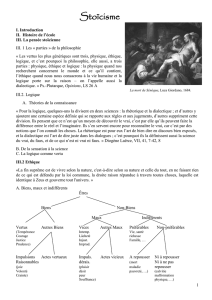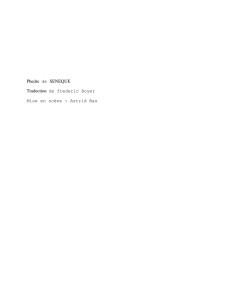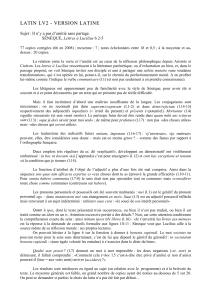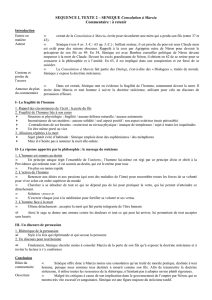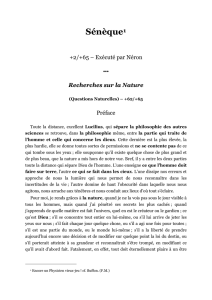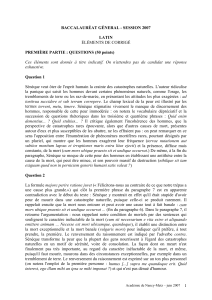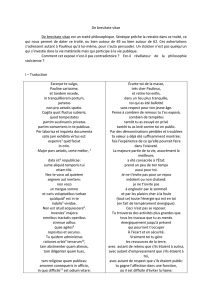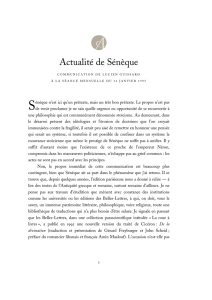sénèque et saint-paul - L`Histoire antique des pays et des hommes

SÉNÈQUE ET SAINT-PAUL
ÉTUDE SUR LES RAPPORTS SUPPOSÉS ENTRE LE
PHILOSOPHE ET L'APÔTRE
PAR CHARLES AUBERTIN
Maître de Conférences à l'École normale supérieure.
PARIS - LIBRAIRIE ACADÉMIQUE - 1872.

AVERTISSEMENT.
INTRODUCTION. — Rapports supposés entre Sénèque et saint Paul ; sens
philosophique de cette tradition.
PREMIÈRE PARTIE. — Biographie comparée de saint Paul et de
Sénèque.
CHAPITRE I. — Jeunesse et éducation de saint Paul. - Ses prédications en Orient et
en Grèce.
CHAPITRE II. — Saint Paul à Rome. - État de l'Église romaine. - Les chrétiens de la
maison impériale.
CHAPITRE III. — La Philosophie au temps de Néron. Les maîtres de Sénèque.
CHAPITRE IV. — Vie de Sénèque. Ses voyages en Orient, sa faveur, sa disgrâce, sa
mort. - Ses relations prétendues avec les chrétiens.
DEUXIÈME PARTIE. — Des écrits de Sénèque et des épîtres de saint
Paul.
CHAPITRE I. — Chronologie comparée des écrits de Sénèque et des livres saints.
CHAPITRE II. — Métaphysique chrétienne de Sénèque. Notion d'un Dieu créateur.
CHAPITRE III. — De la Providence.
CHAPITRE IV. — L'Amour de Dieu. Le Culte chi à Dieu.
CHAPITRE V. — Théologie de Sénèque. La Foi et l'Espérance. - La Trinité.
L'Homme-Dieu.
CHAPITRE VI. — La Grâce et les Sacrements. - La Confession. Le Péché originel.
CHAPITRE VII. — Enfer, Purgatoire et Paradis. - Immortalité et spiritualité de
l'âme.
CHAPITRE VIII. — Fin du monde. Jugement dernier. Résurrection.
CHAPITRE IX. — Morale chrétienne de Sénèque.
CHAPITRE X. — L'Esclavage.
CHAPITRE XI. — Égalité, fraternité, charité.
CHAPITRE XII. — Spiritualisme et mysticisme, etc. - Passage interpolé de Dion
Cassius.

TROISIÈME PARTIE. — Correspondance apocryphe de Sénèque et
de saint Paul.
CHAPITRE I. — Témoignages de saint Jérôme et de saint Augustin.
CHAPITRE II. — Du silence des autres Pères sur cette question. - Une inscription du
IIIe siècle.
CHAPITRE III. — Opinion du moyen âge sur le christianisme de Sénèque.
CHAPITRE IV. — La Critique moderne et la légende de Sénèque et de saint Paul.
CHAPITRE V. — Lettres de Sénèque et de saint Paul. - Les Apocryphes des premiers
siècles. - Conclusion.
APPENDICE. — Traduction de la correspondance.

AVERTISSEMENT.
Il y a quelques années, à une époque où ce genre d'études critiques n'avait pas
encore reçu en France les développements dont nous sommes témoins, et
n'excitait pas aussi vivement qu'aujourd'hui l'attention du public, j'entrepris
d'examiner la question des rapports supposés entre Sénèque et saint Paul.
D'importants travaux venaient de ranimer, peu de temps auparavant, de 1850 à
1854, cette ancienne controverse ; la croyance au christianisme de Sénèque,
favorisée par l'esprit qui régnait alors et réhabilitée par une érudition spécieuse,
avait repris vigueur. Le monde savant lui-même, que cet air de science prévenait
et séduisait, avait adouci, à l'égard de la légende transformée, ses sévérités
habituelles ; il s'était fait sur ce point une tentative de rapprochement entre
l'esprit de la critique moderne et l'imagination du moyen âge ; cela symbolisait,
aux yeux de certaines personnes, un essai et comme une velléité de conversion.
C'est à ce moment que l'idée me vint d'entrer dans l'examen de cette tradition et
d'aller au fond du débat. Je n'eus aucune peine à me convaincre que ces
apparences d'érudition et ce luxe d'arguments tout neufs n'étaient qu'une
illusion. De ces recherches je tirai la matière d'une thèse que je présentai à la
Faculté des lettres de Paris. Le sentiment des hommes éminents de cette
Faculté, ainsi que les dispositions présentes du public, m'ont déterminé à publier
aujourd'hui ce travail sous une forme nouvelle et plus ample. Je l'ai, en effet,
dégagé de l'appareil de discussion, de l'abondance de citations que m'imposait la
méthode universitaire ; j'ai ajouté des développements nouveaux, j'ai remanié
les chapitres anciens ; l'ordre et le plan sont tout autres ; bref, de ce qui était
une thèse ou un mémoire, j'ai voulu faire un livre.
Qu'on me permette de placer dans son vrai jour la question qui est ici traitée et
d'en montrer, d'un mot, l'étendue et l'importance.
Il ne s'agit pas seulement de discuter une de ces légendes dont l'antiquité
chrétienne était si prodigue et le moyen âge si avide ; le vrai sujet est plus
sérieux et bien autrement vaste. Le point du débat est celui-ci : quand nous
rencontrons dans les philosophes anciens, particulièrement dans ceux du premier
siècle de notre ère, certaines maximes élevées, hardies, d'une apparence
chrétienne et d'une générosité toute moderne, sur les grands et éternels objets
des méditations humaines, sur Dieu, sur l'âme spirituelle et immortelle, sur la
liberté et l'égalité, sur le progrès et la fin suprême de la civilisation, faut-il croire
que la philosophie a tiré de son propre sein, de sa vigueur native et de sa
fécondité inspirée, ces nobles enseignements, ou bien qu'elle n'a été qu'un écho
des livres chrétiens ? C'est la question de l'incapacité ou de la puissance de la
raison qui est ici posée. Sénèque, disciple et héritier de la philosophie antique,
est ici le représentant de la raison libre ; sa cause est celle de l'indépendance et
de l'originalité de la pensée.
Pour résoudre cette question capitale il n'y a qu'un moyen : c'est de rechercher
si dans les maîtres et les devanciers de Sénèque on retrouve ces marques d'un
prétendu christianisme. Si elles s'y trouvent, s'il est démontré que Cicéron,
Platon et nombres d'autres ont été aussi chrétiens que Sénèque et même plus, la
cause est jugée. Qu'y a-t-il donc au fond de ce débat ? La nécessité d'une étude
attentive de la philosophie ancienne.
Ce n'est pas tout, et voici un autre ordre de recherches qui s'ouvre devant nous.

Pour répondre avec précision à ces conjectures vagues qui nous représentent
Sénèque catéchisé par saint Paul et mis par lui dans la confidence des livres
chrétiens qui étaient alors en voie de préparation, il faut savoir exactement
quelle était alors la situation vraie du christianisme dans le monde : la religion
nouvelle tenait-elle alors un assez haut rang et une assez large place dans les
préoccupations publiques, jetait-elle un assez vif éclat, en un mot était-elle assez
connue, assez accréditée et assez estimée pour qu'il soit permis de croire, sans
une invraisemblance trop forte, quelle a pu attirer l'attention et gagner l'estime
d'un homme tel que Sénèque ? De là tout un chapitre d'histoire à écrire sur la
prédication de l'apôtre, sur l'établissement des premières Églises, sur le sujet si
complexe et si délicat des origines du christianisme.
Il est facile de voir à combien de problèmes touche la question que nous
examinons ici. C'est ce qui en fait l'importance et la difficulté, et c'est aussi, nous
l'espérons, ce qui en fera l'intérêt.
Ce sujet si vaste, relevé et compliqué d'affinités si hautes, je n'ai cherché ni à
l'exagérer ni à l'amoindrir. Sans sortir des limites que je me suis tracées, je me
suis appliqué, selon ma conviction, à maintenir avec fermeté les droits de la
raison humaine et à signaler les preuves de puissance et de générosité native qui
éclatent dans les conceptions de la pensée antique, cette mère robuste et cette
noble institutrice de la pensée moderne.
C. A.
Paris, 1er août 1869.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
1
/
204
100%